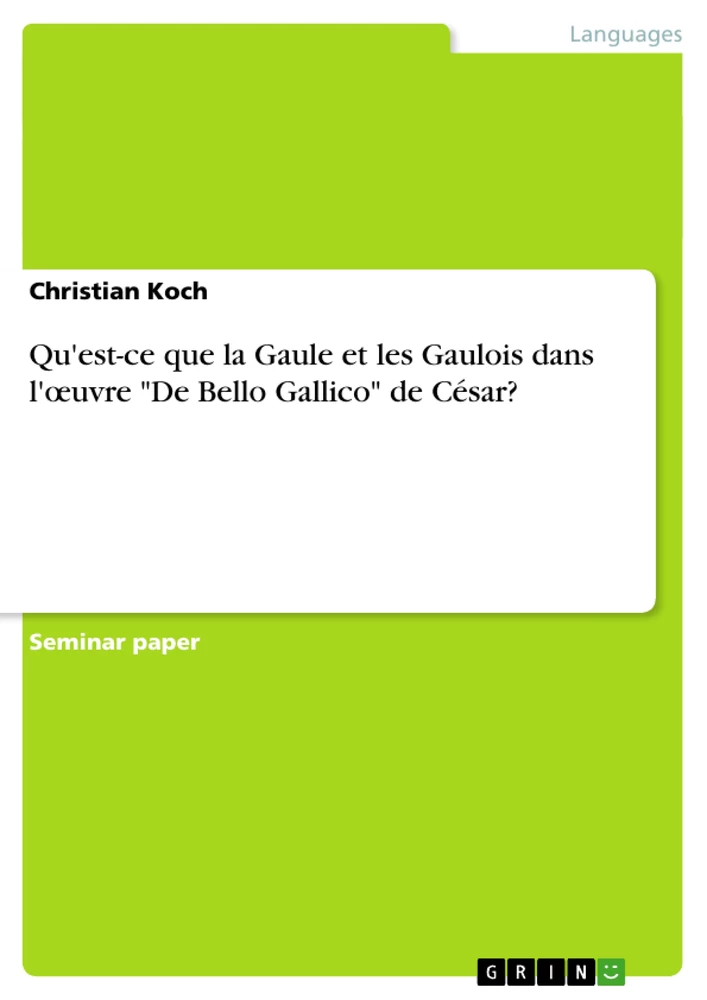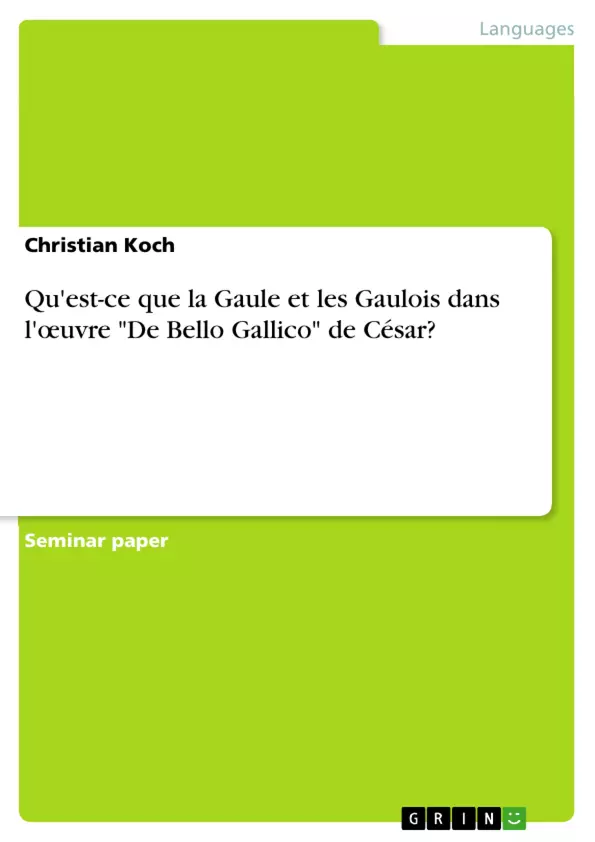« Toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, Gaulois. » (BG 1,1) Cette première phrase de l’œuvre Commentarii de Bello Gallico de Jules César est si connue qu’il y en a beaucoup qui savent la réciter par cœur en latin. Mais est-ce que cette phrase est logique ? Les Gaulois, ne sont-ils pas – selon leur nom – les habitants de la Gaule, c’est-à-dire de toute la Gaule ? Et puis « toute la Gaule » est-elle vraiment toute la Gaule ? Est-ce que les Celtes sont exactement les mêmes gens que les Gaulois ?
Dans ce dossier, on caractérise topographiquement la Gaule et ses habitants selon les définitions générales de l’ethnographie et on analyse l’emploi de ces termes chez César.
Table des matières
1. Introduction
2. Les termes ‹ Gaule › et ‹ gaulois ›
2.1. Toute la Gaule et ses parties
2.2. La différence entre les Celtes et les Gaulois
3. L’emploi des termes dans l’œuvre de César
3.1. La différenciation entre les Gaulois et les autres
3.2. La manière d’employer les termes
4. Résultat
5. Bibliographie
Littérature
Sources d’Internet
Preuves d’images
1. Introduction
« Toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, Gaulois. » (BG 1,1)[1] Cette première phrase de l’œuvre Commentarii de Bello Gallico de Jules César est si connue qu’il y a beaucoup de gens qui savent la réciter par cœur en latin[2]. Mais est-ce que cette phrase est logique ? Les Gaulois, ne sont-ils pas – selon leur nom – les habitants de la Gaule, c’est-à-dire de toute la Gaule ? Et puis « toute la Gaule » est-elle vraiment toute la Gaule ? Est-ce que les Celtes sont exactement les mêmes gens que les Gaulois ?
Toutes ces questions soulignent quelques problèmes de définition dans cette phrase. Dans ce dossier, on caractérisera topographiquement la Gaule et ses habitants selon les définitions générales de l’ethnographie et on analysera l’emploi de ces termes chez César afin de montrer qu’il y a malgré les contradictions une certaine fonction de désignation qui est d’ailleurs décisive pour l’emploi des termes jusque de nos jours.
2. Les termes ‹ Gaule › et ‹ gaulois ›
2.1. Toute la Gaule et ses parties
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
On peut déduire une définition générale de la Gaule en combinant quelques informations de plusieurs œuvres de la littérature ancienne, particulièrement de la littérature grecque des ethnographes comme Strabon qui a décrit la Gaule dans la quatrième livre de sa Γεωγράφικα. La partie la plus ancienne de la Gaule est la Gaule Cisalpine ou Citérieure (Gallia Cisalpina ou Citerior) au nord de l’Italie. L’autre partie, c’est la Gaule Transalpine ou Ultérieure (Gallia Transalpina ou Ulterior) ayant à peu près les bornes de la France de nos jours. Cette partie est encore divisée en quatre parties. Au sud-est, c’est la Gaule Narbonnaise (Gallia Narbonensis). Les trois autres parties – l’Aquitaine, la Gaule Lyonnaise[3] et la Gaule Belgique (Gallia Aquitania, Gallia Lugdunensis et Gallia Belgica) – ont le nom commun de ‹ Gallia Comata ›, ce qui veut dire ‹ la Gaule aux cheveux longs ›.[4]
2.2. La différence entre les Celtes et les Gaulois
César n’utilise le mot ‹ Celtae › que pour désigner les Gaulois de la Gaule Lyonnaise. En plus, il dit que c’est la nomination de leur propre langue tandis que les Romains disent « Galli ». On peut facilement reconnaître que la désignation et l’origine de la nomination sont ici inhabituelles, sinon fausses. H.D. Rankin dit : « The word ‘Celt’ as an ethnic attribute was first used by Greeks to refer to people living to the north of the Greek colony of Massalia (Marseilles) in Southern France. »[5] On peut donc constater que le mot ‹ Celtae › vient du grec ; Κέλτοι signifie probablement ‹ envahisseurs ›[6]. A côté de ce mot-là qui est d’ailleurs utilisé par Hérodote, il y a Κέλται (Strabon), Γάλαται (Pausanias), Celtae (Tite-Live) et finalement Galli dans l’œuvre de César[7]. Mais il faut se demander si ces mots signifient tous ethnographiquement la même chose ou bien, est-ce qu’il faut distinguer les Celtes des Gaulois et des Galates ?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
De nos jours, on dit que les Celtes, c’est un terme générique pour un grand nombre de peuples qui ont leur origine en Europe Centrale et qui se sont répandus sur tout le continent et ces peuples ont tous leur propre nom. Les Galates sont ceux qui se sont tournés vers l’est, les Celtibères sont les Celtes habitant en Ibère etc. Effectivement, les écrivains antiques n’ont guère parlé des mêmes peuples, mais d’un groupe de peuples d’une certaine région bien qu’on ait souvent – en les lisant – l’impression qu’ils parlent toujours des mêmes peuples. Cet effet est probablement le résultat d’une certaine idéologie des écrivains différenciant les Grecs et les Romains comme peuples civilisés et cultivés des peuples barbares[8]: les Africains au sud, les Persans à l’est et les Celtes au nord. Il existe encore un quatrième groupe, les Scythes en Caucase, mais ils étaient souvent classifiés parmi les Celtes comme Celto-Scythes[9].
Une autre différenciation se trouve dans la mythologie, particulièrement dans la mythologie française. Selon le modèle de Virgile qui a créé Enée comme aïeul des Romains, les humanistes français, notamment ceux du XVIe siècle, ont créé ou inventé des ancêtres de plusieurs peuples comme Francus, frère d’Enée et aïeul des Français[10]. Dans Le grand dictionnaire historique de Louis Moréri de 1759, on trouve l’origine de Celtus et de Gallicus, les ancêtres des Celtes et des Gaulois ; ils sont les fils de Polyphème et Galathée[11].[12] D’après cette idée les Celtes et les Gaulois seraient donc des frères.
En résumant, on peut dire que les anciennes désignations des peuples n’étaient pas aussi exactes que celles qu’on leur donne de nos jours, conformes à l’habitude ou à une certaine norme. La question des définitions des termes est au point de vue historique plus compliquée que la plupart des gens croient. Mais pourtant, il est assez clair que les Celtes et les Gaulois ne sont pas la même chose, c’est-à-dire un groupe de peuples ou de tribus unique, même si César l’a écrit dans la première phrase de son œuvre. Cependant, il y a une certaine qualité de sa terminologie qu’on analysera dans ce qui suit.
3. L’emploi des termes dans l’œuvre de César
3.1. La différenciation entre les Gaulois et les autres
Avant César, il n’y avait que les Africains, les Persans et les Celtes comme peuples barbares autour du monde gréco-romain. Il est vrai qu’il y avait aussi des désignations plus exactes pour certaines tribus ou peuples – à savoir les Egyptiens, les Ethiopiens ou les Carthaginois comme des Africains de différentes régions –, mais chaque tribu ou peuple barbare faisait partie d’un de ces trois groupes de peuples. Alors, tout le monde du nord était des Celtes malgré qu’il y eût des peuples qui n’étaient pas du tout des Celtes selon leur langue et leur origine. La raison de cette désignation indifférée est probablement le fait que c’était un terrain inconnu à défaut d’explorations.
Mais dans l’œuvre du conquérant et explorateur Jules César, la désignation n’est plus si facile. César était le premier qui ait distingué les Gaulois des Germains[13]. Déjà dans le premier paragraphe du Bellum Gallicum, il dit que les Germains sont les voisins des Belges et des Helvètes qui sont d’ailleurs aussi des Gaulois. Mais est-ce que cela veut dire que César a découvert les Germains ? Allan A. Lund dit : « Caesar hatte nur anscheinend die Germanen entdeckt, in Wirklichkeit hatte er, wie Kolumbus die Indianer, die Germanen rechts des Rheines erfunden. »[14] Alors, on ne peut pas parler d’une découverte des Germains, mais d’une invention, ce qui veut dire que la désignation ‹ Germains › n’était pas motivée par l’unité des peuples à droite du Rhin, mais elle était arbitraire.
Un autre voisin des Gaulois, ce sont les Espagnols (HHHispanii) qui étaient dénommés Celtes ou Celtibères dans la littérature grecque. Ils ne jouent qu’un rôle marginal dans la guerre des Gaules. Ils coopèrent quelquefois avec quelques tribus. Par ex. : « Ils [les Vocates et les Tarusates] députent aussi vers les états de l’Espagne citérieure, voisins de l’Aquitaine, pour qu’on leur envoie de là des secours et des chefs. » (BG 3,23)
Le troisième voisin, ce sont les Bretons (Britannii)[15]. César parle de ses deux expéditions en Bretagne (BG 4,20 à 38 et 5,1 à 23). Les Bretons étaient aussi des collaborateurs des Gaulois : « César résolut néanmoins de passer dans la Bretagne, pays qu’il savait avoir fourni des secours à nos ennemis dans presque toutes les guerres contre les Gaulois. » (BG 4,20)
En résumant, si on classifie les Helvètes comme Gaulois comme César le fait (BG 1,1), il y a en plus des Romains eux-mêmes trois voisins : les Germains, les Espagnols et les Bretons.
3.2. La manière d’employer les termes
On a déjà vu les contradictions de l’emploi des mots ‹ Gaule › et ‹ Gaulois › dans la première phrase du Bellum Gallicum [16] et l’invention des Germains ne paraît pas non plus légitime. Il faut se demander si la différenciation entre les Gaulois et les Germains est justifiée n’importe comment. Effectivement, c’est un problème des disciplines de l’ethnographie et l’ethnologie. Les ethnologues diraient que la base pour classifier un peuple est d’un côté l’origine unique des gens et de l’autre côté la connaissance nationale (langue, culture etc.). Mais il y a aussi – surtout chez les ethnographes – le critère de la géographie qui paraît être plus important dans l’œuvre de César.
Il faut considérer que César n’a pas voulu écrire un livre ethnologique ou ethnographique, mais principalement des commentaires de guerre. Alors les désignations des tribus et des peuples sont déterminées par la géographie – on l’a déjà dit – et par leur comportement dans la guerre, c’est-à-dire que c’est la question des défenses, des attaques et des combats réciproques entre les tribus éclaircissant les différentes parties assorties. Par conséquent, on apprend des désignations très exactes des tribus pendant la lecture du Bellum Gallicum. En résultat, César parle de plus d’une soixantaine de tribus :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Probablement les désignations des tribus ont-elles la fonction principale de les reconnaître pendant la guerre. Tous les officiers romains devaient utiliser les mêmes noms pour éviter des malentendus pendant les planifications. Par cet aspect, on voit qu’il fallait y avoir une évidence naturelle des termes qui était plutôt rompue aux affaires que théoriquement réfléchie selon des critères ethnologiques.
Il reste seulement la question de la première phrase du Bellum Gallicum; pourquoi est-elle si contradictoire ? Quant aux trois parties de la Gaule, il est probablement clair qu’il ne s’agit que des régions qui n’étaient pas encore occupées ou bien conquises par les Romains.[17] Mais ce fait n’explique pas pourquoi César ne mentionne pas les Helvètes dans cette phrase bien qu’il écrive trois phrases plus tard (indirectement) qu’ils sont aussi des Gaulois.
D’ailleurs, il utilise aussi les désignations conventionnelles ‹ Gaule Citérieure › (par ex. BG 1,24) et ‹ Gaule Ultérieure › (par ex. BG 1,7) dont on a parlé dans le chapitre 2.1. A la question des tribus habitant la Gaule Lyonnaise qui se nomment d’après César ‹ Celtes › ou ‹ Gaulois › on ne peut que répondre simplement qu’il n’y existait pas d’autre terme pour les désigner quoique cette désignation soit assez fausse.
4. Résultat
On a vu que les dénominations grossières des Gaulois et leurs voisins[18] de Jules César ne sont guère ethnologiquement fondées. Elles se sont quand même assez bien établies jusque dans nos jours. Particulièrement en Allemagne où beaucoup de gens se considèrent comme descendants des Germains – au moins jusqu’en 1945 – tandis qu’en France, il y a à peine l’orgueil dans l’idée de descendre des Gaulois. La thèse introduite par César que ces deux peuples se séparent géographiquement par le Rhin a encore marquée les luttes entre l’Allemagne et la France pendant les guerres du XIXe et du XXe siècle. Alors, on peut dire que les dénominations de César ont profondément influencé le développement de l’histoire européenne pendant deux millénaires.
5. Bibliographie
Littérature
Caesar, C. Iulius (52004) : Der Gallische Krieg – De bello Gallico. Dusseldorf/Zurich.
Demandt, Alexander (52005) : Die Kelten. Munich.
Krüger, Reinhard (2001) : Die französische Renaissance. Stuttgart.
Lund, Allan A. (1995) : « Die Erfindung der Germanen ». Dans : Der Altsprachliche Unterricht 1995/2. Berlin, p. 4 à 20.
Lund, Allan A. (1996) : « Caesar als Ethnograph ». Dans : Der Altsprachliche Unterricht 1996/2. Berlin, p.12 à 21.
Maier, Bernhard (1994) : Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart.
Moréri, Louis (1759) : Le grand dictionnaire historique. Paris.
Rankin, H.D. (1987) : Celts and the Classical World. New South Wales.
Sources d’Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes (5 mars 2006)
http://bcs.fltr.ucl.ac.be (5 mars 2006)
Preuves d’images
p. 1 : http://de.wikipedia.org/wiki/Gallien (15 mars 2006)
p. 3 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule (15 mars 2006)
p. 4 : http://www.fll.vt.edu/Teulon/fr3205/visuals/gallo-romain (16 mars 2006)
p. 7 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule (15 mars 2006)
[...]
[1] J’utilise la traduction de Pierre Fabre : Jules César, La Guerre des Gaules, tirée de l’Internet : http://bcs.fltr.ucl.ac.be (5 mars 2006).
[2] Gallia est omnia divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celate, nostra Galli appellantur.
[3] Selon César : Gallia Celtica – la Gaule Celtique.
[4] Quant aux Helvètes, on en parlera plus tard.
[5] H.D. Rankin (1987) : Celts and the Classical World. New South Wales, p. 1 et suiv.
[6] Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes#Etymologie (15 mars 2006).
[7] Cf. Alexander Demandt (52005) : Die Kelten. Munich, p. 9.
[8] Cf. Bernhard Maier (1994) : Lexikon der Religion und Kultur. Stuttgart, p. 119 et suiv. (antike Ethnographie).
[9] Cf. Allan A. Lund (1996) : Caesar als Ethnograph. Dans : Der Altsprachliche Unterricht (AU) 2/1996. Berlin, p. 12.
[10] Cf. Reinhard Krüger (2001) : Die französische Renaissance. Stuttgart, p. 82.
[11] Peut-être est-elle l’ancêtre des Galates (?).
[12] Louis Moréri (1759) : Le grand dictionnaire historique. Paris, t. 3 p. 389.
[13] Cf. Lund (1996) loc. cit. p. 12 et suiv.
[14] Ibid. p. 12. Cf. aussi Allan A. Lund (1995) : Die Erfindung der Germanen. Dans : Der Altsprachliche Unterricht 1995/2. Berlin, p. 4 à 20.
[15] Il ne faut pas confondre les Bretons et la Bretagne de cette époque-là avec les habitants et la presqu’île de la France contemporaine. La Bretagne n’était que l’île qu’on appelle dans nos jours la Grande-Bretagne.
[16] Cf. l’introduction.
[17] Cf. Otto Schönberger (éd.) (52004) : C. Iulius Caesar : Der Gallische Krieg – De bello Gallico. Dusseldorf/Zurich, p. 503.
Questions fréquemment posées
De quoi parle ce texte sur la Gaule et les Gaulois ?
Ce texte examine l'utilisation des termes "Gaule" et "Gaulois" dans l'œuvre de Jules César, "Commentarii de Bello Gallico" (La Guerre des Gaules). Il analyse la définition géographique de la Gaule, la distinction entre les Celtes et les Gaulois, et comment César emploie ces termes pour désigner les peuples et les régions.
Comment César décrit-il la Gaule dans son œuvre ?
César divise la Gaule en trois parties principales : la Gaule Belgique, l'Aquitaine et la partie habitée par ceux qui se nomment Celtes dans leur propre langue et Gaulois dans la langue romaine. Le texte examine si cette division est logique et exhaustive.
Quelle est la différence entre les Celtes et les Gaulois selon ce texte ?
Le texte explique que le terme "Celte" est un terme générique pour un grand nombre de peuples d'Europe centrale. César utilise "Celtae" pour désigner les Gaulois de la Gaule Lyonnaise. Le texte examine l'origine et l'évolution de ces termes et les différentes interprétations des auteurs anciens.
Pourquoi César distingue-t-il les Gaulois des Germains ?
César est considéré comme le premier à avoir clairement distingué les Gaulois des Germains. Cependant, le texte suggère que cette distinction est peut-être une "invention" de César, motivée davantage par des considérations géopolitiques que par une véritable unité ethnique des peuples situés à l'est du Rhin.
Comment César utilise-t-il les termes dans un contexte militaire ?
Le texte souligne que César écrivait des commentaires de guerre, et que sa terminologie est donc influencée par la géographie et le comportement des différentes tribus pendant la guerre. Il emploie des désignations précises des tribus pour faciliter la reconnaissance et la planification militaires.
Quelles sont les conséquences historiques de l'utilisation des termes par César ?
Le texte affirme que l'utilisation des termes par César, notamment la séparation géographique entre Gaulois et Germains, a eu un impact profond sur l'histoire européenne, influençant les conflits entre l'Allemagne et la France pendant les siècles suivants.
Quelles sont les sources utilisées dans ce texte ?
Le texte s'appuie sur des sources littéraires anciennes telles que les œuvres de César, Strabon et Tite-Live, ainsi que sur des études modernes sur l'ethnographie et l'histoire celtique et gauloise. Il inclut également des références à des sources internet et des images.
- Quote paper
- Christian Koch (Author), 2006, Qu'est-ce que la Gaule et les Gaulois dans l'œuvre "De Bello Gallico" de César?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110987