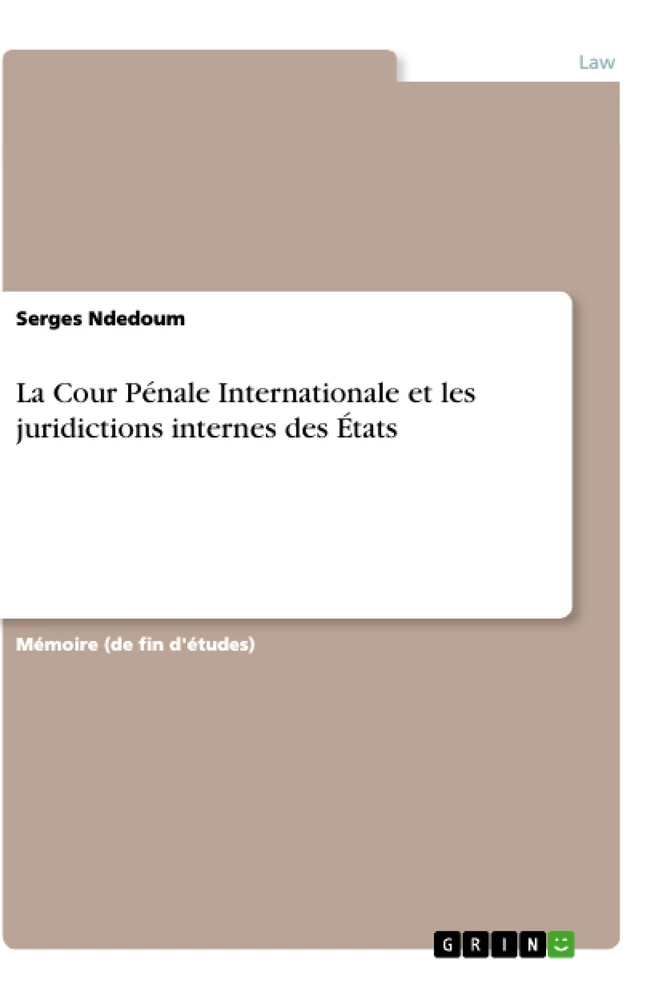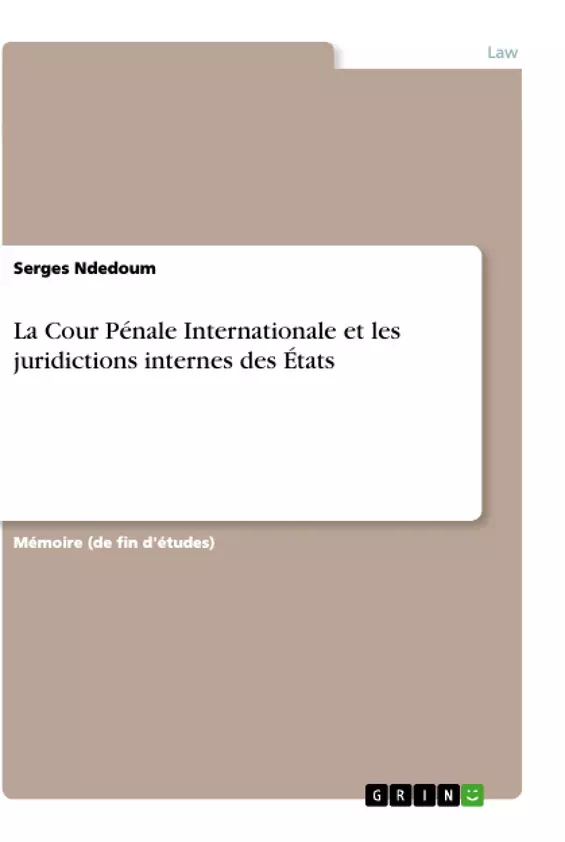Le monde a connu des atrocités entre le XVème et le XXème siècle. L’an 1474 marque en effet une avancée considérable pour la justice pénale internationale, notamment avec le procès de Peter Von HAGENSBACH, Grand Bailli d’Alsace, serviteur de Charles le Téméraire, jugé pour ce que l’on appelle aujourd’hui crime de guerre. Ce procès a été source d’inspiration pour l’instauration d’une justice pénale internationale stable. Seulement, c'est au XXème siècle que cette justice connaîtra une avancée remarquable. D'ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, on va assister à la création de tribunaux pénaux internationaux (TPIY, TPIR et TSSL).
Cependant, le problème de stabilité n’était pas toujours résolu car ces derniers étaient appelés à disparaître une fois leurs missions remplies. La création d’une juridiction permanente telle que la Cour pénale internationale fut la bienvenue. Elle fut encore très louable, car elle a pour but de collaborer avec les juridictions internes des États dans la lutte contre l’impunité des auteurs des infractions les plus graves telles que les crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes de génocide et les crimes d’agression. Dès le préambule et à l’article 1er du Statut de Rome, la CPI est décrite comme complémentaire des juridictions nationales. Ceci souligne le problème de rapport entre les deux juridictions.
Les rapports qui existent entre la CPI et les juridictions nationales sont de nature complémentaire au niveau de la compétence et collaborative au niveau des poursuites des auteurs des infractions. Ainsi, dans ses rapports avec les juridictions internes des États, la CPI n’a pas la priorité pour connaître les crimes relevant de sa compétence : les États restent les premiers responsables de la lutte contre l’impunité. Elle a une primauté dans la répression si ces derniers ne s’en chargent pas pour quelques motifs que ce soient. Cependant, pour une bonne complémentarité entre la Cour et les juridictions internes, un appel est fait aux États d’une part, à beaucoup plus de coopération avec la Cour et d’autre part, à remplir pleinement leurs missions de lutte contre l’impunité des infractions graves menaçant la paix internationale.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Chapitre I : Les juridictions internes et le droit pénal international
- Section 1 : L'État, garant du respect des droits de l'homme
- I. L'État, sujet principal du droit international
- II. L'État, garant du respect des droits de l'homme
- III. La responsabilité de l'État en droit pénal international
- Section 2 : Le droit pénal international et les juridictions internes
- I. Le droit pénal international et les juridictions internes
- II. La relation entre le droit pénal international et le droit pénal interne
- III. Le rôle des juridictions internes dans l'application du droit pénal international
- Chapitre II : La Cour pénale internationale et les juridictions internes des États
- Section 1 : La Cour pénale internationale, une nouvelle juridiction pénale internationale
- I. L'émergence de la Cour pénale internationale
- II. Les compétences de la Cour pénale internationale
- III. Les procédures de la Cour pénale internationale
- Section 2 : La relation entre la Cour pénale internationale et les juridictions internes des États
- I. Le principe de complémentarité
- II. Les obligations des États parties au Statut de Rome
- III. La coopération entre la Cour pénale internationale et les juridictions internes des États
- Chapitre III : Le fonctionnement de la Cour pénale internationale et son impact sur les juridictions internes
- Section 1 : Le fonctionnement de la Cour pénale internationale
- I. L'organisation de la Cour pénale internationale
- II. Les procédures de la Cour pénale internationale
- III. Les décisions de la Cour pénale internationale
- Section 2 : L'impact de la Cour pénale internationale sur les juridictions internes
- I. L'impact de la Cour pénale internationale sur la justice pénale interne
- II. L'impact de la Cour pénale internationale sur la coopération internationale
- III. Les défis liés à la mise en œuvre du principe de complémentarité
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen der Internationalen Strafgerichtshof (ICC) und den nationalen Gerichtsbarkeiten der Staaten. Ziel ist es, das Zusammenspiel der beiden Rechtssysteme zu analysieren und die Herausforderungen bei der Umsetzung des Komplementaritätsprinzips zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich auch mit den Auswirkungen der ICC auf das nationale Strafrecht und die internationale Zusammenarbeit.
- Die Rolle des Staates als Garant der Menschenrechte
- Das Verhältnis zwischen internationalem Strafrecht und nationalem Strafrecht
- Die Kompetenz und Verfahren der ICC
- Das Komplementaritätsprinzip und die Zusammenarbeit zwischen der ICC und den nationalen Gerichtsbarkeiten
- Die Auswirkungen der ICC auf die nationale Justiz und die internationale Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I befasst sich mit der Rolle des Staates als Garant der Menschenrechte und dem Zusammenhang zwischen internationalem Strafrecht und nationalen Gerichtsbarkeiten. Kapitel II behandelt die ICC als neues internationales Strafgericht und analysiert deren Kompetenzen, Verfahren und die Beziehung zu den nationalen Gerichtsbarkeiten im Kontext des Komplementaritätsprinzips. Kapitel III untersucht die Funktionsweise der ICC und deren Auswirkungen auf die nationalen Gerichtsbarkeiten, insbesondere auf die nationale Strafjustiz und die internationale Zusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen der Arbeit sind: Internationale Strafgerichtshof (ICC), nationales Strafrecht, Komplementaritätsprinzip, internationale Zusammenarbeit, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le principe de complémentarité de la CPI ?
Le principe de complémentarité signifie que la Cour pénale internationale (CPI) n'intervient que si les juridictions nationales d'un État n'ont pas la volonté ou la capacité de mener à bien les poursuites contre les auteurs de crimes graves.
Quels types de crimes relèvent de la compétence de la CPI ?
La CPI est compétente pour juger les crimes les plus graves touchant la communauté internationale : le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.
Quel est le rôle de l'État face aux crimes internationaux ?
L'État est le premier responsable de la lutte contre l'impunité. En tant que sujet principal du droit international, il doit garantir le respect des droits de l'homme et poursuivre les auteurs d'infractions sur son territoire.
Quelle est la différence entre la CPI et les tribunaux pénaux internationaux (TPI) ?
Contrairement aux TPI (comme pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda) qui étaient temporaires, la CPI est une juridiction permanente créée par le Statut de Rome.
Pourquoi la coopération des États est-elle cruciale pour la CPI ?
La CPI ne disposant pas de sa propre force de police, elle dépend entièrement de la coopération des États pour l'arrestation des suspects, la collecte de preuves et l'exécution des peines.
- Quote paper
- Serges Ndedoum (Author), 2015, La Cour Pénale Internationale et les juridictions internes des États, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215605