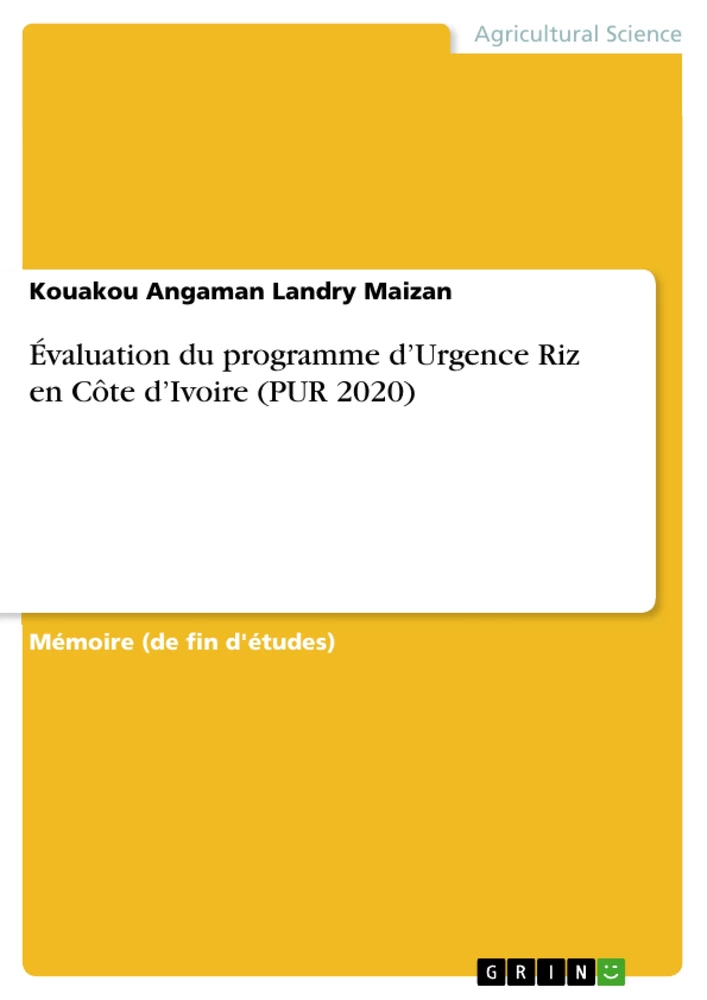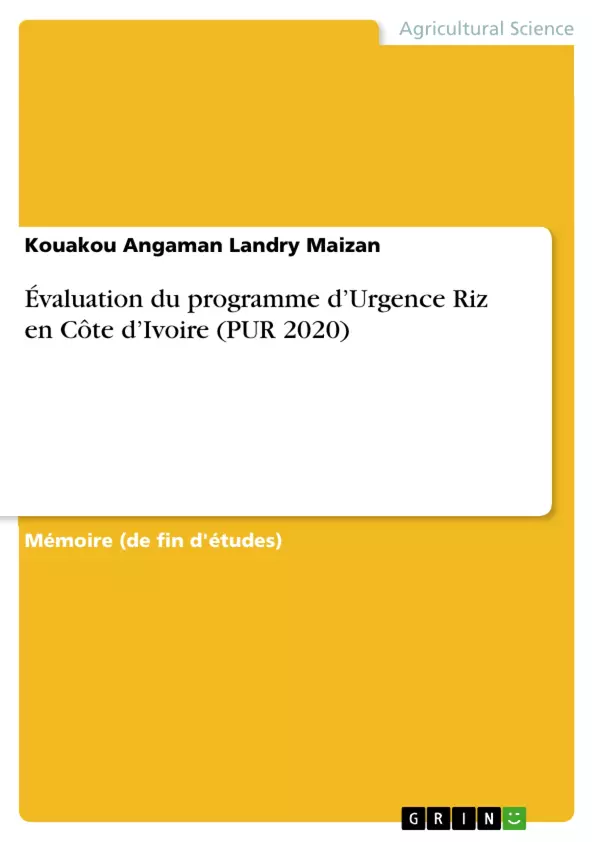La Côte d’Ivoire est un pays encore tributaire de l’importation du riz. Et avec l’arrivée de la COVID 19 qui a entrainé une forte diminution des quantités de riz disponibles sur le marché international, le pays se voit confronter à un risque d’insécurité alimentaire en matière de riz. C’est dans ce contexte que l’État a décidé de mettre en place un Programme d’Urgence Riz 2020 (PUR 2020).
L’objectif du PUR 2020 est d’assurer la couverture des besoins de consommation par la production nationale afin de répondre au risque de pénurie du riz dû à la pandémie à coronavirus. Après plusieurs mois d’exécution du programme, il est primordial de l’apprécier en vue de prendre de meilleures décisions. Ainsi, la présente étude est menée dans le but de contribuer à l’amélioration du processus de formulation et de mise en œuvre des Programmes d’Urgence Riz.
Inhaltsverzeichnis
- TABLE DES MATIERES
- DEDICACE
- AVANT PROPOS
- REMERCIEMENTS
- SIGLES ET ABREVIATIONS
- LISTE DES ILLUSTRATIONS
- RESUME
- ABSTRACT
- INTRODUCTION
- CHAPITRE 1 : REVUE DE LITTERATURE
- 1.1. Généralités sur le riz et la filière riz en Côte d'Ivoire
- 1.1.1. Situation mondiale du riz
- 1.1.2. Enjeux du riz en Afrique de l'Ouest
- 1.1.3. Présentation de la filière riz en Côte d'Ivoire
- 1.1.3.1. Evolution des politiques rizicoles en Côte d'Ivoire
- 1.1.3.2. Systèmes de production
- 1.1.3.3. Acteurs de la filière riz en Côte d'Ivoire
- 1.2. Cadre conceptuel de l'étude
- 1.2.1 Notion de programme
- 1.2.2. Notion d'évaluation
- 1.2.2.1. Définitions
- 1.2.2.2. Types d'évaluation
- 1.2.2.3. Evaluation d'impact
- 1.2.2.4. Evaluation de programme
- 1.2.3. Théorie du changement
- 1.2.4. Notion d'efficience
- 1.2.5. Méthodes de mesure de l'efficience
- 1.2.5.1. Méthode paramétrique
- 1.2.5.2. Méthode non paramétrique
- 1.2.5.3. Comparaison de l'approche non paramétrique et de l'approche paramétrique
- 1.3. Cadre empirique de l'étude
- 1.3.1. Analyse de l'efficience des riziculteurs
- 1.3.2. Evaluation d'impact de programmes agricoles
- Conclusion partielle
- 1.4. Présentation du Programme d'Urgence Riz (PUR 2020)
- 1.4.1. Contexte et justification du programme
- 1.4.2. Objectifs, composantes et résultats attendus du programme
- 1.4.2.1. Objectifs
- 1.4.2.2. Composantes du programme
- 14.2.3. Résultats attendus
- 1.4.3. Zone d'intervention et bénéficiaires du PUR 2020
- 1.4.4. Acteurs du Programme d'Urgence Riz 2020
- 1.4.5. Coût du programme et apports des parties prenantes
- CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE
- 2.1. Hypothèses
- 2.2. Méthodologie
- 2.2.1. Méthodes
- 2.2.2. Outils
- 2.2.2.1. Evaluation du Programme d'Urgence Riz 2020
- 2.2.2.2. Analyse des effets des travaux confortatifs du PUR 2020 sur l'efficience et le rendement des riziculteurs
- 2.2.2.3. Analyse des forces et les faiblesses du PUR 2020
- 2.2.3. Nature des données
- 2.2.4. Echantillon
- 2.2.5. Collecte de données
- 2.2.5.1. Données primaires
- 2.2.5.2. Données secondaires
- 2.2.5.3. Logiciels utilisés
- 2.3. Zone d'étude
- 2.4. Limites de l'étude
- Conclusion partielle
- CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION
- 3.1. Evaluation du Programme d'Urgence Riz 2020
- 3.1.1. Analyse de la pertinence du PUR 2020
- 3.1.2. Analyse de la cohérence
- 3.1.2.1. La logique verticale
- 3.1.2.2. La logique horizontale
- 3.1.3. Efficacité du PUR 2020
- 3.1.3.1. Efficacité par rapport aux indicateurs de résultat
- 3.1.3.2. Efficacité par rapport à la planification (respect de la programmation des activités)
- 3.1.4. Efficience du PUR 2020
- 3.1.4.1. Efficience par rapport à la gestion globale du programme
- 3.1.4.2. Qualité de la mise en œuvre par les prestataires
- 3.2. Analyse des effets des travaux confortatifs du PUR 2020 sur l'efficience et le rendement des riziculteurs
- 3.2.1. Evaluation des travaux confortatifs du PUR 2020
- 3.2.1.1. Evolution des superficies emblavées
- 3.2.1.2. Accroissement de la production de paddy
- 3.2.2. Analyse de l'efficience des travaux confortatifs sur les exploitations rizicoles
- 3.2.2.1. Analyse descriptive des exploitations et exploitants de riz
- 3.2.2.2. Efficience technique des exploitations rizicoles
- 3.2.3. Analyse des effets des travaux confortatifs sur le rendement des riziculteurs
- 3.2.3.1. Analyse des déterminants de la participation au PUR 2020
- 3.2.3.2. Effets des travaux confortatifs sur le rendement des riziculteurs
- 3.3. Analyse des forces et des faiblesses du PUR 2020
- Conclusion partielle
- CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
- Bewertung der Effizienz des PUR 2020
- Analyse der Auswirkungen der unterstützenden Maßnahmen des PUR 2020 auf die Effizienz und den Ertrag der Reisbauern
- Identifizierung der Stärken und Schwächen des PUR 2020
- Entwicklung von Empfehlungen zur Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit des Programms
- Beitrag zum besseren Verständnis der Herausforderungen und Chancen für die Entwicklung des Reissektors in Côte d'Ivoire
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, den Programm d'urgence riz (PUR 2020) in Côte d'Ivoire zu evaluieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Effizienz des Programmes, der Auswirkungen der unterstützenden Maßnahmen auf die Effizienz und den Ertrag der Reisbauern sowie auf der Identifizierung der Stärken und Schwächen des Programms.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit einer umfassenden Literaturrecherche zum Thema Reisproduktion und -filiere in Côte d'Ivoire, einschliesslich globaler und regionaler Entwicklungen, sowie mit der Einführung grundlegender Konzepte und Methoden der Programmevaluation. Das zweite Kapitel erläutert die angewandte Methodik der Studie, einschließlich der Hypothesen, Datenquellen, Datenerhebungsmethoden und der statistischen Analysemethoden. Das dritte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Evaluation des PUR 2020, unterteilt in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt analysiert die Effizienz des Programms anhand der Kriterien der Relevanz, Kohärenz, Effektivität und Effizienz. Der zweite Abschnitt bewertet die Auswirkungen der unterstützenden Maßnahmen des Programms auf die Effizienz und den Ertrag der Reisbauern. Der dritte Abschnitt identifiziert die Stärken und Schwächen des PUR 2020. Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Reisproduktion, Programmevaluation, Effizienz, Ertrag, Stärken und Schwächen, Reissektor, Côte d'Ivoire, PUR 2020, landwirtschaftliche Programme, Entwicklungszusammenarbeit.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le Programme d’Urgence Riz (PUR 2020) ?
Le PUR 2020 est une initiative de l'État ivoirien visant à booster la production nationale de riz pour contrer les risques de pénurie alimentaire causés par la pandémie de COVID-19.
Pourquoi la Côte d'Ivoire importe-t-elle encore du riz ?
Malgré un fort potentiel, la production locale ne couvre pas encore les besoins de consommation nationale, rendant le pays dépendant des importations sur le marché international.
Quels sont les objectifs principaux du PUR 2020 ?
Les objectifs incluent l'augmentation des superficies cultivées, l'amélioration du rendement des riziculteurs et la sécurisation de l'approvisionnement des marchés locaux.
Comment l'efficience des riziculteurs est-elle mesurée ?
L'étude utilise des méthodes paramétriques et non paramétriques pour analyser l'efficience technique des exploitations et l'impact des travaux de confortement réalisés par le programme.
Quelles sont les faiblesses identifiées dans le programme ?
L'évaluation analyse les défis liés à la mise en œuvre, la coordination entre les acteurs et la durabilité des interventions après la phase d'urgence.
- Citar trabajo
- Kouakou Angaman Landry Maizan (Autor), 2021, Évaluation du programme d’Urgence Riz en Côte d’Ivoire (PUR 2020), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268808