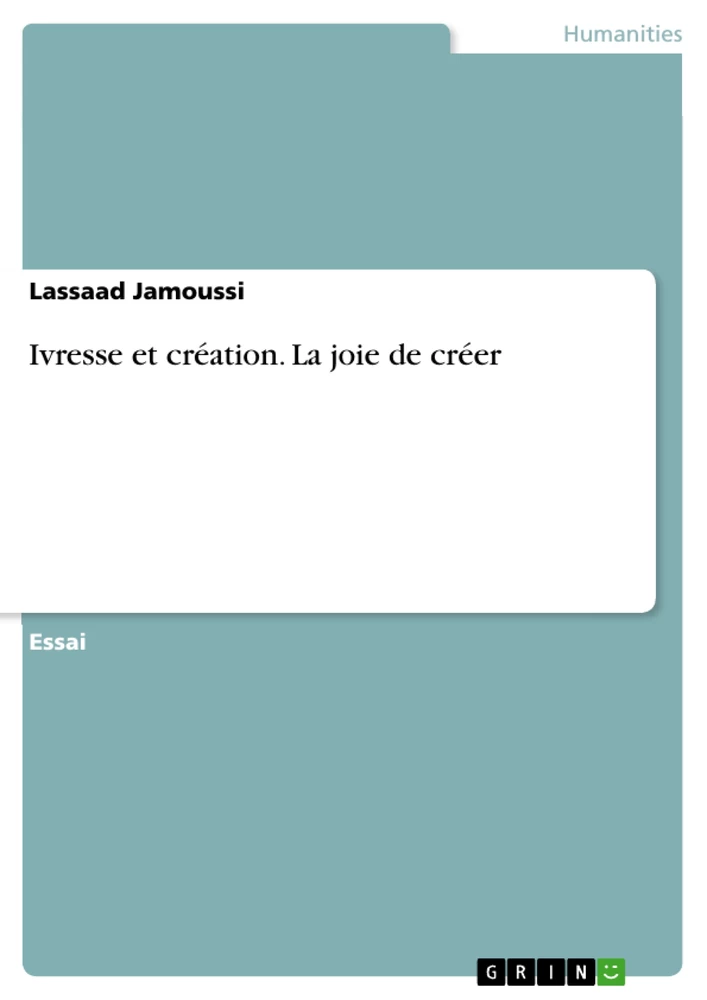La création artistique suppose un engagement total qui demande de l'effort et même de la souffrance. Quelles en sont les motivations profondes?
Ivresse et création
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abyme
O beauté, ton regard éternel et divin
Verse confusément le bienfait et le crime
Et l’on peut, pour cela, te comparer au vin
La création artistique est synonyme de labeur exquis. Le triomphe de l’artiste réside dans son corps-à-corps avec son œuvre, à l’image d’un accouplement orgiastique infini qui se renouvelle sans cesse, provocant autant de charges de plaisirs et de peines. Eros et Thanatos sont en consubstantielle débauche d’énergie qui se transmute en plaisirs créatifs. Ces deux postulations que Freud tente de mettre en miroir dans Au-delà du principe de plaisir trouvent leur échos dans le Banquet de Platon, dans la fable des androgynes racontée par Aristophane. Les dieux pour punir les hommes, les scindèrent en deux gamètes, brisant ainsi leur continuité, leur équilibre et leur complétude « Éros vise à rétablir cette continuité, via la réunion des gamètes. »
La création artistique, par le truchement de l’imaginaire, de l’ivresse poétique, permet cette accessibilité aux plaisirs augmentés d’une recherche de soi à travers les miroirs de l’œuvre. « Les créations artistiques foisonnent sur la toile, elles soulignent particulièrement la caractéristique de ce que Freud a relevé comme sublimation : le mode de détournement des pulsions, ancestral, positivé et valorisé dans toute civilisation depuis l’art rupestre jusqu’aux dernières versions de l’art moderne »1, écrit Muriel Thiaude.
La posture quasi-masochiste de l’artiste renvoie à des zones intimes souvent difficiles à sonder. « L’acte créateur demeure mystérieux 2 » écrit Edmond Nogacki dans l’avant-propos de L’Energie créatrice, « et on peut penser qu’il exercera longtemps sa fascination sur les esprits rationnels du critique et plus simplement de l’amateur d’art qui ne parviennent pas à justifier un comportement aussi contraire à la tendance naturellement épicurienne du genre humain. »3 Nous sommes tentés avec Nogacki, de chercher à savoir ce qui peut pousser le créateur à endurer tant de tourments, à supporter tant de fatigues pour réaliser ce qu’il conviendra d’appeler œuvre pour le moins et œuvre d’art dans le meilleurs des cas . La réponse serait à chercher dans les différentes ressources de l’energeïa, cette force intérieure propre à chaque créateur, puisée dans la psyché, la tension, le délire mystique ou encore dans les différentes formes de l’ivresse poétique.
Le maître mot dans la plupart des interrogations sur l’art et son mystère en tant que création et comme réception, est à chercher dans les sources dionysiaque de ces formes d’ivresse qui transforment l’esprit et prédisposent l’être à s’élever au stade d’un état second. Un état où les vicissitudes du quotidien disparaissent pour donner lieu à une sorte de méditation sublime. Le plaisir est là. Dans ces interstices recherchés par le créateur et reçus par les âmes sensibles. Le dionysiaque qui préside à la sensibilité nietzschéenne dans la Naissance de la tragédie rejoint les confins de la dissolution de l’être à force de plaisir esthétique : « Comment peut-on écouter de la musique de Wagner sans mourir ? – Comment imaginer un homme (un musicien authentique) capable d’écouter le troisième acte de Tristan et Yseult, comme une phrase symphonique unique et démesurée, sans expirer sous la tension convulsive des ailes grand ouvertes de leur âme. Quand on a, comme ici, écouté battre de tout près le cœur du vouloir universel, quand on a senti le furieux désir de l’être se déverser, tantôt comme un fleuve tournant, tantôt comme un ruissellement frêle et éparpillé et se répandre dans toutes les artères de l’univers, comment ne pas s’effondrer brusquement ? »4
Dans le Gai Savoir, Nietzsche associé création et labeur avec bonheur personnel et bonheur public « Tout bonheur veut rendre heureux ! Voulez-vous cueillir mes roses ? », propose le poète au lecteur. Sauf que pour goûter au bonheur, il faut oser se baisser parmi les ronces, se piquer le doigt, se le lécher, goûter son propre sang.
« Mes roses : Oui ! Mon bonheur - veut rendre heureux ! Tout bonheur veut rendre heureux ! Voulez-vous cueillir mes roses ? Il faut vous baisser, vous cacher, Parmi les ronces, les rochers, Souvent vous lécher les doigts ! Car mon bonheur est moqueur ! Car mon bonheur est perfide ! - Voulez-vous cueillir mes roses ? »5.
Dans Le chant du prince Vogelfrei, de Goethe en appendice de l’essai philosophique, nous retrouvons la référence au tremblement dionysiaque de l’ivresse poétique associée à la double postulation de la douleur et du plaisir
Les rimes sont comme des flèches
Tout cela s’agite et tremble
Lorsque la flèche pénètre
Dans le corps de la bête
Vous en mourrez pauvre diable
Hélas si ce n’est d’ivresse
Oui monsieur, vous êtes poète
Pic l’oiseau hausse les épaules
Le vin au sens propre et au figuré est au cœur de cette énergie depuis toujours. Ce breuvage qui a tant fasciné les créateurs de toutes époques et de tous genres est doté d’une puissante charge qui l’élève au rang du mythe. Ce serait un lieu commun de citer la place des chants dithyrambiques dans la naissance du théâtre en Grèce antique. Cependant il est indispensable d’insister sur la place qu’occupe le mythe de la vigne, du vin et du dieu Dionysos dans le couple sadomasochiste de la création artistique. Né du feu et du nectar des Dieux de l’Olympe, du sein de la mortelle Sémélé et de la cuisse de Zeus, incarnation exemplaire de la consubstantialité de la vie et de la mort, Dionysos, le saint patron de la tragédie qui ne s’accomplit que devant la majesté de son Autel aux premières loges, préside au mystère d’Eleusis. En tant que tel, il est au cœur de la tradition mystique, avec tout ce qu’elle charrie comme capacités de communion et pouvoirs d’élévation spirituelle. Cette tradition transcende les limites des espaces et de l’âge grec, elle atteint une sorte d’universalité qui la rapproche des éléments structurels anthropologiques de l’imaginaire. Gilbert Durant classe le vin parmi les symboles nocturnes relevant des structures mystiques, au même titre que l’œuf, le miel l’or et le lait.
Plaisirs nourriciers vertige et mystère ; états seconds, c’est en somme, ce que bien des auteurs ont exprimé dans la démarche qui préside à l’acte créateur. Jackson Pollock, mu par une énergie qui déborde la précision du crayon et des coups de pinceau, laisse couler les formes couleurs, comme si elles jaillissaient de son propre sang répandu sur les toiles. Toute l’énergie de son corps dansant, bougeant, chancelant, créant des mouvements dans l’espace éphémère, se traduisent en tracés en foisonnant à la surface de l’œuvre. L’invisible de la danse éphémère, mue par l’emprise d’un corps en transe, rend le tableau autrement plus enivrant.
Rousseau retrouvant les images fugaces d’un instant élu, comprend après bien des années, la manière dont sa plume déborde sa volonté d’écrire. Une inspiration subite le saisi au milieu de sa marche vers la prison de Vincennes où il devait rendre visite à Diderot : « Tout à coup je me sens l’esprit ébloui de mille lumières ; des foules d’idées vives s’y présentèrent à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable ; je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l’ivresse. »6
Le mythe de l’ivresse de l’instant créateur n’a rien perdu de son acuité qui s’est forgée depuis l’antiquité à nos jours. Omar Khayam et Abou Nawas, pour ne citer que ces deux grandes figures de la poésie dionysiaque dans le monde musulman exaltent les plaisirs de l’ivresse apte à agir sur la nature et à égayer la pierre inerte. Dans la bible, le vin et la vigne sont cités plus de quatre cent fois, le Cantique des cantiques célèbre cette puissance érotique du vin. Ainsi dans le premier chant, nous pouvons lire : « Mon bien aimé est pour moi un sac de myrrhe, repose sur ma poitrine. Mon bien aimé est pour moi une grappe de Chypre dans les vignes d’Engaddi ». La Cène et le miracle des noces de Cana posent la puissance transformationnelle liée au vin. Métamorphose de l’eau en vin, métamorphose du vin en sang du christ, autant de marques d’élévation qui ne vont pas sans rappeler, certes, indirectement, la puissance transformationnelle de Dionysos à chaque fois qu’un péril diligenté par Héra, le guette. Il se transforme en lierre, en vigne, en tigre. Il devient féroce, intrépide et sans merci. L’artiste nous dit Alain Robbe-Grillet, est vu comme une « sorte de monstre inconscient, irresponsable et fatal, […] un simple médiateur entre le commun des mortels et une puissance obscure, au-delà de l’humanité, un esprit éternel, un dieu… »7
Relevant les défis contre les lois de l’interdit, Omar Khayam brave ses contradicteurs, dans sa communion mystique avec dieu, il s’lève à la dignité du prédicateur des plaisirs qu’offre la vie ici-bas pour le poète et son lecteur. Associant le lecteur dans sa quête du bonheur d’être et de créer il écrit :
« Notre trésor ? Le vin. Notre palais ? La taverne. Nos compagnons fidèles ? La soif et l’ivresse. Nous ignorons l’inquiétude, car nous savons que nos âmes, nos cœurs, nos coupes et nos robes maculées, n’ont rien à craindre de la poussière, de l’eau et du feu ».
[...]
1 Muriel Thiaude, « l’enfance de l’art entre Eros et Thanatos », article publié sur la toile en 2020,
2 Nogacki Edmond, L’énergie Créatrice, ouv.coll., Presses Universitaires de Valenciennes, Lez Valenciennes, 1997, N°22, p.7.
3 Ibid.
4 Nietzsche, La Naissance de la Tragédie, traduction Geneviève Bianquis, collection Idées, Gallimard, 1949, p. 141.
5 Nietzche, Le Gai Savoir, Traduction de «Die Fröhliche Wissenshaft (La Gaya Scienza)» (édition 1887) par Henri Albert (1869 - 1921) Édition électronique (ePub) v.: 1,0 : Les Échos du Maquis, 2011,aphorisme 9, p.27.
6 Jean-Jacques Rousseau, Lettre à M. de Malesherbes, 1762. Avant-texte des Confessions.
Questions fréquemment posées sur "Ivresse et création"
De quoi parle le texte "Ivresse et création" ?
Le texte explore le lien entre l'ivresse, au sens propre et figuré, et la création artistique. Il examine comment l'état d'ivresse, l'imaginaire poétique et les expériences limites peuvent stimuler l'inspiration et permettre à l'artiste d'accéder à une forme de connaissance de soi à travers son œuvre.
Quels sont les thèmes principaux abordés dans ce texte ?
Les thèmes principaux incluent : l'ivresse dionysiaque, la sublimation, la relation entre plaisir et douleur dans la création, la figure de l'artiste comme être quasi-masochiste, et l'importance de l'énergie créatrice (energeïa).
Qui sont les auteurs et œuvres cités dans ce texte ?
Le texte fait référence à : Baudelaire (pour la citation en exergue), Freud (Au-delà du principe de plaisir), Platon (Le Banquet), Aristophane, Muriel Thiaude, Edmond Nogacki (L'Energie créatrice), Nietzsche (La Naissance de la tragédie, Le Gai Savoir), Goethe (Le chant du prince Vogelfrei), Jackson Pollock, Jean-Jacques Rousseau (Lettre à M. de Malesherbes), Omar Khayam, Abou Nawas, et Alain Robbe-Grillet (Pour un nouveau roman).
Quelle est l'importance du vin dans ce contexte ?
Le vin est présenté comme un symbole puissant d'ivresse et de transformation, à la fois au sens propre et métaphorique. Il est associé au mythe de Dionysos et à la naissance du théâtre antique, et est vu comme un élément central de la tradition mystique et des pouvoirs d'élévation spirituelle.
Comment le texte aborde-t-il la relation entre plaisir et souffrance dans la création ?
Le texte souligne que la création artistique implique souvent une forme de souffrance ou de labeur intense. L'artiste est décrit comme un être qui endure des tourments et des fatigues pour réaliser son œuvre. Cependant, cette souffrance est liée à un plaisir profond, une sorte d'orgasme créatif qui se renouvelle sans cesse.
Quelle est la signification de l' "energeïa" mentionnée dans le texte ?
L' "energeïa" est définie comme une force intérieure propre à chaque créateur, puisée dans la psyché, la tension, le délire mystique ou encore dans les différentes formes de l'ivresse poétique. C'est cette force qui motive l'artiste à persévérer malgré les difficultés.
Quel est le rôle de l'état second ou de l'ivresse poétique dans le processus créatif ?
L'état second, induit par l'ivresse poétique ou d'autres formes d'expérience limite, est présenté comme un moyen d'accéder à une forme de méditation sublime où les vicissitudes du quotidien disparaissent, permettant ainsi à l'artiste de libérer sa créativité.
Comment le texte interprète-t-il la citation de Nietzsche sur Wagner et la musique ?
La citation de Nietzsche souligne l'intensité émotionnelle et la puissance transformatrice de la musique de Wagner, qui peut conduire à une dissolution de l'être à force de plaisir esthétique. Écouter Wagner serait une expérience si intense qu'elle pourrait être comparée à une forme de mort.
Comment le texte illustre-t-il le lien entre le dionysiaque et la création artistique ?
Le texte établit un lien fort entre le dionysiaque, associé à l'ivresse, au chaos et à la transgression, et la création artistique. Le dionysiaque est vu comme une source d'inspiration et d'énergie créatrice, permettant à l'artiste de dépasser les limites de la raison et d'explorer des zones plus profondes de son être.
Qu'est-ce que le texte suggère sur la nature de l'artiste ?
Le texte suggère que l'artiste est une figure complexe et parfois paradoxale, à la fois créateur et souffrant, rationnel et irrationnel. Il est vu comme un médiateur entre le monde ordinaire et une puissance obscure, une sorte de monstre inconscient mais aussi un esprit éternel.
Questions fréquentes
Quel est le lien entre l'ivresse et la création artistique ?
L'ivresse, qu'elle soit poétique ou mystique, est vue comme une force intérieure (energeïa) qui permet à l'artiste de s'élever au-delà du quotidien pour atteindre un état créateur sublime.
Quelle est l'influence de Nietzsche sur cette vision de l'art ?
Nietzsche, à travers "La Naissance de la tragédie", souligne l'importance des sources dionysiaques, où le plaisir esthétique mène à une dissolution de l'être et à une exaltation de la vie.
Pourquoi le vin est-il un symbole si puissant pour les créateurs ?
Le vin est associé au mythe de Dionysos, représentant la consubstantialité de la vie et de la mort, et offrant une puissance transformationnelle qui fascine les poètes comme Omar Khayam ou Baudelaire.
Comment Freud explique-t-il l'acte créateur ?
Freud analyse la création comme une "sublimation", un mode de détournement des pulsions ancestrales (Eros et Thanatos) valorisé par la civilisation.
Quel rôle joue la souffrance dans le travail de l'artiste ?
La création est souvent décrite comme un labeur exquis ou un corps-à-corps masochiste avec l'œuvre, où la douleur et le plaisir sont indissociables pour atteindre la beauté.
- Citation du texte
- Lassaad Jamoussi (Auteur), 2022, Ivresse et création. La joie de créer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282154