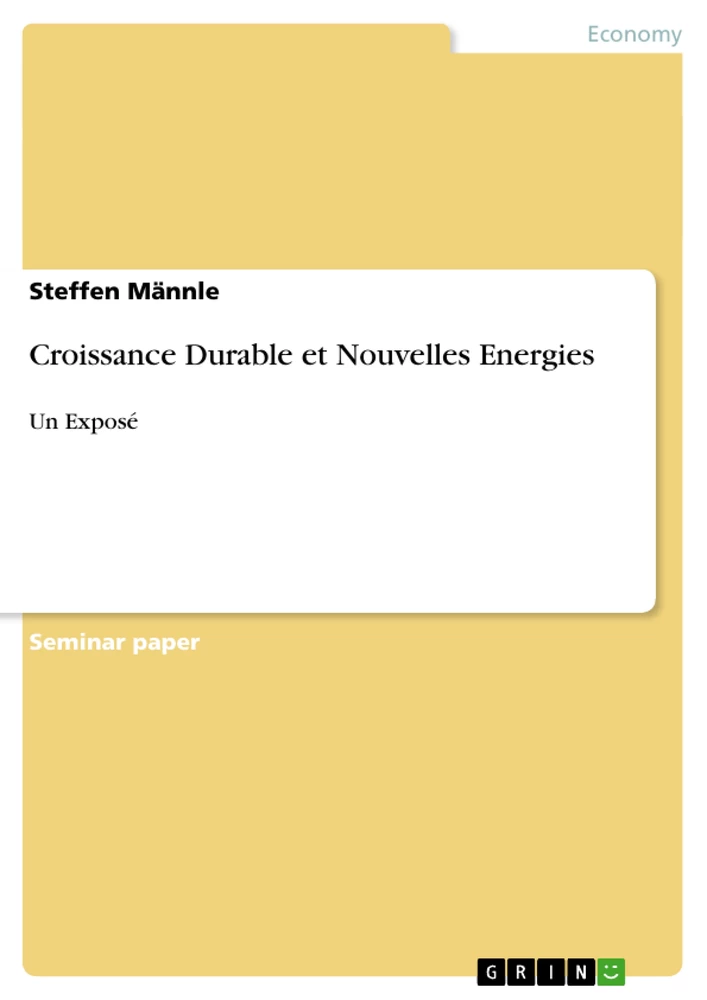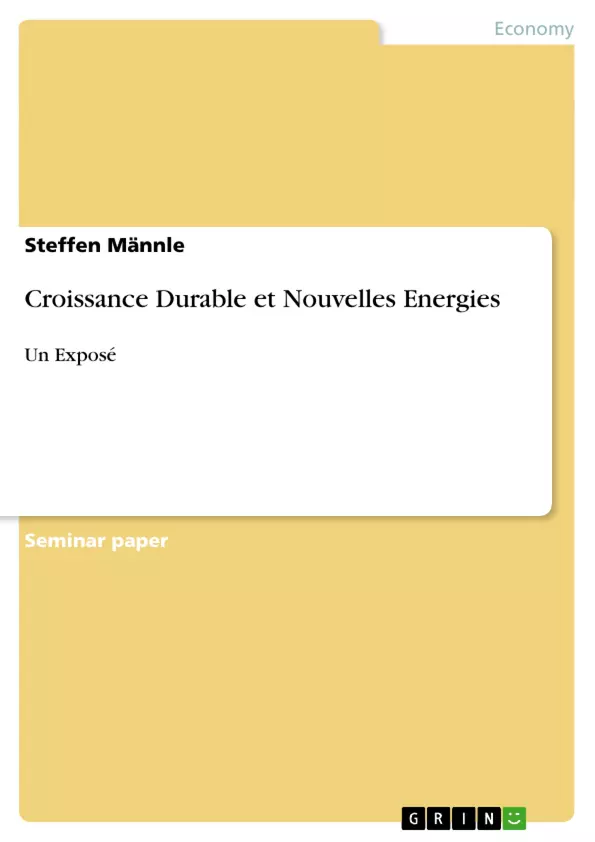Les élites économiques et politiques du monde entier ont compris il y a longtemps le fort lien qui unit croissance économique et sources
de richesse, leur exploitation, leur quantité...
La préoccupation à propos de ces sources de richesse touche le monde occidental dans les années 1970 où est commandé une étude sur l’avenir de la croissance en fonction du niveau de ressources naturelles présent sur le globe: c’est le modèle du club de Rome. Cette manifestation d’inquiétude est la première d’une longue série : on assistera successivement à la conférence de Stockholm, l’émission du rapport « Notre Avenir à Tous » ou encore le Sommet de la Terre à Rio.
Toutes les réflexions issues de ces événements ont permit d’arriver au début des années 1990 à la définition d’un nouveau modèle de développement: le développement durable est un « développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »1. Evidemment, dans la notion de développement est entre autres contenu le concept de croissance : les états actuels doivent soutenir un taux de croissance suffisant pour faire face aux mutations économiques et politiques en marche, mais également penser au taux de croissance des générations futures, tout ceci dans un contexte d’économie mondialisé. Cela revient à dire que l’effort doit également être mondialisé.
Inhaltsverzeichnis
- Croissance Durable et Energies Nouvelles
- Situation actuelle dans le domaine de l'énergie
- Les nouvelles énergies et leur utilisation actuelle
- Technologies actuelles
- Rôle de l'état
- Prototypes à court et moyen terme
- Limites des nouvelles énergies
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Verbindung von nachhaltigem Wachstum und der Entwicklung neuer Energiequellen. Er analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem zunehmenden Verbrauch fossiler Brennstoffe und der Verknappung dieser Ressourcen ergeben.
- Nachhaltiges Wachstum im Kontext der Energieversorgung
- Die Herausforderungen durch die Verknappung fossiler Brennstoffe
- Die Rolle neuer Energietechnologien
- Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung
- Die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt den Leser in die Thematik der nachhaltigen Entwicklung und der Bedeutung von Energie ein. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung und die Notwendigkeit, die Ressourcen unseres Planeten schonend zu nutzen.
Das zweite Kapitel analysiert die aktuelle Situation im Energiesektor. Es zeigt auf, wie stark die Weltwirtschaft von fossilen Brennstoffen abhängig ist und welche Folgen die Verknappung dieser Ressourcen für die Wirtschaft und die Umwelt haben könnte.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung und den Einsatz neuer Energietechnologien. Es beschreibt die verschiedenen Arten von erneuerbaren Energien und deren aktuelle Verbreitung sowie die Herausforderungen und Chancen, die mit ihrer großflächigen Nutzung verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe des Textes sind nachhaltige Entwicklung, Energiepolitik, fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Klimawandel, Globale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Nachhaltiges Wachstum“ im Energiekontext?
Es ist eine Entwicklung, die den Energiebedarf der heutigen Generation deckt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen durch Ressourcenverknappung zu gefährden.
Welche Rolle spielte das Modell des „Club of Rome“?
In den 1970er Jahren warnte diese Studie erstmals umfassend vor den Grenzen des Wachstums angesichts begrenzter natürlicher Ressourcen.
Warum ist der Übergang zu neuen Energien notwendig?
Die starke Abhängigkeit der Weltwirtschaft von fossilen Brennstoffen und deren drohende Verknappung machen alternative Energiequellen unumgänglich.
Welche Grenzen haben neue Energietechnologien?
Die Arbeit analysiert die technologischen, wirtschaftlichen und politischen Hürden, die einer großflächigen Nutzung entgegenstehen.
Was forderte der Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ (Brundtland-Bericht)?
Er definierte Anfang der 1990er Jahre das Konzept des nachhaltigen Wachstums als globale Verpflichtung.
- Arbeit zitieren
- Steffen Männle (Autor:in), 2008, Croissance Durable et Nouvelles Energies, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129017