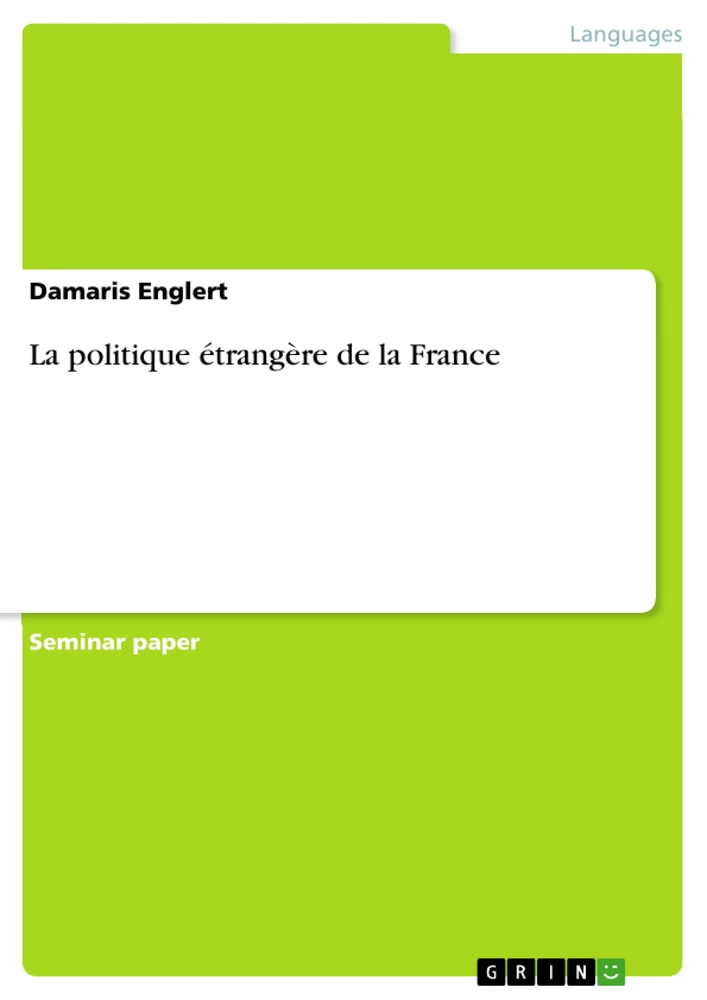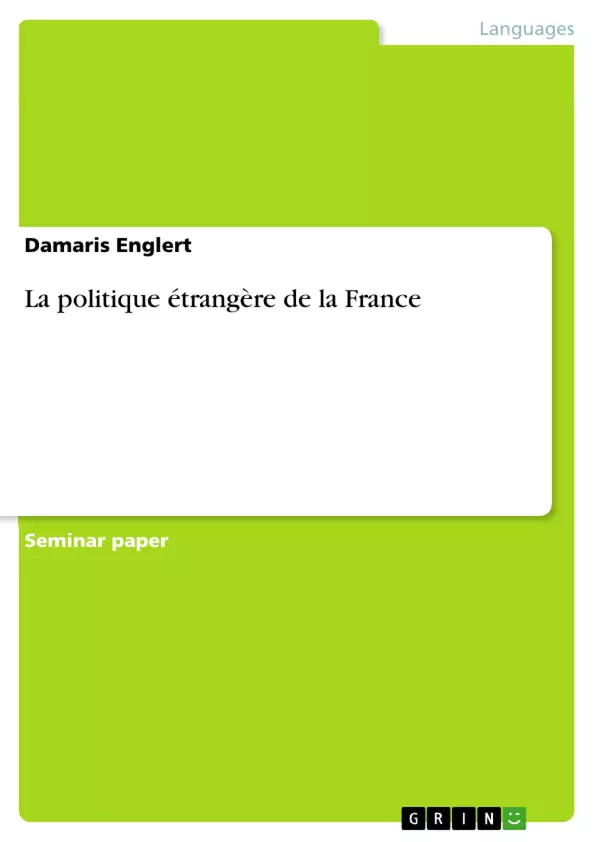La politique extérieure de la France s’ordonne autour de quelques idées simples : l’indépendance nationale, l’équilibre des blocs militaires dans le monde, la construction de l’Europe, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le développement des pays pauvres.
François Mitterrand
Ce bref résumé de la part de François Mitterrand comporte les piliers de la politique étrangère de la France, ce qui constituera le sujet de ce travail. Même si avec l’effondrement de l’URSS la situation mondiale a beaucoup changé, l’attitude française est restée la même : la défense de l’indépendance nationale, la priorité de la construction européenne et l’engagement à l’échelle globale, qu’il soit au sein des grandes organisations comme l’ONU, ou seulement de la part de la France ou encore dans le cadre de la francophonie. Ce sont les points centraux que nous allons faire ressortir afin de présenter la politique étrangère de la France, son développement et ses principaux buts aujourd’hui.
Après avoir expliqué l’administration de la politique étrangère en France, nous allons traiter les domaines d’activités les plus importants de la diplomatie française de nos jours, à savoir la francophonie, l’engagement français dans le monde (en mettant l’accent sur les activités françaises au sein de l’ONU et de l’OTAN) et le rôle de la France en Europe (en présentant la construction européenne ainsi qu’un grand projet français d’actualité : l’Union pour la Méditerranée). Finalement, tout un chapitre sera dédié à l’amitié franco-allemande, son évolution et son importance pour la communauté internationale aujourd’hui.
Ce travail ne prétend pas analyser de façon exhaustive tous les éléments de la politique étrangère française, mais il tentera de donner des réponses aux questions suivantes : Comment est-ce que les relations internationales de la France se sont développées ? Quelles convictions y-a-t-il derrière les décisions prises par la République française ? Et quelle direction pourrait-elle prendre à l’avenir ? Ce sont des questions qui ne sont pas seulement importantes pour la France, mais qui auront sûrement un impact non négligeable, notamment sur l’Allemagne en tant que pays voisin, mais aussi sur toute l’Europe, voire sur le monde entier.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Die Leitung der französischen Außenpolitik
- Die Frankophonie
- Die Beziehungen zu den ehemaligen Kolonien
- Die Organisation der Frankophonie
- Das französische Engagement in der Welt
- Die UNO
- Die NATO
- Frankreich und Europa
- Der europäische Aufbau
- Die Union für den Mittelmeerraum
- Die französisch-deutsche Freundschaft
- Der erbitterte Feind
- Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg
- Versöhnung im Rahmen des europäischen Aufbaus
- Vertrauenswürdige Partner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die französische Außenpolitik, ihre Entwicklung und ihre Hauptziele. Sie analysiert die wichtigsten Bereiche der französischen Diplomatie, die institutionellen Strukturen, und beleuchtet die französisch-deutsche Beziehung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der französischen Außenpolitik zu vermitteln, ohne dabei konkrete politische Schlussfolgerungen vorwegzunehmen.
- Die Organisation und Struktur der französischen Außenpolitik
- Die Rolle der Frankophonie in der französischen Außenpolitik
- Das Engagement Frankreichs in internationalen Organisationen wie der UNO und der NATO
- Frankreichs Rolle im europäischen Aufbau und in der Union für den Mittelmeerraum
- Die Entwicklung der französisch-deutschen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung stellt die grundlegenden Prinzipien der französischen Außenpolitik vor, wie sie von François Mitterrand beschrieben wurden: nationale Unabhängigkeit, globales Machtgleichgewicht, europäische Integration, Selbstbestimmungsrecht der Völker und Entwicklungszusammenarbeit. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die zentralen Fragen, die behandelt werden.
Die Leitung der französischen Außenpolitik: Dieses Kapitel beschreibt die Organisation der französischen Außenpolitik. Das wichtigste Organ ist das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und europäische Angelegenheiten mit seinen verschiedenen Abteilungen und dem Sekretariat. Das Kapitel erläutert die Aufgaben und die internen Strukturen des Ministeriums, inklusive der Rolle des Ministers, der Staatssekretäre und des Sekretariats. Die Rolle des Centre d'analyse et de prévision (CAP) als Forschungs- und Beratungsinstanz wird ebenfalls hervorgehoben.
Die Frankophonie: Dieses Kapitel behandelt die Frankophonie als wichtigen Aspekt der französischen Außenpolitik. Es untersucht die Beziehungen Frankreichs zu seinen ehemaligen Kolonien und die Organisation der Frankophonie selbst. Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung der Frankophonie für die französische Diplomatie und den Einfluss auf die internationale Zusammenarbeit.
Das französische Engagement in der Welt: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem französischen Engagement in der Welt, wobei der Fokus auf der Beteiligung an der UNO und der NATO liegt. Er analysiert die Rolle Frankreichs in diesen Organisationen und wie diese Aktivitäten die französische Außenpolitik prägen. Die Kapitel untersuchen die Strategien und Ziele Frankreichs im Rahmen dieser internationalen Bündnisse.
Frankreich und Europa: Dieses Kapitel untersucht Frankreichs Rolle im europäischen Aufbau und im Projekt der Union für den Mittelmeerraum. Es analysiert die Bedeutung der europäischen Integration für die französische Außenpolitik und untersucht die Ziele und die Umsetzung des Mittelmeerprojekts. Der Schwerpunkt liegt auf Frankreichs strategischen Zielen und seiner Position innerhalb der Europäischen Union.
Die französisch-deutsche Freundschaft: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung der französisch-deutschen Beziehungen, von der erbitterten Feindschaft über die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur heutigen Partnerschaft im Rahmen der europäischen Integration. Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung dieser Beziehung für die europäische und internationale Politik und die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Partnerschaft. Es werden die wichtigsten Meilensteine und Wendepunkte in der Entwicklung dieser Beziehung behandelt.
Schlüsselwörter
Französische Außenpolitik, Frankophonie, UNO, NATO, Europäische Integration, Union für den Mittelmeerraum, französisch-deutsche Beziehungen, nationale Unabhängigkeit, internationale Zusammenarbeit, Diplomatie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Französische Außenpolitik
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die französische Außenpolitik. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Organisation und Struktur der französischen Außenpolitik, der Rolle der Frankophonie, dem Engagement in internationalen Organisationen (UNO, NATO), Frankreichs Rolle in Europa (inkl. Mittelmeerunion) und der Entwicklung der französisch-deutschen Beziehungen.
Welche Kapitel sind enthalten?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Leitung der französischen Außenpolitik, Die Frankophonie (inkl. Beziehungen zu ehemaligen Kolonien und Organisation der Frankophonie), Das französische Engagement in der Welt (UNO und NATO), Frankreich und Europa (Europäischer Aufbau und Union für den Mittelmeerraum), und Die französisch-deutsche Freundschaft (von Feindschaft zur heutigen Partnerschaft).
Was sind die Hauptziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis der französischen Außenpolitik zu vermitteln. Es werden die wichtigsten Bereiche der französischen Diplomatie, die institutionellen Strukturen und die französisch-deutsche Beziehung analysiert. Konkrete politische Schlussfolgerungen werden jedoch nicht gezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Organisation und Struktur der französischen Außenpolitik; Die Rolle der Frankophonie in der französischen Außenpolitik; Das Engagement Frankreichs in internationalen Organisationen wie der UNO und der NATO; Frankreichs Rolle im europäischen Aufbau und in der Union für den Mittelmeerraum; Die Entwicklung der französisch-deutschen Beziehungen.
Wie wird die Leitung der französischen Außenpolitik beschrieben?
Das Kapitel beschreibt die Organisation der französischen Außenpolitik, mit dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und europäische Angelegenheiten als wichtigstes Organ. Es erläutert die Aufgaben und internen Strukturen des Ministeriums, inklusive der Rolle des Ministers, der Staatssekretäre und des Sekretariats, sowie die Rolle des Centre d'analyse et de prévision (CAP).
Welche Rolle spielt die Frankophonie in der französischen Außenpolitik?
Die Frankophonie wird als wichtiger Aspekt der französischen Außenpolitik behandelt. Das Kapitel untersucht die Beziehungen Frankreichs zu seinen ehemaligen Kolonien und die Organisation der Frankophonie selbst, mit Fokus auf deren Bedeutung für die französische Diplomatie und die internationale Zusammenarbeit.
Wie wird das französische Engagement in der UNO und der NATO dargestellt?
Der Abschnitt analysiert Frankreichs Rolle in der UNO und der NATO und wie diese Aktivitäten die französische Außenpolitik prägen. Es werden die Strategien und Ziele Frankreichs im Rahmen dieser internationalen Bündnisse untersucht.
Welche Rolle spielt Frankreich im europäischen Aufbau und in der Union für den Mittelmeerraum?
Das Kapitel analysiert die Bedeutung der europäischen Integration für die französische Außenpolitik und untersucht die Ziele und Umsetzung des Mittelmeerprojekts. Der Schwerpunkt liegt auf Frankreichs strategischen Zielen und seiner Position innerhalb der Europäischen Union.
Wie werden die französisch-deutschen Beziehungen dargestellt?
Das Kapitel behandelt die historische Entwicklung der französisch-deutschen Beziehungen, von der Feindschaft über die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur heutigen Partnerschaft. Es konzentriert sich auf die Bedeutung dieser Beziehung für die europäische und internationale Politik und die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Partnerschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Französische Außenpolitik, Frankophonie, UNO, NATO, Europäische Integration, Union für den Mittelmeerraum, französisch-deutsche Beziehungen, nationale Unabhängigkeit, internationale Zusammenarbeit, Diplomatie.
- Quote paper
- B.A. Damaris Englert (Author), 2009, La politique étrangère de la France, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152116