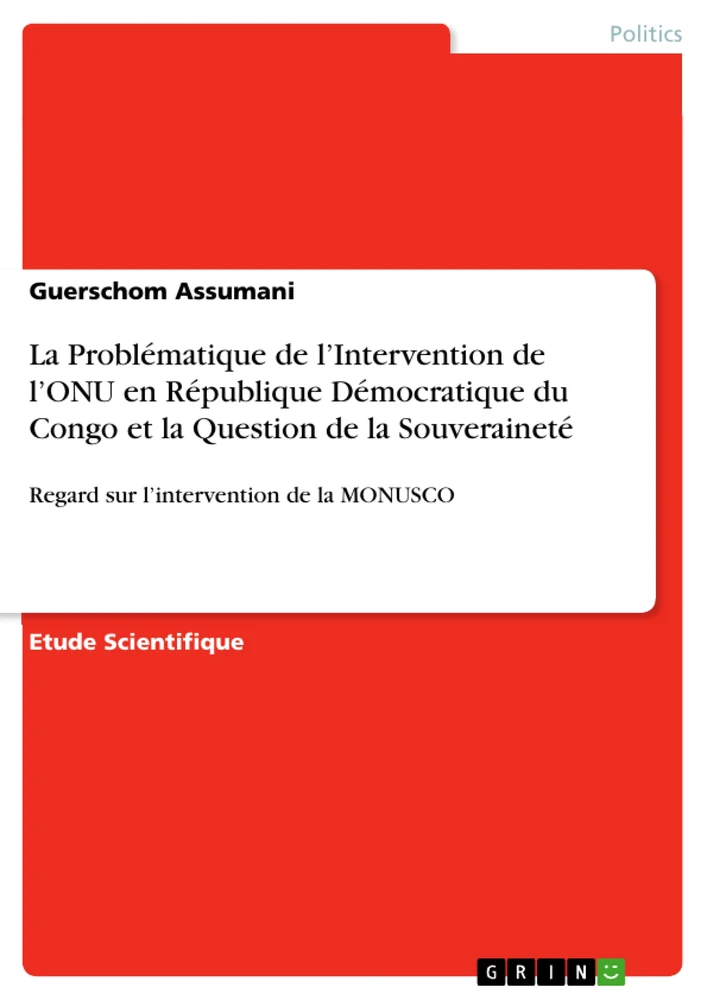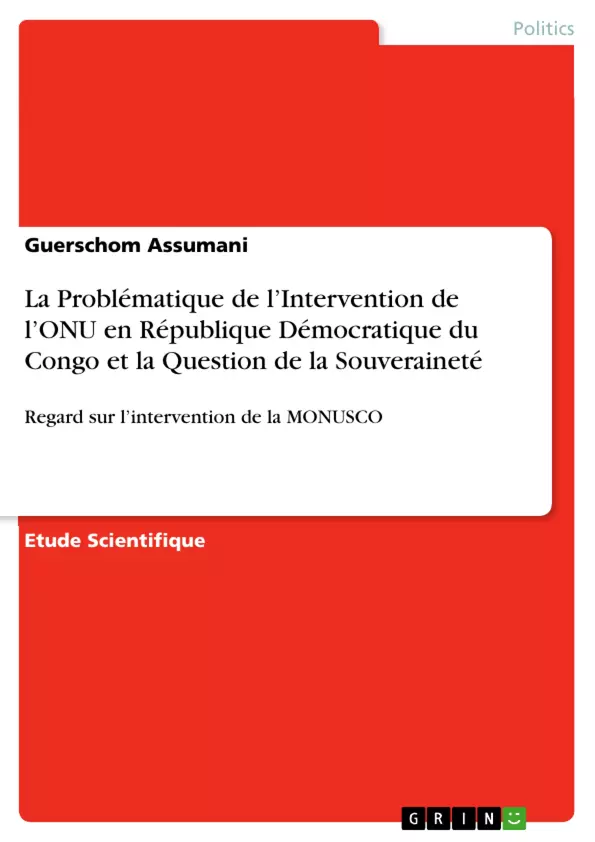Depuis l’Antiquité, la question relative à la liberté et à l’indépendance des Etats et des hommes reste une quête permanente au monde. La République Démocratique du Congo, un Etat en pleine reconstruction, n’en est pas épargnée. La création des institutions supranationales et l’unité politique plus large de commandement qui consistent à réduire l’indépendance des Etats et le nombre des acteurs capables d’influencer le club des décideurs nous amène entant que chercheurs en Sciences Sociales à focaliser notre réflexion sur les enjeux relatifs à la notion de souveraineté mais en nous préoccupant surtout de l’avenir de la République Démocratique du Congo, un Etat dans un monde en mutation. Le rôle des Etats est aujourd’hui réduit à une simple entité d’exécution face aux théories de la mondialisation (globalisation) et le droit d’ingérence considéré comme le transfert d’une parcelle de pouvoir au profit des structures supranationales. Cette étude se propose d'examiner les faiblesses de la souveraineté au prise des implications de l'intervention de la MONUSCO en République Démocratique du Congo.
Table des matières
Introduction
I. Generalities
I.1. Concept « souveraineté » : origine strictement politique
I.1.1. L’inexistence du concept de souveraineté sous l'ère antique
I.1.2. Des raisons historiques et politiques qui expliquent l'émergence du concept de souveraineté au Moyen-âge
I.2. La souveraineté limitée
II. Impact De L’Intervention De La Monusco Sur La Souverainete De La RDC
II.1. Missions de la MONUSCO
II.2. Réalisations de la MONUSCO
II.2.1. Son mandat et ses objectifs
II.3. Regard sur l’intervention de la MONUSCO
II.3. Les limites du mandat de la MONUSCO
1 .2. Un éternel recommencement
Conclusion
Bibliographie
Introduction
Depuis l’Antiquité, la question relative à la liberté et à l’indépendance des Etats et des hommes reste une quête permanente au monde. La République Démocratique du Congo, un Etat en pleine reconstruction, n’en est pas épargnée. La création des institutions supranationales et l’unité politique plus large de commandement qui consistent à réduire l’indépendance des Etats et le nombre des acteurs capables d’influencer le club des décideurs nous amène entant que chercheurs en Sciences Sociales à focaliser notre réflexion sur les enjeux relatifs à la notion de souveraineté mais en nous préoccupant surtout de l’avenir de la République Démocratique du Congo, un Etat dans un monde en mutation. Le rôle des Etats est aujourd’hui réduit à une simple entité d’exécution face aux théories de la mondialisation (globalisation) et le droit d’ingérence considéré comme le transfert d’une parcelle de pouvoir au profit des structures supranationales.
En plus de l’introduction et la conclusion, travail est subdivisé en deux points. Le premier point présente quelques notions se rapportant à la souveraineté et à l’intervention de la MONUSCO et le second aborde la cohabitation entre les forces militaires onusiennes et les Forces Armées de la RDC.
I. Generalities
I.1. Concept « souveraineté » : origine strictement politique
«La souveraineté ne peut se comprendre que par les luttes que l'Etat livre, au cours de l'histoire, pour la justification de son existence1 ». Jellinek commence son analyse du concept de souveraineté par une rapide étude historique. Celle-ci lui permet de dresser le constat suivant: la souveraineté est une notion qui n'existait pas sous l'Antiquité. Si le concept «d'autarcie», développé par Aristote à cette époque, paraît être proche de celui de «souveraineté», il n'en possède pas les mêmes caractéristiques et ne doit vraisemblablement pas y être assimilé. Ainsi, l'Etat Grec et l'Etat Romain étaient bien des Etats, bien que le concept de souveraineté n'ait alors pas encore été développé.
Ce n'est que durant le Moyen-âge, pour des raisons éminemment politiques, que le concept de souveraineté, dans la forme que nous lui attribuons aujourd'hui, voit véritablement le jour. Dans son analyse, Georg Jellinek insiste sur le fait que la souveraineté n'est pas une catégorie «absolue» mais simplement historique, qui a été «inventée », dans un contexte particulier, pour des raisons spécifiques. Il s'agissait de faire valoir le droit des princes face aux autres autorités politiques médiévales, l'Eglise, l'Empereur et les seigneurs féodaux. Pour cette raison, ce sont les faits qui ont «poussé» à la création de la souveraineté, concept développé dans un but qui, à l'origine, était exclusivement politique.
I.1.1. L’inexistence du concept de souveraineté sous l'ère antique
Etymologiquement, la notion de «souveraineté» n'est apparue, dans la forme qu'on lui connaît, qu'au cours du 12ème siècle. Son origine semble être le terme de «superanus », qui provient du latin médiéval2.
Cette brève chronique étymologique confirme la théorie selon laquelle la souveraineté est un concept qui ne prend ses racines qu'au Moyen-âge et qui n'existait pas sous l'ère antique.
Le caractère propre de l'Etat antique, celui qui le distingue de toutes les autres sortes de communauté humaine, c'est, pour Aristote, l'autarchie. Mais cette notion antique n'a absolument rien à voir avec la notion moderne de souveraineté. Littéralement, cette notion désigne la propriété de «se suffire à soi-même»3. La notion d'«autarcie» est effectivement empruntée du grec «autarcia», qui signifie «gouvernement assuré par les citoyens mêmes »4. Ainsi, comme le précise le juriste Heidelberg, «l'Etat doit être constitué de telle sorte qu'il n'ait pas besoin d'après sa nature d'une communauté qui le complète »5. L'autarcie est un concept particulier, lié au contexte antique.
Cependant, il existe une différence majeure entre la notion de souveraineté, développée à partir du Moyen-âge, que nous aurons l'occasion de développer par la suite, et la notion antique d'autarchie : à l'époque antique, il «n'est nullement contraire à son essence (l'essence de l'Etat) qu'il se trouve en fait dépendre, sous tel ou tel rapport, d'une autre communauté. Il faut seulement qu'il y ait pour lui la possibilité de subsister indépendamment de cet Etat supérieur, qui, par conséquent, ne doit pas être une condition nécessaire de son existence»6. Jellinek précise que ce n'est qu'Aristote, dans son ouvrage « La politique », qui réclame l'indépendance de l'Etat en puissance et en acte. En réalité, l'indépendance totale de l'Etat par rapport à un autre Etat n'est pas une condition stricte posée par l'autarcie. A l'époque antique, l'Etat, pour être considéré comme tel, n'a pas à remplir cette condition d'indépendance, alors même que cette indépendance sera l'élément principal caractérisant la souveraineté à partir du Moyen-âge.
Une des différences fondamentales séparant l'autarcie de la souveraineté est la suivante: «l'autarcie n'est pas une catégorie juridique, mais une catégorie morale: elle est la condition essentielle dont dépend la réalisation du but de l'Etat, la réalisation de la vie parfaite. Elle a ses racines profondes dans l'opinion des Grecs sur le monde et la vie ». En conséquence, cette notion «ne nous renseigne d'aucune façon sur la manière dont l'Etat doit librement se conduire quant à ses actes et à ses abstentions, sur son droit et son administration, sur sa politique intérieure et extérieure». Notion purement morale, l'autarcie ne donne qu'une idée de l'Etat idéal tel qu'il était conçu à l'époque antique. Contrairement à la souveraineté, l'autarcie n'engendre aucune conséquence juridique ou politique précise. D'ailleurs, comme le montre Jellinek, le terme d'autarcie sera, par la suite, utilisé par les Stoïciens comme un concept qui devient la «marque essentielle de l'individu idéal du sage le plus haut point de perfection que peut se proposer d'atteindre l'individu qui seule assure la vertu, dont la possession rend l'homme indépendant du monde extérieur et lui permet d'accomplir toujours rigoureusement la règle morale ».
I.1.2. Des raisons historiques et politiques qui expliquent l'émergence du concept de souveraineté au Moyen-âge
«Ce ne sont pas des savants étrangers au monde, qui ont découvert ce concept souveraineté au fond de leur cabinet d'étude, ce sont des pouvoirs puissants, des pouvoirs dont les luttes ont rempli des siècles, qui l'ont mis au jour. Ce processus historique n'a jamais été, jusqu'ici, décrit avec certitude »7. Jellinek insiste sur les origines du concept de souveraineté : il est le fait des politiques qui ont souhaité imposer leur vision du monde, notamment asseoir l'autorité et les pouvoirs du roi de France.
La souveraineté est, selon lui, un «concept polémique» qui, après avoir été de «nature défensive», est «devenu, au fil du temps, de nature offensive»8.
Au Moyen-âge, dans le conflit qui oppose l'Eglise à l'Etat, plusieurs opinions différentes s'affrontent quant à savoir qui, de l'Etat ou de l'Eglise est supérieur. Les opinions se prononcent soit en faveur de l'Etat, soit en faveur de l'Eglise. C'est surtout dans la « dernière période du Moyen-âge, grâce à la France, que l'idée de la prééminence du pouvoir de l'Etat est devenu un fait historique », par le fait que «la papauté d'Avignon admet la supériorité de l'Etat sur l'Eglise ». Ainsi, en France, on en vient à «affirmer la pleine indépendance de l'Etat à l'égard des ordres de l'Eglise »9. C'est dans ce contexte, lors de la lutte entre le roi Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, comme le note Jellinek, que naissent les écrits qui s'engagent en faveur de l'Etat dans sa lutte face au pouvoir ecclésiastique.
La théorie juridique érigeant l'Empereur en chef incontesté du monde occidental est en effet contestée par certains Etats, comme la France et l'Angleterre, qui ne tiennent pas compte de la suprématie impériale. Ainsi « la théorie se voit forcément contrainte de tenir compte de ces prétentions étatiques» et le fait en appuyant ce « droit à l'indépendance », qui est accordé en vertu d'un « privilège impérial ». Ainsi, « l'indépendance prétendue n'est jamais déduite de la nature même de l'Etat », et l'Empereur conserve le « privilège exclusif de concéder le titre de roi, et par suite les prérogatives qui sont attachées à ce titre par la doctrine juridique dominante ».
En fait, c'est en France que cette double dualité Etat/Eglise et Etat/Empire est clairement visible : selon «l'intime conviction juridique» du peuple français, le roi ne peut avoir de suzerain au-dessus de lui, que ce soit Dieu ou l'Empereur. « Ainsi se trouve, pour la première fois, formulé le principe de l'indépendance royale »10. L'intime conviction du peuple érige le roi en maître indépendant du pouvoir impérial. Or, comme nous l'avons déjà vu, le droit, en dernière instance, résulte de la conviction dominante à une époque donnée. C'est au Moyen-âge que se situe ce changement de paradigme : l'opinion dominante tend à considérer le roi comme seul détenteur du pouvoir, qu'il ne détient plus en vertu d'un titre impérial, mais à raison de son autorité propre.
Outre cette double dualité Etat/Eglise et Etat/Empire, le théoricien de Heidelberg rappelle que la médiatisation du pouvoir, par le système de la féodalité, a également ralenti l'avènement de l'Etat moderne. On voit se dresser des «personnalités de droit public qui ne tiennent leurs droits que d'elles-mêmes, dont le droit n'est pas subordonné aux prescriptions de l'Etat »11: le seigneur peut ainsi rendre la justice, en lieu et place du roi et entrer en commerce avec la population. En conséquence, le royaume se morcelle et l'idée de l'unité de l'Etat est réduite à peau de chagrin.
La théorie n'a longtemps pas pris en compte la notion de souveraineté puis l'a admise, logiquement, oubliant de préciser qu'elle n'est que le résultat des querelles politiques et historiques, le produit des dualités médiévales opposant l'Etat à l'Empereur, à l'Eglise, et au système féodal morcelant son propre territoire. L'Etat, en proclamant son unité, en affirmant son indépendance, a acquis la souveraineté comme un élément inhérent à sa qualité même d'Etat. Loyseau ira même jusqu'à déclarer que «la souveraineté est du tout inséparable de l'Etat. La souveraineté est la forme qui donne l'être à l'Etat »12.
La souveraineté est donc un concept juridique «récent», polémique, dont les racines remontent au Moyen-âge, et n'a été mis en avant, à l'origine, dans l'objectif de nier les pouvoirs des autres autorités s'opposant à la royauté. La souveraineté n'est donc pas consubstantielle à l'Etat. Elle est un concept circonstancié, que les théories politiques ont érigé en concept «absolu», afin de servir les ambitions du roi et de favoriser son indépendance.
Car, n'oublions pas, comme le dit très bien Michel Foucault, qu'il existe un «principe général en ce qui concerne les rapports du droit et du pouvoir. Dans les sociétés occidentales, et ceci depuis le Moyen-âge, l'élaboration de la pensée juridique s'est faite essentiellement autour du pouvoir royal. C'est à la demande du pouvoir royal, c'est également à son profit, c'est pour lui servir d'instrument ou de justification que s'est élaboré l'édifice juridique de nos sociétés »13.
Selon le dictionnaire Universel, la souveraineté est une « autorité suprême ou un principe d’autorité suprême ».14 Le petit dictionnaire Politique va plus loin. Par souveraineté, il faut entendre « l’indépendance politique totale et l’autonomie de l’Etat dans les affaires intérieures ainsi que dans les relations extérieures, excluant toute interférence extérieure »15. C’est donc la qualité indiscutable et inaliénable des Etats, indépendamment de la dimension physique de leur territoire, de la démographie et de l’ordre socio-politique qui y existe. L’inaliénabilité de la souveraineté des Etats implique donc sa non limitation de manière absolue en droit et en relations internationales La souveraineté revêt une double dimension : interne et externe. La souveraineté de l’Etat comprend aussi le monopole de l’usage de la contrainte légitime à la fois à l’intérieur, à l’égard des personnes établies où transitant sur son territoire, ce qui correspond à la souveraineté territoriale de l’Etat et à l’extérieur, à l’encontre des autres entités souveraines de l’ordre international afin de défendre sa propre souveraineté.16 Nulle personne ne saurait en son sein, user de la force sans son consentement et sans son contrôle, sans remettre gravement en cause le caractère souverain de l’Etat. Le monopole de l’usage légal du pouvoir coercitif constitue la raison même de la naissance de l’Etat au-dessus de la société, en vue de préserver la sécurité de tous. Dans la pensée de Thomas Hobbes (Léviathan, 1651), ce monopole réside au cœur de la définition que le sociologue allemand Max Weber donne de l’Etat moderne.
Sur le plan interne, la souveraineté de l’Etat implique que celui-ci ne soit subordonné à aucune autre personne morale ou physique en son sein et hors de lui. Le souverain détient un pouvoir originaire. C’est-à-dire qui n’émane que de lui-même et qui l’autorise à édicter ses propres règles, lois et règlements librement sans considération des règles extérieures à lui. Ce pouvoir est en outre illimité. Il peut s’exprimer dans tout le domaine. C’est pourquoi la pensée politique a tenté de rechercher des fondements à la limitation ou à l’autonomisation du pouvoir souverain.
I.2. La souveraineté limitée
Depuis la nuit de temps, la notion de souveraineté a toujours fait l’objet d’une préoccupation particulière dans les milieux des juristes et des politologues et internationalistes. Déjà au 18eme siècle, certains écrits d’Emmanuel KANT pour qui la révolution Française de 1789 servit abondamment de promontoire et d’observatoire faisaient allusion à la souveraineté.17
Pour ce qui est de l’Afrique, la notion de souveraineté se trouve propulsée au-devant de la scène pour occuper la totalité de l’espace du discours politique à l’occasion des indépendances et de l’inauguration du cycle des « conférences nationales souveraines » dans les années 60 et 90. La question de la souveraineté constitue l’une des problématiques fondamentales de la pensée et de la philosophie politiques des temps modernes. Remontons à E. KANT pour essayer d’expliciter la notion de souveraineté en général, celle de la souveraineté limité ensuite pour déterminer l’opérationnalité.
Le grand maitre de la philosophie allemande affirme qu’il existe une puissance suprême illimitée qu’il nomme souveraineté. Seule la volonté commune peut avoir cette puissance suprême. Elle ne peut pas commettre une justice. Plus loin, il ajoute qu’il ne peut y avoir ici d’autre volonté que celle du peuple entier où tous se prononcent pour tous et, par conséquent, chacun pour soi-même. Car, poursuit KANT, personne ne peut se faire d’injustice à soi-même. La lecture attentive de cette réflexion nous fixe sur deux faits : la nature et la condition de l’effectivité de la souveraineté.
II. Impact De L’Intervention De La Monusco Sur La Souverainete De La RDC
De prime à bord, nous allons tenter de nous appesantir sur les missions de la MONUSCO, ses interventions avant d’en arriver à l’impact de ces dernières sur la souveraineté de la République Démocratique du Congo.
II.1. Missions de la MONUSCO
Les missions assignées à la MONUSCO sont libellées dans la Résolution 1925 (2010) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6324e séance, le 28 mai 2010.18 Nous trouvons par exemple les dispositions suivantes :
a) Assurer la protection effective des civils, y compris le personnel humanitaire et le personnel chargé de défendre les droits de l’homme, se trouvant sous la menace imminente de violences physiques, en particulier de violences qui seraient le fait de l’une quelconque des parties au conflit;
b) Assurer la protection du personnel et des locaux, des installations et du matériel des Nations Unies;
c) Soutenir l’action que mène le Gouvernement de la République démocratique du Congo pour protéger les civils contre les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme, y compris toutes les formes de violence sexuelle et sexiste, pour promouvoir et protéger les droits de l’homme et pour lutter contre l’impunité, y compris en appliquant sa politique de « tolérance zéro » en ce qui concerne les manquements à la discipline et les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire commis par des éléments des forces de sécurité, en particulier les éléments qui y sont nouvellement intégrés;
d) Appuyer l’action menée aux niveaux national et international pour que les auteurs de ces violations soient traduits en justice, notamment en mettant en place des cellules d’appui aux poursuites judiciaires pour aider les autorités des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) chargées de la justice militaire à poursuivre les personnes arrêtées par les FARDC;
e) Collaborer étroitement avec le Gouvernement pour s’assurer de la réalisation de ses engagements pour empêcher que des sévices graves ne soient infligés à des enfants, et en particulier de la finalisation du Plan d’action visant à ce que les enfants qui se trouvent dans les rangs des FARDC soient libérés et qu’il n’y ait pas de nouveaux recrutements, avec l’appui du Mécanisme de surveillance et de communication de l’information;
f) Appliquer la stratégie du système des Nations Unies pour la protection des civils en République démocratique du Congo en lui donnant effet au moyen d’une stratégie de protection de la MONUSCO reposant sur les meilleures pratiques et reproduire les mesures de protection efficaces, comme l’utilisation d’équipes conjointes de protection, d’interprètes de proximité, d’équipes mixtes d’investigation, de centres de surveillance et de conseillers pour la protection des femmes;
g) Appuyer les efforts que déploie le Gouvernement, de concert avec les partenaires internationaux et les pays voisins, pour créer des conditions qui permettent aux personnes déplacées et aux réfugiés de rentrer chez eux librement, en toute sécurité et dans la dignité, ou de s’intégrer ou de se réinstaller volontairement sur place.
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son président sur la République démocratique du Congo, Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la République démocratique du Congo, Prenant acte des progrès réalisés en République démocratique du Congo, compte tenu des défis que le pays a eu à surmonter ces 15 dernières années,
II.2. Réalisations de la MONUSCO
Il sied de souligner que, les réalisations de la MONUSCO restent intimement liées au mandat de ladite mission. C’est ainsi que, nous présentons son mandat et ses réalisations.
II.2.1. Son mandat et ses objectifs
Le 1er juillet 2010, par la résolution 1925 (2010), le Conseil de sécurité a rebaptisé la MONUC Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) compte tenu de l'entrée du pays dans une nouvelle phase.
La nouvelle Mission a été autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat, à savoir notamment garantir la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme exposés à une menace imminente des violences physiques, aider le gouvernement de la RDC à stabiliser et à consolider la paix.
Le Conseil a décidé que la MONUSCO comprendrait, en sus des composantes civile, judiciaire et pénitentiaire appropriées, un effectif maximal de 19 815 soldats, 760 observateurs militaires, 391 fonctionnaires de police et 1 050 membres d'unités de police constituées. Les reconfigurations futures de la Mission seront fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, en particulier de l'achèvement des opérations militaires en cours dans les Kivus et dans la province Orientale, de l'amélioration des moyens dont dispose le gouvernement de la République démocratique du Congo pour protéger efficacement la population, et du renforcement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire.
II.2.1.1. Réalisations
Bien qu'il ne soit pas facile d'énumérer les réalisations d'une mission qui n'est pas encore arrivée au terme de son mandat, nous pouvons cependant signaler que la MONUSCO a réalisé certaines activités en accompagnement à celles du gouvernement:
- L'appui logistique aux Forces Armées de la RDC ;
- La collaboration de Police de la MONUSCO avec la PNC dans le domaine du renforcement de la sécurité ;
- Dans le cadre des infrastructures, le programme STAREC dans lequel prennent part des autorités de la RDC ainsi que celles de la MONUSCO a participé à la réhabilitation des infrastructures pénitentiaires, des cours et tribunaux ainsi que des bâtiments administratifs ;
- La CENI a bénéficié d'un appui substantiel dans le cadre de ses activités électorales telle que la formation des agents électoraux ainsi que dans celui de la logistique notamment le transport des kits électoraux à travers le pays.19
II.3. Regard sur l’intervention de la MONUSCO
Cette partie fait appel à l'histoire politique du Congo. Il s'agit de l'examen des trois interventions de l'ONU en RDCongo au regard de leurs différents mandats nous permettant de jeter le jalon sur le mandat de la MONUSCO aux fins d'une appréhension plus claire du phénomène sous examen.
Hier comme aujourd'hui, il y a lieu de retenir deux grandes leçons de l'histoire :
Primo : Les Nations Unies semblent gérer la crise congolaise avec les mêmes erreurs : inaction et obstination à résoudre par des mécanismes internes un conflit international.
Secundo : L'analyse juridico-politique des Tables Rondes et l'expérience de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) démontrent à suffisance que, bien qu'indispensable, la viabilité d'une construction engendrée par le dialogue était souvent sujette à caution. Ces appréhensions ne préjugent en rien le résultat final de la mission de l'ONU au Congo20.
II.3.1. Le contenu du mandat de la MONUSCO
Ici nous allons présenter le mandat de cette mission conformément à la Résolution 1325 et la Résolution 2098 du Conseil de Sécurité.
II.3.1.2. La résolution 1325 du conseil de sécurité
Le conseil de sécurité axe le mandat de la MONUSCO sur deux priorités majeures : la protection des civils et la stabilisation ainsi que la consolidation de la paix.
II.3.1.3. La protection des civils
La résolution 1925 place une nouvelle fois la protection des populations civiles au cœur du mandat de la MONUSCO, comme ce fut le cas avec la MONUC. La résolution souligne clairement que « la protection des civils doit être la priorité lorsqu'il s'agit de décider de l'usage des capacités et ressources disponibles ». Elle autorise la mission à « utiliser tous les moyens nécessaires, dans les limites de ses capacités et dans les zones où ses unités sont déployées, pour s'acquitter de son mandat de protection ».
Le conseil précise que la MONUSCO doit assurer la protection effective de civils y compris le personnel humanitaire et le personnel chargé de défendre les droits de l'homme se trouvant sous menace imminente des violences physiques, en particulier des violences qui seraient le fait de parties au conflit.
Le reste du mandat dévolu à la MONUSCO dans le cadre de son mandat de protection, viennent notamment en suite ou aux actions du gouvernement, à qui revient en premier lieu, la responsabilité de protéger sa population. Ainsi, la MONUSCO est chargée de:
- Soutenir l'action que mène le Gouvernement de la RDC pour protéger les civils contre les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, y compris toutes les formes de violence sexuelle et sexiste, pour promouvoir et protéger, les droits de l'homme et pour lutte contre l'impunité ;
- Appuyer l'action menée au niveau national et international pour que les auteurs de ces violences soient traduits en justice ;
- Collaborer étroitement avec le Gouvernement pour s'assurer de la réalisation de ses engagements pour empêcher que des sévices graves ne soient infligés à des enfants ;
- Appuyer les efforts que le gouvernement fournit, de concert avec les partenaires internationaux et le pays voisins, pour créer des conditions qui permettent aux personnes déplacées et aux réfugies de rentrer chez eux librement, en toute dignité, ou de s'intégrer ou se réinstaller volontairement sur place ;
- Soutenir l'action que mène le gouvernement de la RDC pour conduire à bonne fin les opérations militaires en cours contre les FDLR, l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) et d'autres groupes armés.
- Appuyer l'achèvement des activités de DDR des groupes armés congolais, ou leur intégration effective dans l'armée, dès lors qu'ils auront été formés et équipés de façon appropriée,
- Appuyer les activités de DDRRR des membres des groupes armés étrangers, y compris des FDLR et de la LRA, menées dans l'est du pays.
II.3.1 .4. Stabilisation et consolidation de la paix
La stabilisation est certainement la nouveauté fondamentale introduite dans le mandat de la mission de nations unies en RDC. Il s'agit, pour la mission, de capitaliser en RDC, maintenir le cap sur le relèvement du pays après 15 années de conflit et aider à la consolidation de la paix et de la sécurité dans le pays.
Pour consolider les acquis, le conseil de sécurité charge la MONUSCO d'appuyer l'action que mènent les autorités congolaises pour renforcer et réformer les institutions de sécurité et l'appareil judiciaire. La MONUSCO aidera le Gouvernement de la RDC à renforcer ses capacités militaires, y compris la justice militaire et la police militaires et, si le Gouvernement en fait la demande, aidera à former les bataillons des FARDC et de la police militaires, y compris, la justice militaire, soutiendra les institutions de justice militaire. La réforme de la police, de la justice et le renforcement de l'autorité de l'Etat sur le territoire libéré des groupes armés sont autant d'actions que devra appuyer la MONUSCO. Néanmoins, cette mission a aussi ses limites.
II.3. Les limites du mandat de la MONUSCO
En abordant cet article, nous avons décelé l'existence de plusieurs faiblesses inhérentes à l'exécution du mandat de la mission sur le terrain en RDC et beaucoup plus particulièrement à l'est du pays. Ces contraintes ou faiblesses sont dénommées limites du mandat de la MONUSCO. Plusieurs idées préconçues circulent au sein de l'opinion en RDC et même à l'étranger ; c'est ainsi que certains enquêtés affirment à ce sujet que la MONUSCO serait :
Responsable de tous les maux
Tous les acteurs et observateurs, journalistes, politiques, diplomates, humanitaires, groupes armés, civils et même ceux qui y travaillent, critiquent la MONUSCO, son mandat, ses lourdeurs administratives, ses choix stratégiques, avant même de balayer devant leur propre porte. Des critiques objectives, les casques bleus n'arrivent souvent même pas à protéger les civils qui se trouvent autour de leur base. Des fantasmes aussi : ils seraient là pour piller les ressources du pays, pour soutenir le Rwanda ou seraient complices des atrocités commises par l'armée congolaise et beaucoup plus en train de préparer la balkanisation du pays bref, une mafia organisée.
« C'est paradoxal, demandez à un civil congolais, ce qu'il pense de la MONUSCO et il va multiplier les critiques. Et pourtant si l'Onu essaie de retirer l'un de ses contingents ou de fermer l'une de ses bases, il y a des manifestations de protestation ».21 Il y a aussi eu bien sûr des manifestations contre la MONUSCO, accusée le plus souvent d'être inefficace, inapte à protéger les civils. Mais c'est toujours vers la force de L'ONU que se tourne la population menacé jusqu'à tenter d'entrer de force dans la base la plus proche.
1.2. Un éternel recommencement
Au fait, à l'est du Congo, rien ne semble véritablement changer. Les rebellions et les groupes armés sont toujours actifs, ils changent de noms, parfois d'alliances. Les civils continuent de se déplacer en masse. Le pays compte plus de 2 millions de déplacés internes se trouvant pour l'essentiel dans le Kivu.
Depuis l’arrivée des premiers casques bleus sur le sol congolais en 1999, le mandat de la mission a considérablement évolué. Aujourd'hui, toutes ses forces sont concentrées à l'Est. La résolution 1925, adoptée en mai 2010, rétrocède au gouvernement congolais, issu des élections, la responsabilité première de la protection des civils, même si cela fait toujours partie du mandat de la MONUSCO. Elle doit surtout assurer la protection des personnels onusiens et des humanitaires en réduisant la menace que constituent les groupes armés, aider à la restauration de l'autorité de l'État, insister sur la réforme du secteur de la sécurité, entre autres. « Un inventaire à la Prévert », commente Séverine Autesserre. Son mandat a été prorogé à plusieurs reprises, la dernière fois en juin 201222. 13 ans déjà de présence et il est difficile de dire quand cette mission pourra prendre fin.
Les quelques 20 000 hommes en uniforme de la mission ne peuvent pas réellement venir à bout de la multitude de groupes armés qui pullulent dans l'est du Congo. Pourtant on parle de plus de 180 000 kilomètres carrés, pas d'une ville. Et pour permettre quoi exactement à court terme? Le déploiement de l'armée telle qu'elle se présente aujourd'hui?
La MONUSCO est peut-être pointée du doigt à raison. Mais tous ces manquements ne suffisent pas à expliquer l'immense gâchis de ce conflit dans l'Est. Les causes de l'insécurité sont multiples : la faiblesse de la démocratie congolaise, l'échec de la réforme du secteur de la sécurité, l'exploitation illégale des ressources minières , mais aussi les conflits locaux et notamment liés à la terre qui sont trop souvent ignorés. Par conséquent, toute l’assistance étrangère au pays devrait être repensée et non seulement un mandat : le positionnement des chancelleries, l'affectation des aides financières et techniques, les stratégies d'intervention des humanitaires...
Derrière la relative inefficacité de la MONUSCO se profile surtout l'échec de la communauté internationale. La géométrie des interventions onusiennes n'est après tout que le résultat d'un compromis entre États.
Problème d'organisation et d'harmonisation des actions
L'autre problème réside dans le manque de cohésion entre les différents acteurs qui ont un rôle à jouer dans les processus d'aide et de pacification. On distingue un manque de communication entre les différents acteurs qui œuvrent afin d'atteindre le même objectif global. Dans certains cas, on peut même assister à des situations où les différents acteurs travaillent en opposition. En RDC, ce manque de cohésion fut frappant et est à l'origine de bon nombre de problèmes qui eurent un impact sur l’accomplissement de la mission de la MONUC et de la MONUSCO. L'Union européenne et l'ONU ont été très critiquées dans leur démarche, certains les trouvant trop axées sur la concurrence, d'autres les accusant de faire cavalier seul, ou d'autres encore de mener «leur propre politique de collaboration militaire en dehors des règles traditionnelles et collectives»23.
En fait, la critique est dure face au manque de coordination de la MONUC; « l'absence de coordination au sein du gouvernement congolais dissimule le semblant de coordination au sein de la communauté internationale, toujours prête à demander aux autorités locales de faire ce qu'elle ne réussit pas à faire elle-même »24.
Conclusion
Au terme de cet article portant sur la « problématique de l’intervention de l’ONU en République Démocratique du Congo et la question de la souveraineté : regard sur l’intervention de la MONUSCO », nous nous sommes fixé comme objectif de comprendre les interventions de l'ONU au Congo tout en jetant un regard particulier sur le mandat réel de la MONUSCO au vue de ses multiples limites qui transparaissent sur le terrain dans le domaine de sécurité et de rétablissement de l’autorité de l’Etat.
Par rapport au mandat, la MONUSCO a comme mission principale la protection des civils, la neutralisation des groupes armés, la surveillance de la mise en œuvre de l'embargo sur les armes et l'appui aux procédures judiciaires nationales et internationales conformément à la résolution 2098 du 28 mars 2013 du Conseil de Sécurité de l'ONU.
Les limites de la MONUSCO sont dues au fait que la MONUSCO ne serait pas parvenue à imposer la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la protection des populations civiles pour que l'administration publique fonctionne normalement. Ces multiples limites auraient conduit au renforcement de ses troupes par la création de la brigade spéciale d'intervention, mise en place suite à la persistance des groupes rebelles à l'Est de la RDC, devenu le théâtre des conflits récurrents et des violences interminables, occasionnant des déplacements massifs de la population. Ce sont ces multiples défis qui ont conduit le conseil de sécurité à renouveler le mandat de la MONUSCO.
En outre, ces limites seraient liées à l'immensité du territoire congolais. D’où la menace de cette souveraineté par les différentes crises que traverse le pays suite à la naissance des groupes armées qui déstabilisent l'Est du pays et empêchent l'Etat à étendre sa souveraineté sur toute l'étendue du pays ; car ceci influe sur le fonctionnement de l'administration publique, plus concrètement, son impact sur les services publics de l'Etat générateurs des recettes financières en particulier, mais aussi ses conséquences sur l'administration publique en général. En effet, l'Administration publique ainsi que les services publics ne peuvent fonctionner que si l'Etat exerce son pouvoir, ses prérogatives normalement sur toute l'étendue du territoire national. L’absence du pouvoir étatique dans certaines entités affaiblit la souveraineté de la République Démocratique du Congo.
Dans la perspective d'aboutir au rétablissement de la paix par l'ONU et spécifiquement par la MONUSCO en RDC, nous suggérons à la MONUSCO ce qui suit :
- Exécuter sans atermoiement le mandat musclé lui conféré par le conseil de sécurité à travers la création de la brigade africaine d'intervention ;
- poursuivre efficacement l'accompagnement des institutions de la RDC. Le conseil de sécurité devrait continuer à faire pression sur les Etats voisins afin qu'ils s'abstiennent de soutenir les groupes armés qui pullulent à l'Est de la RDC.
Comme annoncé dans les lignes précédentes, il y a lieu de retenir deux grandes leçons de l'histoire :
Primo : Les Nations Unies semblent gérer la crise congolaise avec les mêmes erreurs : inaction et obstination à résoudre par des mécanismes internes un conflit qui touche les Etats des pays des grands lacs.
Secundo : L'analyse juridico-politique des Tables Rondes et l'expérience de différents accords démontre à suffisance que, bien qu'indispensable, la viabilité d'une construction engendrée par le dialogue était souvent sujette à caution. Ces appréhensions ne préjugent en rien le résultat final que pourrait avoir la mission de l'ONU au Congo.
Cependant, en rapport avec la problématique que nous avons abordé, nous ne prétendons pas avoir tout expliqué, ni tout dit, ni tout analysé. Ce travail reste donc ouvert à toute critique objective et constructive contribuant à l'approfondissement de ses analyses.
Bibliographie
I. Ouvrages
1. KAZUMBA K. TSHITEYA , Introduction aux théories et doctrines politiques et sociales, l’Harmattan, 2012,
2. COHEN Daniel, la Mondialisation et ses ennemis, Paris, Grasset, 2004
3. Georg Jellinek, L 'Etat moderne et son droit, Panthéon-Assas, 2004, II,
4. Oscar Bloch et Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, 1968, 604
5. Loyseau, « Traité des seigneuries » dans Eric Maulin, Souveraineté, dans Denis Alland et Stéphane Rials (direction), Dictionnaire de la culture juridique, Lamy / PUF, Collection Quadrige Dicos Poche, 2003,
6. Georges VLACHOV : La pensée politique de Kant, PUF, Paris, 1968,
7. J. Claude WILLAME, « Les faiseurs de la paix au Congo, la gestion d'une crise internationale dans un Etat sous tutelle » in les livres du Grip Belgique, éd .Complexe, n°288-289, 2007,
8. SÉVERINE AUTESSERRE, The Trouble with the Congo. Local Violence and the Failure of International Peace building, Cambridge University Press. 2010
9. LECLERCQ, C., L'ONU et l'affaire du Congo, Paris 1964,
10. Kaïdar Ayoub , L'ONU face à l'irrationnel en RDC, Paris, L'Harmattan, 2011,
II. Résolutions
1. Résolution 1925 (2010) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6324e séance, le 28 mai 2010
[...]
1 Georg Jellinek , L 'Etat moderne et son droit, Panthéon-Assas, 2004, II, 98
2 Oscar Bloch et Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, 1968, 604
3 Georg Jellinek, op cit, p.73
4 Oscar Bloch et Walther von Wartburg, op cit, p 46
5 Georg Jellinek, Op. Cit., 73
6 Ibidem
7 Georg Jellinek, L 'Etat moderne et son droit, Panthéon-Assas, 2004, II, 72-73
8 idem
9 ibidem
10 Georg Jellinek, op.cit,p
11 idem
12 Loyseau, « Traité des seigneuries » dans Eric Maulin, Souveraineté, dans Denis Alland et Stéphane Rials (direction), Dictionnaire de la culture juridique, Lamy / PUF, Collection Quadrige Dicos Poche, 2003, p
13 Michel Foucault, « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France. 1976, Seuil/Gallimard, Collection Hautes Etudes, 1997, 23
14 Dictionnaire Universel, Hachette EDICEF,2eme Edition, Universités Francophones de l’UREF, 1988, p.1121.
15 KRATI POLITICHESKI Slovari, cité par le Professeur KAZUMBA K. TSHITEYA, Interventions militaires étrangères en République Démocratique du Congo de 1960. Paramètres géopolitiques et géostratégiques d’exercice de la souveraineté, thèse doctorale, UNIKIN, Kinshasa, p.40
16 MULAMBU MVULUYA, Note du cours de systèmes politiques comparés, L1 SPA, UNIKIN,2016-2017, p.134.
17 Georges VLACHOV : La pensée politique de Kant, PUF, Paris, 1968, p
18 Résolution 1925 (2010) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6324e séance, le 28 mai 2010
19 J. Claude WILLAME, « Les faiseurs de la paix au Congo, la gestion d'une crise internationale dans un Etat sous tutelle » in les livres du Grip Belgique, éd .Complexe, n°288-289, 2007, p.38.
20 Hubert KABUNGULU-NGOY Kangoy , Ancien Consultant au Centre d'Information de l'ONU à Kinshasa Chercheur privé
21 SÉVERINE AUTESSERRE, The Trouble with the Congo. Local Violence and the Failure of International Peace building, Cambridge University Press. 2010, P23
22 LECLERCQ, C., L'ONU et l'affaire du Congo, Paris 1964,p
23 Kaïdar Ayoub, L'ONU face à l'irrationnel en RDC, Paris, L'Harmattan, 2011, p.165.
24 Idem, Op.cit, p
- Citation du texte
- Guerschom Assumani (Auteur), 2023, La Problématique de l’Intervention de l’ONU en République Démocratique du Congo et la Question de la Souveraineté, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1579206