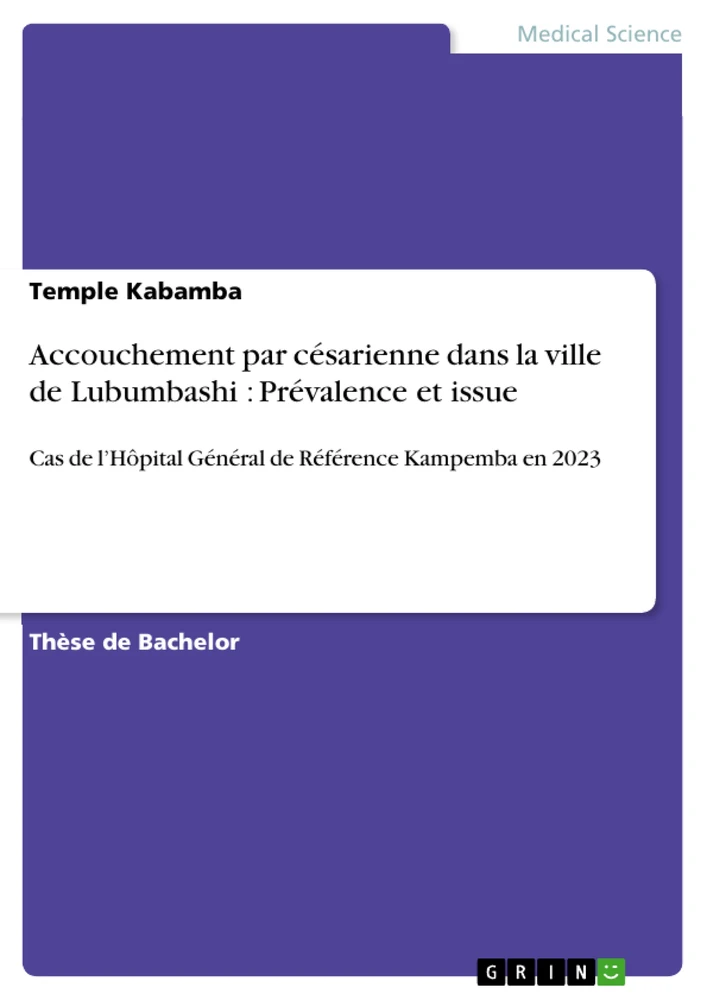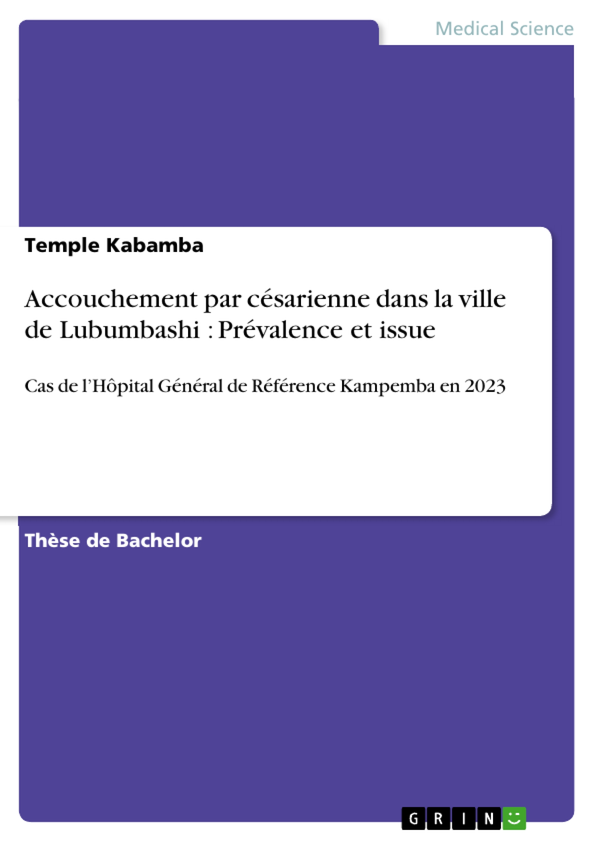La naissance d’un enfant est un événement heureux dans le foyer. Mais cet événement peut ne pas se passer dans les conditions adaptées. Cette étude avait pour objectifs de calculer la prévalence de l’accouchement par césarienne à l’Hôpital Général de Référence Kampemba entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, de déterminer l’issue des mères césarisées.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES FIGURES
RÉSUMÉ
INTRODUCTION
1. ÉTAT DE LA QUESTION
2. PROBLÉMATIQUE
3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
3.1. Choix du sujet
3.2. Intérêt du sujet
4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
4.1. Objectif général
4.2. Objectifs spécifiques
5. DIVISION DU TRAVAIL
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR L’ACCOUCHEMENT PAR CÉSARIENNE
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE
I.1.1. Accouchement
I.1.2. Césarienne
I.1.3. Prévalence
I.1.4. Issue
I.1.5. Indication
I.2. QUELQUES NOTIONS SUR LA CESARIENNE
I.2.1. Historique de la césarienne
I.2.2. Indications de la césarienne
I.2.3. Effets d'une naissance par césarienne
I.2.4. Épidémiologie
I.2.5. Techniques
I.2.6. Risques et complications
CHAPITRE II : MÉTHODOLOGIE
II.1. Cadre d’étude
II.2. Situation géographique de l’Hôpital Générale de Référence Kampemba
II.3. Historique de l’Hôpital Générale de Référence Kampemba
II.2. Type d’étude
II.3. Période d’étude
II.4. Population d’étude :
II.5. Échantillonnage
II.5.1. Type d’échantillonnage
II.5.2. Critères d'inclusion
II.5.3. Critères de non-inclusion
II.5.4. Taille de l’échantillon
II.6. Matériels et techniques de collecte des données
II.6.1. Matériels de collecte des données :
II.6.2. Techniques de collecte des données
II.7. Variables d’étude
II.8. Gestion et analyses des données
II.9. Considérations éthiques
II.10. difficultés rencontrés et solutions trouvées
II.10.1. Difficultés rencontrés
II.10.2. Solutions trouvées
CHAPITRE III : RÉSULTATS
CHAP IV: DISCUSSION
CONCLUSION
SUGGESTIONS
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ÉPIGRAPHE
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
APC : Accouchement par Césarienne
CAC : Complications Associées à la Césarienne
CSE : Césarienne
HGR : Hôpital Général de Référence
HU : Hauteur utérine
IMC : Indice de masse corporelle
MST : Maladie sexuellement transmissible
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PEIGS : Planification et Espacement idéal des grossesses pour la santé
PF : Planification familiale
PFE : Préférences des Femmes Enceintes
RPO : Réhabilitation Post-Opératoire
S&E : Suivi et évaluation
SIDA : Syndrome d’immunodéficience acquise
SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant et Time-bound
SME : Santé de la mère et de l’enfant
SRMNI : Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile
TC : Taux de Césarienne
USAID : Agence des États-Unis pour le développement international
VIH : Virus de l’immunodéficience humaine
LISTE DES TABLEAUX
Tableau I : Répartition des césarisées selon les tranches d’âge
Tableau II : Répartition des césarisées selon la gestité
Tableau III : Répartition des césarisées selon la parité
Tableau IV : Répartition des césarisées selon le nombre d’avortements
Tableau V : Répartition des césarisées selon l’antécédent de césarienne
Tableau VI : Répartition des césarisées selon l’antécédent de laparotomie
Tableau VII : Répartition des césarisés selon l’antécédent d’appendicectomie
Tableau VIII : Répartition des césarisées selon l’antécédent de myomectomie
Tableau IX : Répartition des césarisées selon l’antécédent de la kystectomie
Tableau X : Répartition des césarisées selon la taille
Tableau XI : Répartit ion des césarisées selon la hauteur utérine
Tableau XII : Répartition des césarisées selon l’âge gestationnel
Tableau XIV : Répartition des césarisées selon nombre de CPN suivies
Tableau XV : Répartition des césarisées selon les indications de la césarienne
Tableau XVI : Répartition des césarisées selon les types des complications maternelles
Tableau XVII : Répartition des césarisées selon l’issue des mères césarisées
Tableau XVIII : Répartition des césarisées selon l’issue du nouveau-né
Tableau XXI : Répartition des césarisées selon la malformation congénitale des nouveau-nés
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Répartition des césariennes selon la prévalence
Figure 2 : Répartition des complications maternelles
Figure 3 : Répartition des nouveau-nés selon les complications néonatales
RÉSUMÉ
La naissance d’un enfant est un événement heureux dans le foyer. Mais cet événement peut ne pas se passer dans les conditions adaptées. Cette étude avait pour objectifs de calculer la prévalence de l’accouchement par césarienne à l’Hôpital Général de Référence Kampemba entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, de déterminer l’issue des mères césarisées.
Il s’agissait d’une étude descriptive transversale réalisée au sein de l’HGR Kampemba. Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif et la taille de l’échantillon était de l’ordre de 40 césarisées. Le questionnaire d’enquête était anonyme.
La prévalence de la césarienne dans l’HGR Kampemba était de 7,6 %. Près d’un tiers des césarisées avaient l’âge compris entre 25 et 29 ans soit (32,5 %) des cas. La quasi-totalité des césarisées avaient suivis la CPN. La principale indication de la césarienne était la dystocie cervicale (65 %). La majorité des césarisées ont survécu à la césarienne (95 %). Et il a été observé 9,3 % des nouveau-nés décédés.
La césarienne demeure une intervention cruciale dans le domaine de l'obstétrique, permettant de sauver des vies tant maternelles qu’infantiles.
Mots-clés: Accouchement, césarienne, prévalence, issues maternelle et infantile .
INTRODUCTION
1. ÉTAT DE LA QUESTION
Dans toutes les sociétés, l'accouchement est vécu non seulement comme un heureux évènement mais aussi comme une angoisse car on ne connaît pas le dénouement : la vie ou la mort [1]. La naissance d’un enfant est un événement heureux dans le foyer. Mais cet événement peut ne pas se passer dans les conditions adaptées. Cette assertion reste encore une vérité de nos jours. C’est ainsi que l’opération césarienne est faite souvent dans des situations précaires et d’extrême urgence pour sauver la vie de la mère et, de plus en plus, celle de l’enfant. Cette intervention, même dans les situations les plus favorables, est associée à un risque plus élevé de mortalité et morbidité chez la mère et l’enfant par rapport à l’accouchement par voie basse [2].
La césarienne occupe une place importante dans la pratique obstétricale. On fait recours à cette opération chaque fois que l’accouchement par voie naturelle s’avère impossible. Cependant, un des facteurs sur lequel on pourrait agir pour améliorer cet état de fait est la qualité de l’offre des soins [3].
Dans la stratégie pour la maternité sans risque, la césarienne est un des moyens préconisés. Elle est une de ces interventions chirurgicales indispensables pour sauver la vie de la mère et celle de l’enfant. Cette intervention, même dans les situations les plus favorables, est associée à un risque plus élevé de mortalité et morbidité chez la mère et l’enfant par rapport à l’accouchement par voie basse. Si la césarienne est l’intervention majeure en obstétrique pour sauver la vie de la mère, encore faut-il que son indication soit posée correctement et à temps, qu’elle soit accessible et de qualité technique optimale. C’est ce qu’on appelle une « césarienne de qualité » [4]. La maternité sans risque constitue l'une des priorités actuelles visant à améliorer la santé maternelle et infantile. C'est ainsi que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a adopté la surveillance du travail et la détection précoce des dystocies comme l'une des approches les plus appropriées pour réduire la morbimortalité maternelle et infantile [5].
L’état de santé des mères et celui de leurs enfants sont liés et c’est sur eux que repose le développement de la société. C’est pour cette raison que la mortalité maternelle et néonatale est un ennemi précieux de l’efficacité des soins obstétricaux et du degré de développement d’un pays [6]. Cette volonté de réduire la mortalité maternelle se réaffirme dans l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD). Parmi les dix-sept Objectifs de Développement Durable retenus, figure en bonne place le 3ème objectif de développement durable (ODD3) stipulant que d’ici à l’an 2030, il faut réduire la mortalité maternelle mondiale à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes [7].
À l'échelle mondiale, l'accouchement par césarienne est un sujet d'intérêt majeur, avec des taux variables selon les pays et les régions. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le taux des césariennes en Afrique Subsaharienne en 2018 était de 7,3 % alors que le taux moyen mondial était de 21,1 % [8]. La Communauté Internationale de la Santé considère depuis près de 30 ans que le taux idéal de la césarienne se situe entre 10 % et 15 % [16]. Le taux de la césarienne en France a beaucoup augmenté entre 1981 et 2003 mais la tendance semble être à la stabilisation autour de 21 % [17]. Dans certains pays comme l'Allemagne, le taux de la césarienne était de 30,9 % en 2013 et il était de 32,5 % aux États-Unis d’Amérique (en 2013) [18].
En Europe, l'accouchement par césarienne est également un sujet d'intérêt préoccupant. En général, les taux de césarienne en Europe sont plus élevés que dans certaines régions d'Afrique. Par exemple en 2018, le taux moyen de césariennes était de 27,2 %, selon l'OMS [9]. En Amérique, l'accouchement par césarienne est également un sujet important. Dans de nombreux pays d'Amérique Latine, le taux des césariennes est parmi les plus élevés au monde, dépassant souvent les recommandations de l'OMS qui fixent un taux maximal de 15 % [10].
L'accouchement par césarienne en Afrique est une question cruciale en matière de santé maternelle et infantile. Les taux de césarienne en Afrique varient d'un pays à l'autre et peuvent être influencés par divers facteurs tels que l'accès aux soins de santé, les ressources disponibles, les politiques de santé et les pratiques médicales [11]. En Afrique Subsaharienne, il est important de noter que le taux des césariennes reste inférieur à la moyenne mondiale. Selon l'OMS, en 2018, le taux moyen des césariennes en Afrique était d'environ 14 % avec des variations significatives entre les pays [12]. Sur les 28 pays qui enregistrent des chiffres en deçà de 5 %, les trois-quarts se situent en Afrique Subsaharienne. On observe les taux les plus faibles au Niger, au Tchad, en Éthiopie et au Madagascar. Parmi les grands pays désavantagés, on relève le Mali (2 %), le Nigeria (3 %), l’Afghanistan (3 %) et le Congo (5 %). Ce qui place sans grande surprise l’Afrique comme le continent où l’on naît le moins souvent de cette manière [13].
En ce qui concerne les issues de l'accouchement par césarienne en Afrique, des études ont montré que les taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile sont souvent plus élevés après une césarienne par rapport aux accouchements par voie basse. Ces complications peuvent être liées à des facteurs tels que des infections post-opératoires, des hémorragies, des complications anesthésiques et un risque accru des complications pour les futurs accouchements. Cependant, il est également important de noter que la césarienne est parfois nécessaire pour sauver la vie de la mère et de l'enfant en cas de complications obstétricales graves [14]. Le taux de césarienne est considéré comme l’un des indicateurs de surveillance des services obstétricaux. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande depuis 1985, un taux de 10 à 15 % en proportion des naissances dans la population. En dehors de cette fourchette, il existe un risque global de santé [15].
En République Démocratique du Congo (RDC), le taux global des césariennes a été estimé à 18 %. Plusieurs acteurs ont réfléchi sur cette réduction du taux des césariennes et les pistes proposées pour décanter cette situation n’ont pas donné les effets escomptés [3].
Dans le contexte spécifique de Lubumbashi, il est possible que la prévalence de l'accouchement par césarienne soit influencée par des facteurs tels que l'accessibilité aux services de santé, la disponibilité d'équipements médicaux et de personnel qualifié ainsi que les préférences des femmes enceintes et des prestataires des soins de santé. Il serait pertinent d'explorer l’impact de ces facteurs sur l'accouchement par césarienne à Lubumbashi [19].
2. PROBLÉMATIQUE
La fréquence de la césarienne ne cesse d'augmenter ces dernières années mais cette augmentation des taux des césariennes varient d'un pays à un autre et dans un même milieu, d'une institution médicale à une autre [20]. Les raisons sont multifactorielles et pas toujours défendables: les changements dans les caractéristiques et les styles de pratique professionnelle, l'augmentation de la pression en cas de faute professionnelle ainsi que les facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. Dans les pays à faibles ressources, la fréquence des césariennes est passée de 1,9 % à 6,1 % [21].
Sur plus de 3100000 grossesses attendues chaque année en RDC, 15 % des femmes enceintes (plus de 450000) connaissent des complications pendant la grossesse, durant l'accouchement ou après l'accouchement dont un tiers (plus de 150000) requérant une intervention chirurgicale (césarienne) [22]. En République Démocratique du Congo, les dernières Enquêtes Démographiques et de Santé ont indiqué une légère augmentation du taux des césariennes, passant de 4 % en 2007 à 5 % en 2013 [23]. La fréquence des césariennes semble augmenter et l'importance relative de diverses indications change [24]. Par ailleurs, il a été observé une augmentation de la morbi-mortalité fœtale chez les enfants nés la nuit comparés à ceux nés le jour, tous modes de naissance confondus. Cet excès de morbimortalité pourrait s’expliquer en partie par l’effectif réduit et la réactivité altérée des équipes [25]. Les études portant plus spécifiquement sur la morbi-mortalité liée à des césariennes réalisées la nuit aboutissent à des conclusions diverses. L’excès de risques pour la mère ou pour l’enfant en lien avec les césariennes nocturnes n’est donc pas complètement expliqué [26].
Les conditions de travail sur terrain font encore de la césarienne une opération dangereuse pour le couple mère-enfant avec une forte morbidité et mortalité tant maternelles que périnatales. Une étude menée à l’Hôpital Sendwe à Lubumbashi a trouvé des taux de létalité maternelle et périnatale spécifiques respectivement de 1,6 % et 19,51 % [24].
Afin de cerner tous les contours des accouchements par césarienne à Lubumbashi, nous nous sommes posé trois questions de recherche suivantes :
> Quelle est la prévalence des accouchements par césarienne à l’Hôpital Général de Référence Kampemba en 2023 ?
> Quelle est l’issue des mères césarisées ?
> Quelle est l’issue des nouveau-nés au terme d’une césarienne ?
3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
3.1. Choix du sujet
Le choix de ce sujet a été motivé par le fait que nous constatons que la morbidité et la mortalité liées à la césarienne font de cette voie d’accouchement un grand problème de santé publique dans notre milieu.
3.2. Intérêt du sujet
3.2.1. Intérêt personnel
Le présent travail nous a permis d’approfondir nos connaissances sur la santé de la reproduction en général et les accouchements par césarienne en particulier.
3.2.2. Intérêt scientifique
Le travail élaboré sur base du sujet choisi a permis la production des nouvelles connaissances en matière d’accouchement par voie haute.
3.2.3. Intérêt social
Ce travail aidera la population à utiliser les services de santé génésique pour éviter toute éventualité de conséquences dues aux complications liées à l’accouchement.
4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
4.1. Objectif général
> Contribuer à l’amélioration du bien-être maternel et infantile par la promotion des soins obstétricaux et néonataux de qualité à Lubumbashi.
4.2. Objectifs spécifiques
> Calculer la prévalence de l’accouchement par césarienne à l’Hôpital Général de Référence Kampemba entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;
> Déterminer l’issue des mères césarisées au sein de l’Hôpital Général de Référence Kampemba en 2023 ;
> Décrire l’issue des nouveau-nés au terme d’une césarienne en 2023.
5. DIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'Introduction et la Conclusion, notre travail s’est articulé sur quatre Chapitres suivants :
> Chapitre I consacré aux Généralités sur la Césarienne ;
> Chapitre II réservé à la Méthodologie ;
> Chapitre III relatif à la présentation des Résultats ;
> Chapitre IV traitant de la Discussion.
PREMIÈRE PARTIE: CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR L’ACCOUCHEMENT PAR CÉSARIENNE
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE
I.1.1. Accouchement
L’accouchement est le processus par lequel un bébé est expulsé de l'utérus de sa mère à la fin de la grossesse. C'est un événement physiologique naturel qui peut être accompagné de douleur et de contractions utérines. L'accouchement peut se dérouler de manière spontanée ou être déclenché par des interventions médicales en cas de complications. Une surveillance médicale est souvent nécessaire pour assurer la sécurité de la mère et du bébé pendant le processus d'accouchement [27].
I.1.2. Césarienne
La césarienne désigne une procédure chirurgicale au cours de laquelle le bébé est extrait de l'utérus de la mère à travers une incision abdominale et utérine. Cette intervention est généralement réalisée lorsque l'accouchement par voie basse est considéré comme dangereux pour la mère ou le bébé, ou en cas de complications pendant le travail. Les indications courantes de césarienne comprennent le travail prolongé, la présentation anormale du fœtus, le placenta prævia ou toute autre situation médicale qui rend l'accouchement par voie basse risqué. La césarienne est une procédure sûre et courante mais elle comporte également des risques et peut nécessiter une période de récupération plus longue par rapport à l'accouchement vaginal [28].
I.1.3. Prévalence
La prévalence fait référence à la fréquence ou à l'étendue d'une maladie ou d'un trouble au sein d'une population à un moment donné. Elle est souvent exprimée sous forme de pourcentage, indiquant la proportion de personnes affectées par la maladie par rapport à la population totale. Une prévalence élevée signifie qu'un grand nombre de personnes sont touchées par la maladie tandis qu'une faible prévalence indique que seule une petite partie de la population est affectée [29].
I.1.4. Issue
L'issue d'une situation fait référence à son issue ou à son résultat final. Il s'agit de ce qui se produit à la fin d'un processus, d'un événement ou d'une décision. Par exemple, dans le domaine médical, l'issue d'une maladie peut être favorable (si le traitement est efficace) ou défavorable (si la maladie progresse ou si des complications surviennent). Dans un contexte plus large, l'issue peut également être utilisée pour décrire le résultat final d'une négociation, d'une affaire judiciaire ou de tout autre événement ou situation. L'issue qui s’avère souvent incertaine dépend de divers facteurs et actions prises au cours du processus [30].
I.1.5. Indication
C'est une circonstance qui rend souhaitable ou favorable la mise en œuvre d'un traitement ou d'une épreuve diagnostique déterminé [31]. L'indication d'une césarienne est donc par définition. L'ensemble des conditions rendant favorable la décision de faire une césarienne.
I.2. QUELQUES NOTIONS SUR LA CESARIENNE
I.2.1. Historique de la césarienne
Durant l'Antiquité, la césarienne est pratiquée sur une femme morte ou sur le point de mourir [22]. Le Code de Hammourabi préconisa une naissance par césarienne après la mort d'une femme en couche [29]. La première naissance notoire par césarienne parait être celle de Scipion l'Africain en 234 avant Jésus-christ (Av. J.-C.), rapportée par Pline l'Ancien. Elle aurait été tentée sur une femme vivante mais qui serait morte durant l'intervention. Il apparaît que les motifs des Romains étaient d'abord politiques [30]. Dans la Mythologie grecque, Dionysos (Bacchus pour les Romains) et Asclépios (Esculape pour les Romains) sont nés après une césarienne C'est aussi le cas du héros perse Rostam7. Chez les Romains, sous le règne du Roi Numa Pompilius (VIème siècle av. J.-C.), une loi royale (Lex regia), connue sous le nom de Lex Caesarea, fut promulguée. Elle interdit « l'enterrement d'une femme enceinte avant que l'enfant n'en ait été excisé ». À la fin du IVème siècle, Servius expliqua que les enfants nés par césarienne d’une mère décédée sont consacrés à Apollon dans la Rome antique [31].
Au Moyen-Âge, les Hébreux pratiquaient l'opération césarienne sur une femme morte au cours de l’'accouchement, selon le Talmud. La Mishna et le Talmud rapportèrent toutefois des cas de césariennes sur des femmes vivantes entre le IIème siècle av. J.-C. et le VIème siècle. Des historiens relèvent en outre que Maïmonide (au XIIème siècle) s'étonnait qu'une femme, ayant déjà subi une césarienne, pût être enceinte et accoucher à nouveau [29].
Chez les Musulmans, l'opération serait mentionnée par Albucassis dans son Al- Tasrif et Avicenne consacre trois chapitres de chirurgie obstétricale dans son Qanûn. C'est ce savoir technique (au moins théorique) qui est transmis en Occident vers le XIIIème siècle et qui se retrouve chez les chirurgiens comme Guy de Chauliac, Lanfranc de Milan ou Bernard de Gordon. Il a pour but d'extraire soit un enfant mort d'une femme vivante soit un enfant vivant d’une femme morte [30].
Dans le Monde Chrétien, en Occident Latin, l'opération était appelée sectio in mortua (incision sur femme morte). C’était une question plus théologique que médical, la césarienne post mortem étant commandée par la nécessité d'extraire l'enfant en vue de son salut par le baptême [30]. La Lex Caesarea de la Rome Antique fut reprise jusque dans le Corpus juris civilis (VIème siècle). Le geste était probablement effectué non par des médecins (Soranos d'Éphèse ne le mentionna pas). On connait deux cas médiévaux de césarienne sur femme morte (documentés dans des archives historiques) : celui de Florence en 1305 et celui de Marseille en 1331 [32].
La césarienne moderne qui recourt à la technique de l'incision transversale basse sur le segment inférieur de l'utérus (développée depuis 1881 par Ferdinand Adolf Kehrer) est moins risquée. Elle est améliorée par Frank de Cologne en 1907. C'est la césarienne basse ou segmentaire qui permet d'éviter les risques ultérieurs de rupture utérine. C'est la césarienne moderne et dans la première moitié du XXème siècle, différentes techniques de césariennes basses sont mises au point afin de réduire le taux d'infection. Finalement, le lourd tribut maternel ne s'améliore qu'avec l'avènement des antibiotiques [32]. La césarienne moderne n'a guère plus d'un siècle. Toutefois, depuis la césarienne de Porro (1876), les différentes méthodes ne se succèdent pas du jour au lendemain. Elles coexistent et ne se remplacent que progressivement. Au XVIIIème siècle, l'accoucheur en renom dans un pays donné dispose d'une autorité quasi-monarchique envers ses collègues et peut donc imposer ses vues avec droit de veto. Au XIXème siècle, la chirurgie reste dépendante de l'intuition et du talent technique de tel ou tel maître. Les protocoles chirurgicaux internationalement admis sont encore rares et, le plus souvent jusqu'au milieu du XXème siècle, c'est le « tour de main » ou l'habitude d'un maître (professeur d'une grande université) qui s'impose à l'échelle locale ou régionale [30].
De nos jours, il s'agit d'une technique maîtrisée, permettant la réduction au minimum de la morbidité maternelle (complications maternelles) et pour laquelle les indications sont bien codifiées par la profession (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français), s'il s'agit d'une césarienne programmée. Mais la mortalité et la morbidité maternelles restent toujours plus élevées par césarienne que par accouchement par voie naturelle. Cependant, dans des cas précis, la césarienne corporelle est encore pratiquée comme en cas de placenta prævia antérieur et dans certaines présentations de l'épaule [33].
I.2.2. Indications de la césarienne
I.2.2.1. Problèmes de bien-être fœtal
Si le monitoring fœtal indique que le bébé est en détresse ou qu'il y a des signes de souffrance fœtale, une césarienne peut être nécessaire pour protéger la santé et la vie du bébé [24].
I.2.2.2. Présentation anormale du fœtus
Si le bébé est en siège, en transverse ou dans une position anormale qui rend l'accouchement par voie basse difficile ou dangereux, une césarienne peut être recommandée.
I.2.2.3. Placenta prævia
Il s’agit d’une condition où le placenta recouvre partiellement ou entièrement l'ouverture du col de l'utérus. Ce qui rend un accouchement par voie basse dangereux en raison du risque de complications graves pour la mère et le bébé.
I.2.2.4. Travail d’accouchement ou en progression anormale
Si le travail ne progresse pas normalement même après une longue période de travail actif, une césarienne peut être envisagée pour éviter des complications telles que le risque d'infection ou de détresse fœtale.
I.2.2.5. Antécédent de césarienne
Si une femme a déjà subi une césarienne dans le passé, elle peut être conseillée de subir une nouvelle césarienne pour éviter les risques d'une rupture utérine lors d'un accouchement par voie basse.
I.2.2.6. Dystocies mécaniques
I.2.2.6.1. Bassins rétrécis
Ici l'intervention sera faite avant le travail si le bassin est très rétréci (par exemple en cas de bassin avec diamètre promonto-sous-pubien inférieure à 9 cm, de bassin à asymétrie forte et d’ostéomalacie du bassin) ou après épreuve du travail (bassin limite, asymétrie moyenne) [35].
I.1.6.1.2. Tumeur(s) prævia et restant prævia pendant le travail
Dans ce cas, la césarienne doit être suivie de l'ablation de la tumeur ou des tumeurs
[35]-
I.1.6.1.3. Dystocies dynamiques
Ces genres des dystocies ne sont parfois qu'une conséquence de la dystocie mécanique qu'elles viennent aggraver mais on l'a rencontré aussi à titre isolé. Les premiers signes de souffrance fœtale ou ceux de l'infection amniotique pourraient indiquer l'opportunité de l'intervention. Mais la longueur excessive du travail est en elle-même une indication [36].
I.1.7.7. Autres indications de la césarienne
D’autres indications de la césarienne peuvent inclure, par exemple des problèmes médicaux maternels préexistants, des infections graves, des saignements excessifs, des grossesses multiples, des malformations utérines et des anomalies du cordon ombilical. Il est important que les décisions concernant la césarienne soient prises en concertation avec les professionnels de la santé et en tenant compte des circonstances individuelles de chaque femme enceinte [24].
I.2.3. Effets d'une naissance par césarienne
Dans un certain nombre de cas, la césarienne peut épargner un traumatisme au bébé mais cette voie d'accouchement priverait aussi le bébé de la colonisation de son intestin par la flore vaginale de sa mère et aurait un effet épigénétique [33]. Cet effet serait conservé dans les cellules souches du nouveau-né. L'effet d'une naissance naturelle pourrait être recréé grâce à un tampon incubé plusieurs heures dans le vagin maternel et utilisé pour essuyer le visage du bébé après sa naissance, mais cette méthode - qui est encore en test - pourrait présenter des risques [34]. Ceci pourrait expliquer pourquoi les individus nés par césarienne ont un risque statistiquement accru de maladies auto-immunes ou immunologiques (en particulier risque accru d'asthme, de diabète de type 1, d'obésité, de sclérose en plaques et de maladie cœliaque). On ignore encore si ce mécanisme épigénétique est temporaire ou s’il perdure (et, si oui, combien de temps ou sur combien de générations) [35].
I.2.4. Épidémiologie
Dans le monde, près de 30 millions des naissances ont eu lieu par césarienne en 2015, soit une naissance sur 5. Ce qui correspond à un doublement des chiffres de 2000 [36]. Les taux de césarienne augmentent depuis 20 ans dans la majorité des pays industrialisés où la technique opératoire est maîtrisée. Une étude en 2018 montre que le taux mondial de césarienne a grimpé de près de 10 % en 15 ans, avec 15 pays où le taux de naissance par césarienne dépasse les 40 %. L'Organisation Mondiale de la Santé établit un taux optimal de césariennes entre 5 % et 15 % : « En proportion des naissances dans la population, le taux de césariennes doit être compris entre 5 % et 15 % — car un taux inférieur à 5 % indiquerait que certaines femmes avec des complications sévères ne recevraient pas le niveau de soins adéquat. » De nombreux pays dépassent ces chiffres. Au-delà de 15 %, le recours à la césarienne est jugé comme abusif et aurait un impact plus négatif que positif si l’on considère les risques de cette opération [37].
I.2.5. Techniques
Bien qu'on ait décrit une césarienne « vaginale » avec incision de l'utérus par voie vaginale et naissance par la vulve, seule la technique « abdominale » permet de s'affranchir de l'obstacle constitué par le bassin osseux. [39].
L'anesthésie générale étant considérée à grands risques pour une femme enceinte à cause de l'œdème laryngé et de la diminution de vidange gastrique, on utilise une anesthésie loco-régionale. La rachianesthésie peut être pratiquée en cas d'urgence. Son effet apparait moins d'une minute après l'injection et la technique est plus rapide que la péridurale car il n'y a pas de pose de cathéter. En cas d'anesthésie péridurale déjà en place, on peut injecter des doses plus importantes par le cathéter mais il faut attendre plusieurs minutes avant d'avoir une analgésie satisfaisante. Cela permet à la mère de rester consciente durant la naissance de son enfant, réduit les risques anesthésiques tant pour la mère que pour l'enfant et favorise la bonne mise en place du lien mère-enfant pour elle et pour son enfant [39]. Il existe des nombreuses techniques de césarienne. Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français a rédigé quelques recommandations dans ce sens [40].
I.2.6. Risques et complications
I.2.6.1. Complications maternelle
I.2.6.1.1. Complications maternelles immédiates
La césarienne augmente la morbidité maternelle ainsi que la mortalité, en particulier lors des procédures d'urgence. Selon une étude réalisée par l'Université Queen Mary de Londres, dans les pays à bas et moyens revenus sur la période 1990-2017, le risque de décès maternel après césarienne est de 7 à 10 pour 1000 procédures. Ce qui représenterait sur environ 3 millions des césariennes incluses dans l'étude, près de 30 000 décès en 27 ans [41] . Les pertes de sang sont significativement plus importantes lors d'une césarienne que pour les a c couchements par voie basse. Une lésion des organes voisins (vessie) est possible.
Une antibioprophylaxie est systématiquement pratiquée immédiatement après l'extraction fœtale [42].
I.2.6.2. Complications maternelles secondaires
Au moment de la suture et de la remise en place des organes dans l'abdomen, les intestins peuvent former une bride et se retrouver collés à la paroi. Des troubles digestifs peuvent alors apparaître (tels que des nausées et vomissements). Ce qui peut aller jusqu'à la nécessité d'une nouvelle opération pour résoudre l'occlusion intestinale. Les césariennes augmentent à long terme le risque de grossesse extra-utérine, de placenta accreta et de rupture utérine. Un accouchement par césarienne augmente le risque que les accouchements ultérieurs soient aussi effectués par cette voie [43].
I.2.6.3. Complications fœtales
L ’ incision de la joue et la coupure d'oreille sont des événements possibles lors de l'incision de l'utérus. Les cas d'extraction difficiles de l'enfant peuvent se solder par une fracture du membre supérieur (humérus) ou inférieur (fémur) [43].
I.2.7. Mesures de lutte et de prévention pour la césarienne
Les mesures de lutte et de prévention pour la césarienne peuvent être abordées à plusieurs niveaux, notamment au niveau individuel, communautaire et médical. Voici quelques mesures pouvant contribuer à réduire le recours à la césarienne :
■ Suivi médical régulier : Un suivi médical régulier tout au long de la grossesse permet de détecter et de gérer les complications potentielles. Ce qui peut réduire le risque de césarienne ;
■ Éducation et sensibilisation : Informer les femmes enceintes sur les différentes options d'accouchement, les risques et les avantages de la césarienne par rapport à l'accouchement vaginal peut les aider à prendre des décisions éclairées ;
■ Pratiques de santé adaptées : Adopter des pratiques de santé globale telles qu'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et la gestion du stress peut contribuer à une grossesse en bonne santé et à un accouchement plus facile ;
■ Accompagnement pendant le travail : Offrir un soutien continu et des soins attentionnés pendant le travail peut aider les femmes à gérer la douleur et le stress. Ce qui peut réduire la nécessité d'une césarienne ;
■ Formation du personnel médical : Assurer une formation adéquate du personnel médical sur les pratiques d'accouchement physiologique, les techniques de gestion de la douleur et la prise en charge des complications peut contribuer à réduire le recours excessif à la césarienne ;
■ Encourager la prise de décision partagée : Impliquer activement les femmes dans le processus de prise de décision concernant leur accouchement peut aider à réduire les taux de césarienne non nécessaires. Il sied de noter que la césarienne est parfois nécessaire pour des raisons médicales et qu'elle peut sauver des vies dans certaines situations. Cependant, en mettant en œuvre ces mesures, il est possible de réduire le recours excessif à la césarienne et d'encourager des accouchements plus naturels lorsque cela est possible [25].
I.2.8. Césariennes « pour convenance personnelle »
Le choix d'une intervention médicale par convenance personnelle repose non sur des raisons médicales précises mais sur des raisons relevant uniquement du choix personnel de mode de vie (life-style choice). Cette convenance personnelle peut conduire la patiente (ou le couple) à demander, voire à exiger, une césarienne [44]. Le choix peut aussi venir du médecin ou de l'équipe médicale soit par habitude soit pour des raisons d'organisation soit pour des considérations financières soit encore pour se prémunir du risque de poursuites en cas d'accouchement présentant au moins un risque [45]. Il existe une différence entre les pays anglo-saxons et les pays latins. Dans les pays anglo-saxons, l'élément essentiel est en effet le respect de l'autonomie, de la liberté de choix et de décision du patient, y compris sur son propre corps (par exemple refuser ou demander une césarienne contre l’avis médical), la personne assumant seule les risques et les conséquences (rôle dominant des Juges) [44]. En France, la liberté de ce type de décision doit être encadrée par un consensus national (légal et judiciaire) impliquant l'individu et la collectivité (rôle dominant de l'État). Se pose alors le problème de l'extension de l'autonomie-convenance jusqu'à l'exigence : « qui doit décider de la limite à établir entre la convenance convenable et l'exigence inconvenante » [46].
I.2.9. Préparation d’une parturiente
I.2.9.1. Préparation psychologique
La césarienne est classée parmi les interventions chirurgicales majeures. Quant à la préparation psychologique de la parturiente, tout dépend de la situation même du concept qui a poussé le médecin obstétricien à pouvoir prendre la décision de passer par une césarienne. Face à cela, une césarienne décidée urgemment sera tout à fait différente de celle élective préconisée depuis un temps sur le plan de la préparation psychologique de la parturiente. Dans ce dernier cas, une parturiente ayant suivi très bien ses consultations prénatales et chez qui le médecin obstétricien préconise déjà un accouchement par voie haute sera en mesure elle-même de comprendre un certain nombre des choses par rapport à son état de grossesse car le médecin aura à lui expliquer pourquoi il faudra pour elle une césarienne et comment ça se passe, les risques qu'elle court et les avantages. Mais pour une parturiente qu'on amène en urgence, c'est vraiment délicat mais si elle est consciente, il faut lui adresser un petit mot pour expliquer pourquoi cet état des choses est très important aussi bien pour la parturiente que pour sa famille [49].
I.2.9.2. Préparation anesthésique
Pour une césarienne élective ou celle faite en urgence, la préparation anesthésique doit être scrupuleusement étudiée car un certain nombre de contre-indications doit être respecté. Dans les cas urgents ou même programmés, l'anesthésie générale est le plus souvent utilisée car l'induction est rapide et ses effets sont contrôlables malgré les risques d'inhalation du liquide gastrique pour la mère et une dépression respiratoire passagère pour l'enfant. Aujourd'hui, l'anesthésie générale connait une alternative : l'anesthésie locorégionale. Essentiellement péridurale, elle est d'installation lente. Voilà pourquoi on observe plus son utilisation pour les césariennes prophylactiques ou lorsque l’anesthésie péridurale a été réalisée avant l'indication de la césarienne au cours du travail [50].
I.2.9.3. Préparation des matériels
L'opération césarienne (comme tout acte chirurgical respectable) doit se passer dans toutes les conditions requises pour l'asepsie et la désinfection. Un bloc opératoire bien équipé, isolé et relié ou en connexion avec un service de réanimation solide, est d'une importance capitale pour passer une bonne intervention chirurgicale. Une table opératoire adaptée, une lumière adéquate et non couverte par l'ombre (c’est-à-dire une bonne lampe scialytique) est d'ordinaire valable dans une bonne salle d'opération. Quant au matériel, Merger dit qu'il doit être simple, permettant ainsi un déroulement stéréotypé et rapide [49]. La boite d'instrument qui doit être réduite au matériel indispensable peut contenir, à titre d'exemple, deux valves de Doyen, un écarteur de Colte ou de Ricard (de taille moyenne) avec trois jeux de valve selon l'épaisseur de la patiente, deux écarteurs de Farabeuf, une aiguille de Riverdin, un bistouri N ° 4 court, un porte-aiguilles de Mayo-Hegar 20 cm, une paire des ciseaux de Mitzeubaum 23 cm, une paire des ciseaux de Mayo courbés 18 cm, une paire des ciseaux à fil bon rond, une pince à disséquer sans griffes 20 cm, une pince à disséquer de Resano, deux pinces de Jean-Louis Faure, quatre pinces en coeur, six pinces de Kocher, six pinces de Leriche courbes, deux pince de Kelly, deux pinces de Péan, deux pinces d'Ombredanne, une pince à annexe, une cupule et un drain de Redon [41].
DEUXIÈME PARTIE : CONSIDERATIONS PRATIQUES
CHAPITRE II : MÉTHODOLOGIE
II.1. Cadre d’étude
Notre étude été menée à l’Hôpital Générale de Référence Kampemba.
II.1.2. Situation géographique de l’Hôpital Générale de Référence Kampemba
L’HGR kampemba est la structure sanitaire de Deuxième Échelon (SSDE) de la Zone de Santé (ZS) de kampemba. Il est situe au numéro 8 de l’avenue des abricotiers au Quartier bel air.
L’actuelle Zone de Santé de kampemba fonctionne avec 25 aires de Santé. Elle est d’une superficie de 150 Km[2] et sa population totale fut de 520709 habitants en 2018. Elle est délimitée:
> Au Nord-Est : par les Zone de Santé de Tshamilemba et Kowe ;
> Au Sud-Ouest : par les Zone de Santé de Kamalondo et Kenya ;
> À l’Est : par la Zone de Santé de Ruashi ;
> À l’ouest : par la Zone de Santé de Lubumbashi ;
> Au Sud : par la Zone de Santé de Kafubu.
II.1.3. Historique de l’Hôpital Générale de Référence Kampemba
Tout a commencé par un Dispensaire qui fonctionnait dans l’aile gauche du bâtiment de l’actuelle structure sanitaire sous la supervision de la Sœur Victoria et d’un Médecin consultant en la personne du Docteur Kabuya. Ce centre sera déplacé au numéro 1076 de l’avenue des plaines dans la maison du Général Singa alors gouverneur du Katanga. Docteur Kabuya_lissa sa place au Docteur Azama de la SNCZ qui apporta sa collaboration aux Religieuses.
En 1989, la Hiérarchie Sanitaire de la Province décida de transformer ce dispensaire en Zone de Santé et y nomma un Médecin Chef de Zone de Santé en personne du Docteur Kayembe ngongo. C’est sous sa direction que le Centre de Santé de Référence (CRS) Kampemba connut un vrai épanouissement de ses activités. En 1991, la vente de la maison qui abritait le CRS Kampemba (au numéro 1076 de l’avenue des plaines) mit fin aux activités. Les activités reprirent en 1993 au numéro 8 de l’avenue des abricotiers. En 2023, le CRS Kampemba fut transformé en Hôpital Général de Référence (HGR) Kampemba.
II.2. Type d’étude
Nous avons mené une étude descriptive transversale, la collecte des données s’étant fait de manière rétrospective.
II.3. Période d’étude
La présente étude a concerné la période s’étalant du 1er janvier au 31 décembre en 2023.
II.4. Population d’étude :
La population de notre étude a été constituée des femmes césarisées à l’HGR Kampemba.
II.5. Échantillonnage
II.5.2. Type d’échantillonnage
Il s’agissait d’un échantillonnage exhaustif.
II.5.3. Critères d'inclusion
Nous avons inclus dans cette étude toutes les femmes césarisées qui ont été enregistrées à l’HGR kampemba sur la période allant du 1er janvier au 30 décembre en 2023 et dont tous les dossiers médicaux étaient complets.
II.5.4. Critères de non-inclusion
N’ont pas été incluses dans la présente enquête toutes les femmes césarisées en 2023 mais dont les dossiers étaient complets.
II.5.5. Taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon a été de l’ordre de cas (soit 40 césarisées de l’an 2023).
II.6. Matériels et techniques de collecte des données
II.6.2. Matériels de collecte des données :
La collecte des données a été faite sur base d’une fiche de collecte des données reprenant les variables d’intérêt. Nous nous sommes servies principalement de fiches des malades et des registres des accouchements pour collecter les informations en rapport avec notre étude.
II.6.3. Techniques de collecte des données
Pour récolter les données, nous avons recouru à un questionnaire d’enquête préétabli et pré-testé.
II.7. Variables d’étude
Les principales variables ci-après ont été étudiées :
o Âge;
o Niveau d’études de la femme;
o Niveau d’études du mari;
o Etat conjugal de la femme;
o Occupation de la femme;
o Occupation du mari;
o Religion;
o Parité,
o Gestité ;
o Avortement ;
o Prévalence de la césarienne ;
o Indications de la césarienne ;
o Complications maternelles ;
o Complications néonatales ;
o Issue de la césarisées ;
o Issue du nouveau-né.
II.8. Gestion et analyses des données
Les données, une fois collectées, ont été saisies et encodées au moyen du logiciel Excel avant d’être exportées sur EPI Info TM 7 pour analyse. Nous nous sommes basée aux analyses statistiques univariées.
II.9. Considérations éthiques
Le questionnaire d’enquête utilisé était anonyme. Nous avons strictement veillé à la confidentialité des données récoltées.
II.10. difficultés rencontrés et solutions trouvées
II.10.2. Difficultés rencontrés
o Refus d’accès à la Maternité de l’HGR Kampemba pour collecter les données ;
o Non disponibilité de certaines données utiles à notre enquête.
II.10.3. Solutions trouvées
o Nous avons eu à faire recours à diverses interventions afin d’avoir accès aux données retranchées ;
o Les dossiers médicaux jugés incomplets ont été tout simplement déclassés.
CHAPITRE III : RÉSULTATS
III.1. Prévalence
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Figure 1 : Répartition des césariennes selon la prévalence
La figure ci-dessous présenté indique que l’Hôpital Général de Référence Kampemba a enregistré 40 cas des césariennes en 2023 sur un total de 525 accouchements 40 cas de césarienne sur la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2023, soit une prévalence de la césarienne de 7,6 %.
III.2. Âge
Tableau I : Répartition des césarisées selon les tranches d’âge
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le tableau ci-haut présenté montre que les césarisées âgées de 25 à 29 ans ont été les plus représentées dans cette série, soit 32,5 %. L’âge moyen a été de 30±4 ans, le minimum d’âge de 20 ans et le maximum de 34 ans.
III.3. Gestité
Tableau II : Répartition des césarisées selon la gestité
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort du tableau ci-haut présenté que plus d’un tiers des accouchées césarisées étaient des paucigestes, soit 36,5 % contre 15 % des multigestes.
III.4. Parité
Tableau III : Répartition des césarisées selon la parité
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le tableau 3 indique que les paucipares et les multipares ont représenté respectivement 45,5 % et 25 % des cas tandis que les grandes multipares ont constitué la plus faible proportion (12,5 %).
III.5. Nombre d’avortements
Tableau IV : Répartition des césarisées selon le nombre d’avortements
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort de ce tableau que 72,5 % des césarisées n’ont pas connu d’avortement. Par contre, 25 % des femmes enquêtées ont connu chacune un avortement dans le passé.
III.6. Antécédent de césarienne
Tableau V : Répartition des césarisées selon l’antécédent de césarienne
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort du tableau ci-haut présenté que 70 % des césarisées ont fait mention de l’antécédent de césarienne.
III.7. Antécédent de laparotomie
Tableau VI : Répartition des césarisées selon l’antécédent de laparotomie
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort de ce tableau que 10 % des accouchées par césarienne ont présenté l’antécédent de laparotomie.
III.8. Antécédent d’appendicectomie
Tableau VII : Répartition des césarisés selon l’antécédent d’appendicectomie
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le tableau ci-haut présenté indique que 17,5 % des césarisés connu l’antécédent de d’appendicectomie.
III.9. Antécédent de myomectomie
Tableau VIII : Répartition des césarisées selon l’antécédent de myomectomie
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort de ce tableau que 7,5 % des césarisées ont subi dans le passé une intervention chirurgicale dite myomectomie.
III.10. Antécédent de la kystectomie
Tableau IX : Répartition des césarisées selon l’antécédent de la kystectomie
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort du tableau IX que seules 2,5 % des accouchées par césarienne ont présenté l’antécédent de kystectomie.
III.11. Taille
Tableau X : Répartition des césarisées selon la taille
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le tableau ci-haut présenté indique que 67,5 % des accouchées par voie haute avaient une taille inférieure ou égale à 169 centimètres. La taille moyenne a été de 158±12 cm et la taille minimale de 130 cm et la taille maximale de 185 cm
III.12. Hauteur utérine
Tableau XI : Répartit ion des césarisées selon la hauteur utérine
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le résultat de ce tableau indique que 80 % des femmes enquêtées ont présenté une hauteur utérine comprise entre 32 à 36 cm.
III.13. Âge gestationnel
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Tableau XII : Répartition des césarisées selon l’âge gestationnel
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le tableau ci-haut présenté indique que la majorité des mères césarisées (soit 62,5 % des cas) ont un intervalle compris entre 38 et 42 semaines d’aménorrhée.
III.14. Suivi des CPN
Il ressort de l’étude menée que 100 % des accouchées par césarienne ont initialement suivi la consultation prénatale.
III.15. Nombre des CPN suivies
Tableau XIV : Répartition des césarisées selon nombre de CPN suivies
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort de l’étude menée que 25 mères césarisées (soit 62,5 % des cas) ont bénéficié chacune 4 consultations prénatales.
III.16. Indications de la césarienne
Tableau XIV : Répartition des césarisées selon les indications de la césarienne
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort du tableau XIV que les principales indications de la césarienne ont été, selon l’ordre croissant, les suivantes : la disproportion fœto-maternelle (12,5 %), l’éclampsie (15 %), la souffrance fœtale Aiguë (17,5 %), l’utérus cicatriciel (20 %), le Placenta prævia (30 %), la dystocie cervicale (65 %).
III.17. Complications maternelles
Il se dégage de la figure ci-dessous que 70 % des accouchements par césarienne ont été marqués par des complications maternelles.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Figure 2 : Répartition des complications maternelles
111.18. Types des complications maternelles
Tableau XV : Répartition des césarisées selon les types des complications maternelles
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Saignement excessifs
Il ressort du tableau XV que la répartition des césarisées ont été selon l’ordre croissant, les suivantes : Risque de rupture utérine lors d’une grossesse ultérieure (17,5), Adhérences intra-abdominales (25), saignement excessifs (42,8).
III.19. Complications néonatales
La figure ci-dessous montre que 20 nouveau-nés issus des mères césarisées sur 43 (soit 46,5 % des cas) ont présenté des complications à la naissance.
Figure 2 : Répartition des nouveau-nés selon les complications néonatales
III.20. Issue de la mère césarisée
Tableau XVI : Répartition des césarisées selon l’issue des mères césarisées
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le tableau ci-haut présenté indique que la majorité des accouchées enquêtées ont survécu à l’intervention chirurgicale appelée césarienne, soit 95% des césarisées vivantes.
III.21. Issue du nouveau-né
Tableau XVIII : Répartition des césarisées selon l’issue du nouveau-né
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Il ressort du tableau XVIII qu’environ 9 nouveau-nés sur 10 ont survécu après l’accouchement par césarienne soit 90,7 % des cas.
III.22. Malformation congénitale
Tableau XXI : Répartition des césarisées selon la malformation congénitale des nouveau-nés.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Le tableau ci-haut présenté indique que 7,5 % des nouveau-nés ont connu des malformations congénitales.
CHAP IV: DISCUSSION
IV.1. Âge
Un quart des femmes césarisées étaient âgées de 20 à 24 ans (soit 25 %) et l’âge moyen était de 30 ± 4 ans. Ce qui concorde avec l’étude réalisée au Niger en 2024 par Oumarou Garba qui a rapporté 24,18 % des césarisées âgées de 20 à 24 ans et une moyenne d’âge de 27 ±7 ans (24).
IV.2. Gestité
Dans cette étude, un tiers des accouchées césarisées étaient des paucigestes, soit 36,5 % contre 15 % des multigestes. Ce résultat concorde avec celui trouvé par Mboyo dans une étude réalisée à Kisangani en 2012 selon laquelle 37,7 % des femmes étaient des paucigestes (28).
IV.3. Parité
Dans la présente étude, les paucipares (45,5 %) et les multipares (25 %) se sont avérées les plus fréquentes dans la série tandis que les grandes multipares ont constitué une faible proportion avec 12,5 % des cas. Ceci s’accorde à l’étude menée par Oumarou Garba au Niger en 2024 ayant rapporté 45,22 % des primipares, environ 30 % des multipares et 18,31 % des paucipares (14). Ceci s’expliquerait par le fait qu’une grande progéniture constitue la richesse pour certaines familles dans la culture africaine.
IV.3. Suivi des CPN
Dans la présente enquête, 25 accouchées sur 40 (soit 62,5 % des cas) ont suivi chacune 4 consultations prénatales. Ceci s’écarte d’une étude nigérienne selon laquelle 52,6 % des grossesses ont été suivi avec un minimum de 3 consultations prénatales (18).
IV.4. Prévalence de la césarienne
La prévalence de la césarienne dans la présente étude était de 7,6 %. Ce taux est largement inférieur à ceux mentionnés dans l’étude réalisée en 2013 par Verena et alliés qui ont rapporté une prévalence de la césarienne de l’ordre de 32,6 % en Suisse, d’environ 38 % en Italie et de 20,9 % en France (51). Ce taux est également inférieur à ceux rapportés par l’OMS à l’échelle mondiale, plusieurs pays présentent des taux des césariennes supérieurs au nôtre : l’Australie (30,8 %), l’Allemagne (30,3 %), l’Espagne (24,9 %), le Portugal (33 %), les États-Unis d’Amérique (32,3 %) et le Brésil avec 80 % (52). En RDC, diverses études ont rapporté des faibles proportions des césariennes selon le Provinces : l’ex Province du Katanga (2,6 %), la Ville-Province de Kinshasa (1,9 %) et Kisangani avec 6,6 % (53-55).
IV.5. Indications de la césarienne
Les principales indications de la césarienne étaient la dystocie cervicale (65 %), le placenta prævia (30 %) et l’utérus cicatriciel (20 %). En revanche, une étude algérienne et une étude nigérienne ont trouvé respectivement 16,7 % des cas de dystocie cervicale et 14 % des cas de placenta prævia (56,57). Une enquête réalisée dans la ville de Kisangani a trouvé 17,6 % des cas d’utérus cicatriciel (53).
IV.6. Âge gestationnel
La majorité des mères césarisées (soit 62,5 % des cas) avaient un âge gestationnel compris entre 38 et 42 semaines d’aménorrhée. Ces résultats concordent avec plusieurs études tant nationales qu’internationales ayant mentionné 60,6 % à Kisangani, 75 % en Algérie et 59,3 % au Mali (57-59).
IV.7. Issue de la mère césarisée
Plus de 9 césarisées sur 10 ont survécu à l’intervention chirurgicale, soit 95 % des cas. Ce résultat est supérieur à ceux trouvés par Ipaki et Karounga ayant rapporté respectivement 20 % et 20,2 % des césarisées survivantes (58,60).
IV.8. Issue du nouveau-né
Dans cet échantillon, environ 9 nouveau-nés sur 10 ont survécu à l’accouchement par césarienne soit 90,7 %. Ce résultat concorde avec l’étude réalisée par Mboyo qui a rapporté 92,4 % des nouveau-nés ayant survécu à la césarienne (53). De même, une étude menée aux Cliniques Universitaires de Kisangani a rapporté 85,8 % des enfants vivants après l’accouchement par césarienne (58)
IV.9. Complications maternelles
Il a été observé que 70 % des accouchements par césarienne se sont marqués par des complications maternelles. En revanche, ces résultats se diffèrent de ceux trouvés par Ipaki et Karounga qui ont respectivement rapporté 20 % et 20,2 % de cas des complications maternelles (22,28).
IV.10. Complications néonatales
Dans la présente série, 47 % des nouveau-nés issus des mères césarisées ont présenté des complications à la naissance. Ce résultat ne s’accorde pas avec ceux trouvés par Ipaki et Karounga qui ont rapporté 33,1 et 28 % de cas des complications maternelles (22,28).
CONCLUSION
Le présent travail a porté sur l’accouchement par césarienne à l’HGR Kampemba de Janvier en Décembre 2023. Les données issues des accouchements par césarienne ont été recueillies chez 40 accouchées par césariennes sur un nombre total de 525 accouchements.
La prévalence de la césarienne a été de 7,6 %. La majorité des accouchées enquêtées ont survécu à l’intervention chirurgicale appelée césarienne, soit 95 % des césarisées vivantes. Près de 4 nouveau-nés sur 43 (soit 9,3 % des cas) sont décédés après l’accouchement par césarienne.
Il est crucial de continuer à sensibiliser les professionnels de santé et les futures mères à la diversité des choix concernant l'accouchement. Bien qu'elle soit une solution salvatrice dans des nombreuses circonstances, la césarienne doit être envisagée avec discernement dans le cadre d'une pratique obstétricale humaniste et centrée sur le bien-être de la mère et de l'enfant.
SUGGESTIONS
Au terme de notre étude, nous avons dégagé un certain nombre des suggestions suivantes :
1° À la Division Provinciale de la Santé du Haut-Katanga :
□ D’évaluer l'efficacité des politiques en place concernant l'accès à la césarienne, en identifiant les lacunes et en proposant des recommandations pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes.
□ D’étudier l'impact de la formation continue des professionnels de santé sur la qualité des soins obstétricaux, y compris la césarienne, et son influence sur les pronostics maternels et néonatals.
□ D’évaluer l'accessibilité des services de maternité dans les zones rurales et urbaines, en identifiant les barrières qui empêchent les femmes d’accéder à une césarienne sécurisée en cas de besoin.
□ De mettre en place un système de suivi et d'évaluation des taux des césariennes et des complications associées, afin de mieux comprendre les enjeux locaux.
2° Au comité de gestion de l’HGR Kampemba :
□ De Faire un plaidoyer pour la formation continue des prestataires au Service de Gynéco- Obstétrique.
□ De doter la maternité en matériels et équipements indispensables pour la bonne réalisation des interventions des césariennes.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Munan R, Kakudji Y, Nsambi J, Mukuku O, Maleya A, Kinenkinda P et al. Accouchement chez la primipare à Lubumbashi: pronostic maternel et périnatal. Pan Afr Med J.2017, 28(1):182-182.
2. Lyande IB, Atchalema FT, Elide PE, Kamunyonge JPM, Kumiele PM, Mosongo PL et al. pronostic foeto-maternel de la cesarienne a l’hopital general de reference inera yangambi. ijrdo-j health sci nurs. 2022;7(1):1 -10.
3. Kinenkinda X, Mukuku O, Chenge F, Kakudji P, Banzulu P, Kakoma JB et al. Cesarean section in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo I: frequency, indications and maternal and perinatal mortality. Pan Afr Med J. 2017;27:(72-74).
4. Kaki BB, Biayi MJO, Musasa MP, Mpiana MP, Kinenkinda KX, Ngwe TMJ et al. Césarienne et infections du site opératoire: Aspects épidémiologiques et facteurs associés dans les hôpitaux de la ville de Lubumbashi. Rev Afr Médecine Santé Publique. 2024;7(1):211-29.
5. Malonga FK, Mukuku O, Ngalula MT, Luhete PK, Kakoma JB. Étude anthropométrique et pelvimétrique externe chez les nullipares de Lubumbashi: facteurs de risque et score prédictif de la dystocie mécanique. Pan Afr Med J. consulté le 31 (1) 2018.P.78, consulté le 13 mai 2024, https: //www.ajol.info/index.php/pamj/article/view/207594.
6. OMS Mortalité maternelle. Aide-mémoire N°348. Éditions de l’OMS, Genève. 2015. P P.89, Accessible sur : Mortalité maternelle (Scicin de Google. 2015).
7. ONU Programme de développement durable à l’horizon 2030 : Objectifs et cibles, New York, 2016, p. 20-21.
8. Merzougui L, Marwen N, Hannachi H, Asma M, Ben Elhaj O, Waddah M et al. Incidence et facteurs de risque de l’infection du site opératoire après césarienne dans une maternité de Tunisie: Santé Publique 2018; Vol. 30 :339-47. https://doi.org/10.3917/spub.183.0339.
9. Kasongo K, Kabanga N. Quelques facteurs predictifs de faible poids de naissance a terme et caracteristiques de l’accouchement en milieu rural. (Cas de la Province de Lomami). Rev Médicale Gd Lacs. 2024, p.58, Consulté le 13 mai 2024. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtyp
10. Bukasa JC, Kabamba AM, Mwamba AGK, Ilunga FI, Mukendi AK. Consequences of nosocomial infections in maternity in the city of Mbujimayi/DR Congo. Environ Water Sci Public Health Territ Intell J. 2018;2(1):18-23.
11. Katamea T, Mukuku O, Kamona L, Mukelenge K, Mbula O, Baledi L et al. Facteurs de risque de mortalité chez les nouveaux-nés transférés au service de néonatologie de l’Hôpital Jason Sendwe de Lubumbashi, République Démocratique du Congo. Pan Afr Med J. 19 (1), 2014, p.30 consulté le 13 mai 2024. https://www.ajol.info/index.php/pamj/article/view/134255
12. Ntanga MN, Tawi JM, Ngomb AK, Bukasa PC, Lubo DL, Takulilwe AMK et al. Accouchement sur utérus cicatriciel à l’hôpital général de référence de Katuba à Lubumbashi, République Démocratique du Congo. Rev Infirm Congo. 2021;5(2):48-56.
13. Luhete PK, Mukuku O, Tambwe AM, Kayamba PKM. Étude du pronostic maternel et périnatal au cours de l’accouchement chez l’adolescente à Lubumbashi, République Démocratique du Congo. Pan Afr Med J.Vol 3, N°2, 2018, p. 63, Consulté le 13 mai 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5483363/
14. Wendyam CP, Kabore D. Déterminants de la césarienne de qualité en Afrique de l’Ouest. Santé Publique, Paris, HAL Open Science, 2017, p. 120.
15. de Varèse G, de Varèse A. Accouchement par voie basse ou délivrance par césarienne dans un contexte de périnée cicatriciel? Côlon Rectum. 2019;13(1):46.
16. Ngandu M., Césarienne : Fréquence, indications et complications à l'hôpital du personnel Gécamines Kolwezi, Mémoire inédit, Université de Lubumbashi, 2010, p. 43.
17. Organisation mondiale de la Santé Déclaration de l’OMS sur le taux de césarienne. Rapport 2014. Éditions de l’OMS. Genève, 2014, p. 40.
18. Vogel JP, Betran AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MR, zhang J et al. Utilisation de la classification Robson pour évaluer les tendances de la césarienne dans 21 pays : analyse secondaire de deux enquêtes multinationales de l'OMS. Lancet Glob Santé. 2015; 3 (5):e260- 70.19.
19. Jouet P, Azoulay L, Abenhaim HA. Effet de la peur des procès sur les soins obstétriques : analyse nationale de la pratique obstétrique. Am J Perinatol. 2011; 28(4):277-84.
20. Mi J, Liu F. Le taux de césarienne est alarmant en Chine. Lancet. 2014; 383(9927):1464.
21. Ministère du Plan, MSP/RDC et Macro International. Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2007. Calverton, Maryland (États-Unis d’Amérique), 2008, p. 29-32.
22. Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la modernisation, Ministère de la Santé Publique, ICF International. Enquête Démographique et de Santé en République démocratique du Congo 2013-2014. Rockville, Maryland (États-Unis d'Amérique), 2014, p. 23.
23. Mezhoud S, Ouchtati M. La gestion anesthésique chez la parturiente âgée pour une césarienne au CHU Constantine Thèse de Doctorat [PhD Thesis]. Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine; 2022, p. 322. Consulté le 2 juin 2024. https://dspace.univ-constantine3.dz/jspui/handle/123456789/2983
24. Sigrand O, Laville AC. La césarienne en urgence. Oxymag. 2020;33:8-12.
25. Ndimba BS, Kayembe CK, Binda LK, Mulangu FT, Diamuila CL, Ekangu JF. Perception des primigestes sur les indications de la cesarienne dans la Zone de Santé de Kalamu 1, Ville-Province de Kinshasa, RD Congo. Int J Soc Sci Sci Stud. 2022;2(6):1389-401.
26. Foumane P, Mve Koh V, Ze Minkande J, Njofang Ngantcha EA, Dohbit JS, Mboudou ET. Facteurs de risque et pronostic des césariennes d'urgence à l'hôpital gynéco- etobstétrique pédiatrique de Yaoundé (Cameroun) Médecine et Santé Tropicales. 2014; 24(1):89-93.23.
27. Ntanga MN, Tawi JM, Ngomb AK, Bukasa PC, Lubo DL, Takulilwe AMK et al. Accouchement sur utérus cicatriciel à l’hôpital général de référence de Katuba à Lubumbashi, République Démocratique du Congo. Revue de l’Infirmier Congolais. 2021;5(2):48-56.
28. Mboyo L. La fréquence de la césarienne dans les Hôpitaux de la ville de Kisangani, Mémoire inédit, Faculté de Médecine, Université de Kisangani, 2012, p. 12.
29. Kitengie N, Kasongo K, Tshimanga K. Prévalence, quelques facteurs inhérents et vecu de la menopause en milieu semi-urbain (cas de la ville de mwene-ditu), Kasai Oriental en Republique Democratique du Congo. Revue médicale des grands lacs. 11 (1), 2020, p. 18. Consulté le 13 mai 2024. https://dspace.univ-constantine3.dz/jspui/handle/123456789/2983
30. Kitenge FM, Chenge FM, Kinenkinda XK, Luboya ON, Tshibangu CK, Mashinda DK, et al. Issue vitale, morbidité et mortalité maternelles et périnatales sur accouchement avec utérus cicatriciel dans quelques formations hospitalières de la République Démocratique du Congo Maternal and perinatal morbidity and mortality on the delivery with scarred uterus in maternity hospitals in the Democratic Republic of Congo. Ann Afr Méd 10(2), 2017, p. 9899. Consulté le 13 mai 2024. https://dspace.univ- constantine3.dz/jspui/handle/123456789/2983
31. Ngandu MM. La césarienne; fréquence, indications et complications. Mémoire DEA, santé publique, université de Kindu, la Ville de Kindu, 2014, p. 74. Consulté le 14 mai 2024. https://www.memoireonline.com/06/12/5929/La-cesarienne-frequence-indications-et complications.html
32. Siebold J, François H. Essai d'une histoire de l'obstétricie, Steinheil, Paris, 2020, p. 116.
33. Marcellus Empiricus M. Leges Regiae, Rogatae, Datae, Numa, 2005, p. 282.
34. Bednarski S, Courtemanche A. Sadly and with a Bitter Heart”: What the Caesarean Section Meant in the Middle Ages, Florilegium, vol. 28, 2011, p. 11.
35. Cissé Brahim. La césarienne à la maternité de l’hôpital de Kayes à propos de 215 cas, 2015, p. 54.
36. Lurie S, Mamet Y. Yotzeh dofen, Cesarean section in the days of the Mishna and the Talmud », Israel Journal of Obstetrics and Gynecology, vol. 12, n° 3, 2001, p. 11.
37. Simon DI. La médecine hébraïque au Moyen-Âge, dans Jean-Charles Sournia (dir.), Histoire de la médecine, de la pharmacie, Albin Michel/Laffont/Tchou, , Tome III, 2004, p. 41-42.
38. Green MH, Making Women's Medicine Masculine, The Rise of Male Authority in PreModern Gynaecology, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 409 (ISBN 978-0-19921149-4).
39. Pottiee-Sperry F. L'hysterotomotokie ou enfantement caesarien de François Rousset (Paris, 1581). Le livre d'un imposteur ou celui d'un précurseur ?, Histoire des Sciences médicales, vol. 30, no 2, 1996, p. 259-268.
40. Darmon P. Le mythe de la procréation à l'âge baroque, Seuil, Paris coll. « Points Histoire » (no H48), 1981, p. 213-215. (ISBN 2-02-005778-6)
41. Dumont M, Morel P. Histoire de l'Obstétrique et de la Gynécologie, Simep, Lyon, 2017, p. 59.
42. Vasset S. La querelle des accoucheurs et des sages-femmes en Grande-Bretagne : l'exemple d'Elizabeth Nihell [archive], Cairn info, Littératures classiques, 2019, p. 55.
43. Romero R, Korzeniewski SJ. Are infants born by elective cesarean delivery without labor at risk for developing immune disorders later in life » [archive], Am J Obstet Gynecol, 208(4), 2018, p. 243-246.
44. Anonyme Évolution des taux de césarienne, 2015, p. 32. Consulté le 9.06.2024, https://www.memoireonline.com
45. Dans le monde, la césarienne tue 300 000 femmes par an, sur aufeminin, 2019, p -69.
46. Smaill FM, Grivell RM. Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section [archive], Cochrane Database Syst Rev, 10, 2014, p. 98. (CD007482.)
47. Sabaratnam AS. Best Practice in Labour and Delivery 2nd edition, Cambridge, University Press, Cambridge, 2016, p. 413. (ISBN 978-1-107-47234-1)
48. Merger. M, Levi I, Melchior I. Précis d’Obstétrique, 14ème édition, Masson cié 2014, p. 22.
49. Morin I, Abous P. La césarienne, Revue du Praticien, 2022, p. 44
50. George. Notion élémentaire de santé publique et soins de santé primaires, Édition Dalloz 2015, p. 88.
51. Verena H et Al., Accouchement par césarienne en suisse, santé Médecine, Berne Février 2013 ; 15 pages.
52. Amadou D., Etude de la césarienne avant et pendant la gratuité au CSR de KANIEBA, Monographie inédite, Bamako, 2009-2010.
53. Mboyo L. : La fréquence de la césarienne dans les Hôpitaux de la ville de Kisangani, Mémoire inédit, Faculté de Médecine, Université de Kisangani 2011-2012.
54. Luka A, Etude multi critique liée à la mortalité maternelle : facteurs de risque dans la ville de Kisangani, mémoire de spécialisation, UNIKIS, 2012.
55. Munjanja S et Al.; Césarienne au Zimbabwe, Médecine Tropicale ; 2012 ; Mohamed El Béchir et Al., Prévalence de la césarienne à l’hôpital régional de Zouerate, Thèse de Doctorat, Mauritanie 2011.
56. Sidy B., Opération césarienne D’urgence dans le CSR de la commune V du district de Bamako, Thèse de Médecine, Bamako 2010.
57. D.Massart et Al., accouchement forcé en lieu et place de l’opération césarienne post mortem, Revue Médicale de bruxelle 2012, 33 : 58-6.
58. Baboko I., Fréquence et indications de la césarienne à l’HGR de Mangobo, Monographie inédite, Faculté de Médecine/UNIKIS, 2008-2009.
59. Aminata I T., césarienne prophylactique dans le service de gynécologie obstétrique de CSDR IV du district de Bamako, Monographie inédite, Bamako 2019.
60. D.Subtil et Al, Recommandations pour la pratique clinique, conséquence maternelles de la césarienne par rapport à la voie basse au CHRU de Lille, 2010 Cedex ; 590-37.
- Quote paper
- Temple Kabamba (Author), 2025, Accouchement par césarienne dans la ville de Lubumbashi : Prévalence et issue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1584148