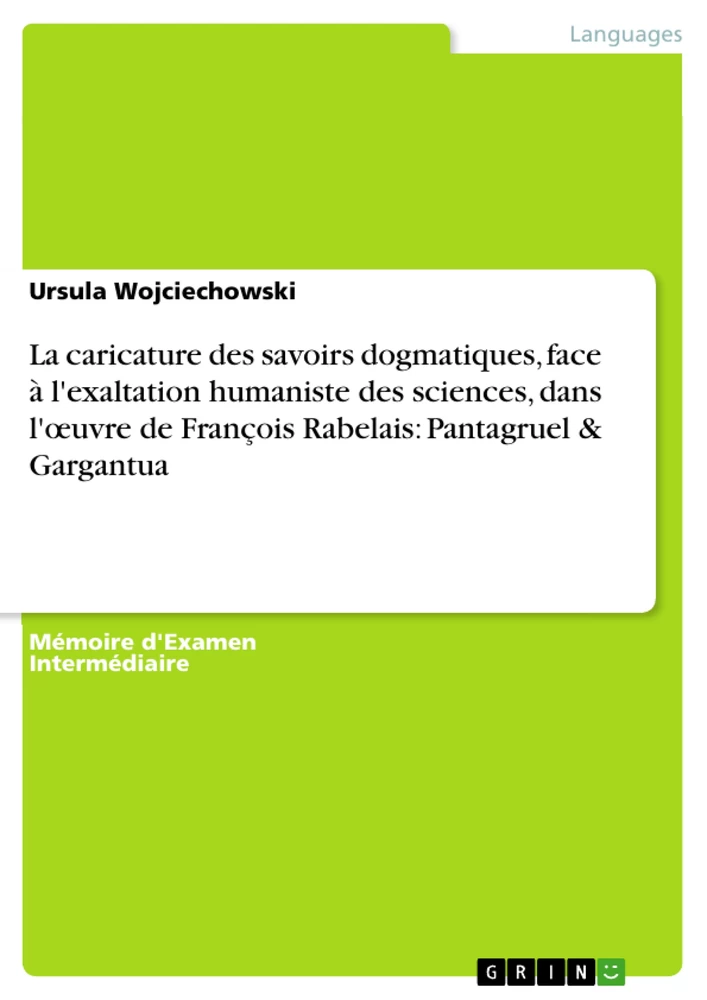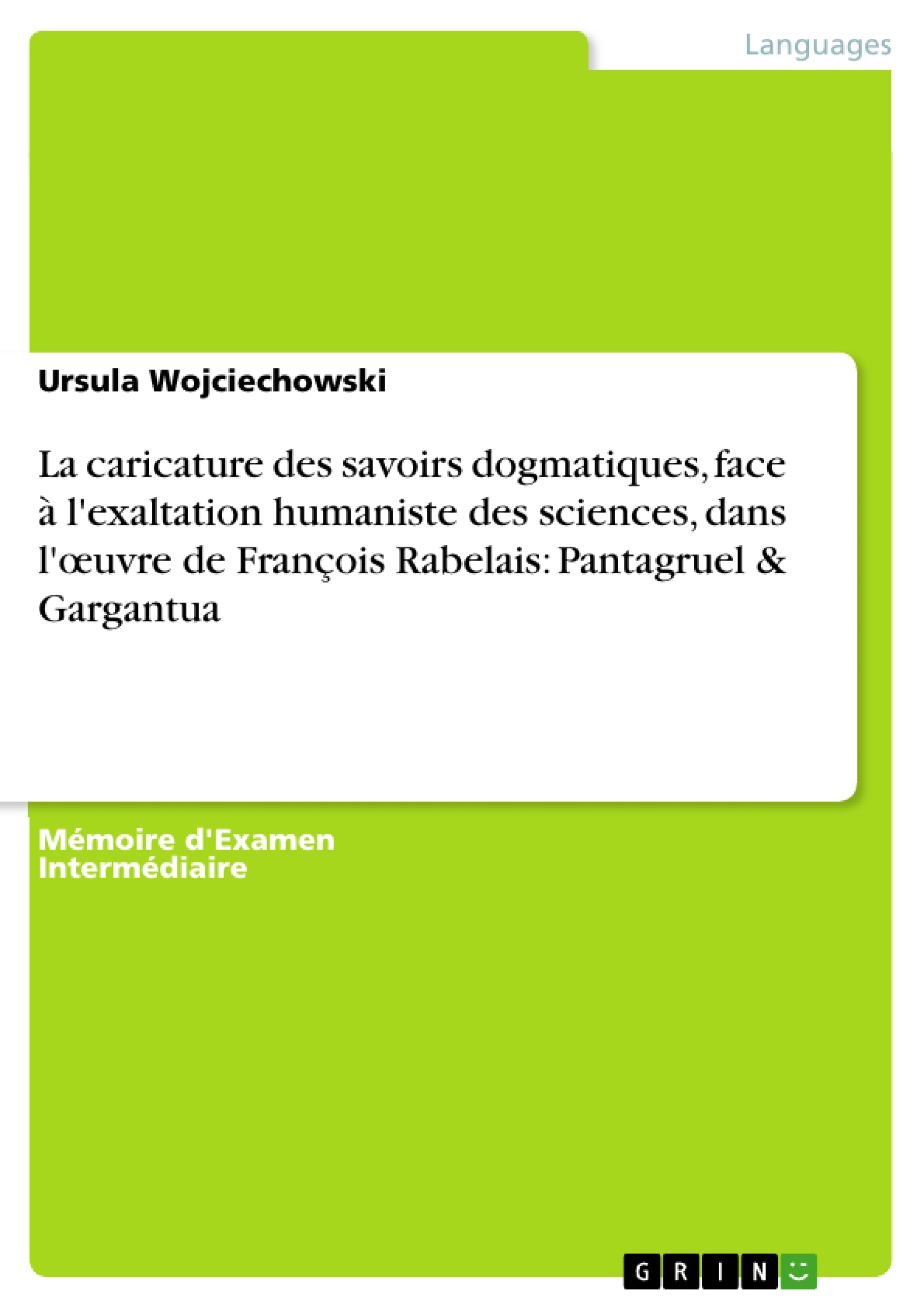Dans ce travail, on essaiera d'éclaircir l'attitude de Rabelais envers les sciences traditionnelles et leurs représentants. Le travail est divisé en trois parties principales qui traitent trois domaines importants de l'époque de Rabelais.
Nous savons que cet auteur aimait se moquer des déportements et de l'hypocrisie du clergé. La première partie montre des particularités comiques, indiquées par Rabelais, qui se réfèrent à la liturgie et aux rites religieux. De même, certains passages sont énumérés qui parodient la Bible.
La seconde partie s'occupe d'un groupe professionnel qui possédait (et possède encore) une influence et un pouvoir énormes, à savoir les juristes. Ils sont à plusieurs reprises attaqués et ridiculisés par Rabelais, pour des raisons graves et évidentes.
Enfin, le domaine de l'ésotérisme, lié à la philosophie néoplatonique, est traité pour montrer que l'œuvre de Rabelais est si complexe qu'elle peut être interprétée à différents niveaux. En même temps, il devient clair qu'aucune des sciences n'est capable de résoudre des problèmes essentiels.
Le volume de ce travail ne permet pas d'y ajouter ni le domaine de la médecine (dans laquelle Rabelais était très versé), ni les nombres mystiques, liés à la Cabale, qui jouent un rôle important dans cette œuvre.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Introduction
- 0.1 La pentalogie de Rabelais: une œuvre homogène et complexe en même temps….........
- 0.2 Les aspects principaux du travail présenté
- 1. Le roman gigantal et la religion
- 1.1 Prêtres, liturgie et rites
- 1.2 Caricature de la Bible
- 2. La jurisprudence dans l'œuvre de Rabelais
- 3. Esotérisme et philosophie dans les derniers livres de la pentalogie
- 3.1 Introduction
- 3.2 La relativité des sciences dans le Tiers Livre
- 3.3 Esotérisme et connaissance de soi-même
- 3.3.1 Cause première et causes secondes
- 3.3.2. La tradition hermétique et platonique dans l'œuvre de Rabelais
- 3.3.3 Apparence et réalité
- 3.4 Le voyage vers la Dive Bouteille
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Haltung von François Rabelais gegenüber den traditionellen Wissenschaften und deren Vertretern. Die Analyse der „Pentalogie“ von Rabelais zeigt, dass er die etablierten Dogmen und Institutionen seiner Zeit kritisch beleuchtet.
- Satire des Klerus und der etablierten Religion
- Kritik der juristischen Praxis
- Exploration esoterischer und philosophischer Ideen
- Relativierung wissenschaftlicher Erkenntnisse
- Bedeutung der humanistischen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Rabelais' "Pentalogie" vor und beschreibt, wie er sich in seinen Werken mit Religion, Staat und Familie auseinandersetzte. Die Kapitel beschreiben die Satire Rabelais' auf das Verhalten des Klerus, die parodierende Darstellung der Bibel und die Kritik an der Jurisprudenz seiner Zeit. Weitere Kapitel setzen sich mit der esoterischen und philosophischen Dimension von Rabelais' Werk auseinander. Hier wird die Relativität der Wissenschaften im "Tiers Livre" analysiert und die Bedeutung der Hermetik und des Platonismus für das Werk von Rabelais dargelegt.
Schlüsselwörter
Rabelais, Pentalogie, Satire, Religion, Klerus, Bibel, Jurisprudenz, Esoterik, Philosophie, Platonismus, Hermetik, Humanismus, Wissenschaft, Kritik, Dogma, Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Haltung nimmt Rabelais gegenüber der Religion ein?
Rabelais verspottet die Hypokrisie des Klerus und parodiert religiöse Riten sowie biblische Passagen in seinem Werk.
Warum kritisiert Rabelais die Juristen?
Er greift die Jurisprudenz an, weil er sie als machtbesessen und realitätsfern ansieht, und nutzt Satire, um ihre Praktiken lächerlich zu machen.
Welche Rolle spielt die Esoterik in Rabelais' Pentalogie?
Esoterische Themen, wie der Neuplatonismus und die Hermetik, zeigen die Komplexität des Werks und deuten darauf hin, dass traditionelle Wissenschaften allein keine essentiellen Probleme lösen können.
Was bedeutet "humanistische Exaltation der Wissenschaften" bei Rabelais?
Es beschreibt die Begeisterung für neues Wissen und Bildung, die im Kontrast zur Karikatur veralteter, dogmatischer Lehren steht.
Was ist das Ziel der Reise zur "Dive Bouteille"?
Die Reise symbolisiert die Suche nach Wahrheit und Selbsterkenntnis jenseits starrer wissenschaftlicher Dogmen.
- Quote paper
- Ursula Wojciechowski (Author), 1997, La caricature des savoirs dogmatiques, face à l'exaltation humaniste des sciences, dans l'œuvre de François Rabelais: Pantagruel & Gargantua, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162778