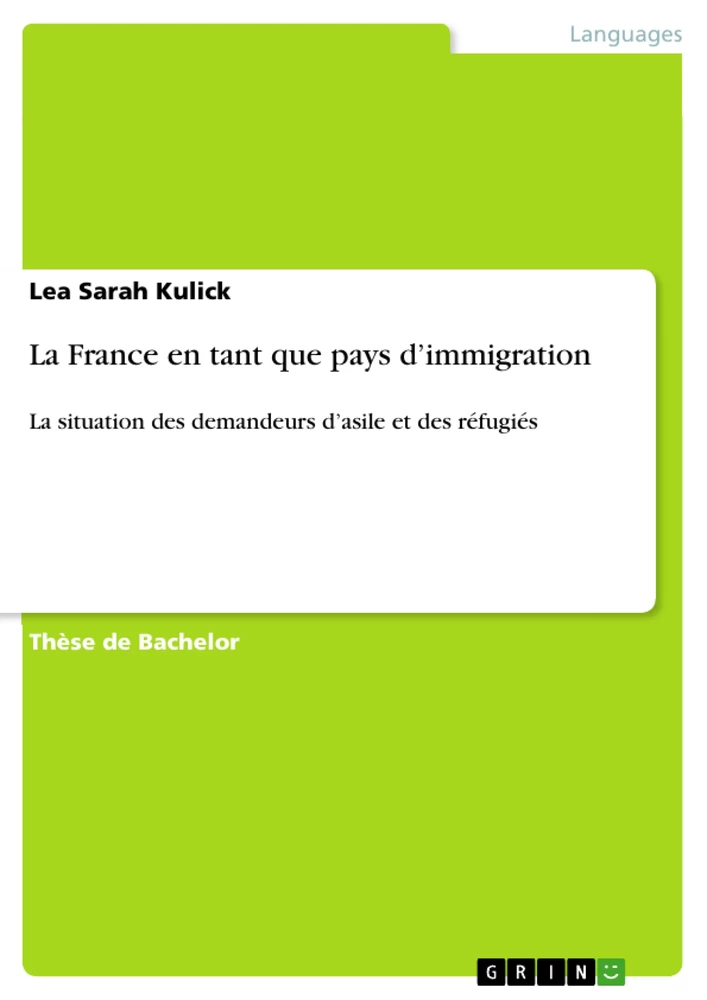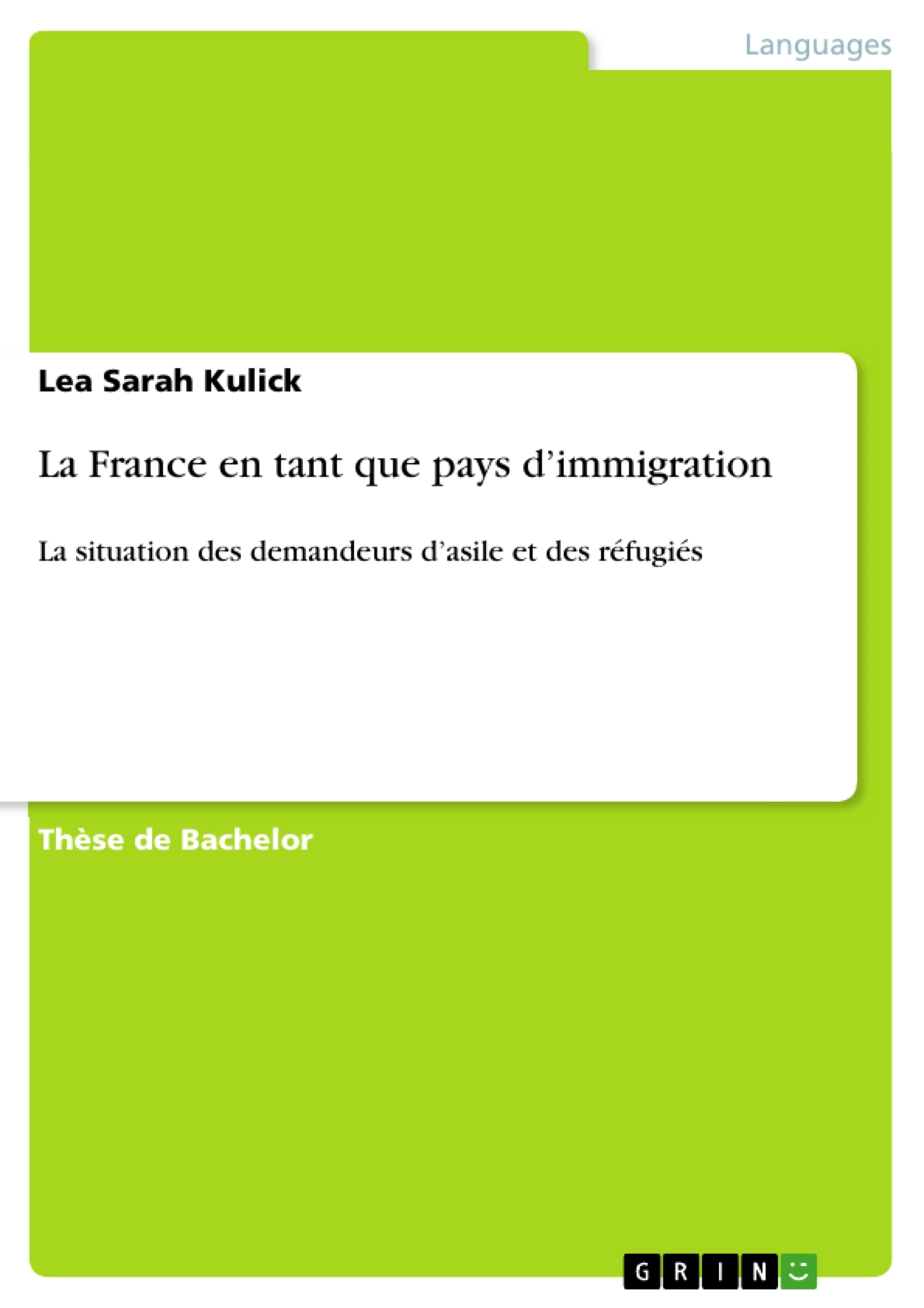Ce travail se consacre à la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés en France. Cet Etat est plus marqué par ses expériences historiques d’immigration que ses voisins européens et il possède une longue tradition en matière d’asile politique. Un aperçu de l’histoire d’immigration montre que la politique d’immigration ainsi que le droit d’asile en France se sont considérablement développés. De plus, les chiffres actuels de demandes d’asile indiquent que la France est encore le premier pays d’accueil en Europe et le taux d’avis positif est assez élevé par rapport à d’autres pays européens.
Pourtant, il existe de nombreux problèmes concernant le respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile et des réfugiés. La législation leur n’est pas favorable et des exemples de cas particuliers illustrent explicitement que les demandeurs d’asile sont souvent traités de manière inhumaine. Les autorités responsables (comme le Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire) semblent uniquement être capable de négliger les problèmes existants ou d’agir par des mesures sévères. De plus, la France est encore souvent nommée le pays des droits de l’Homme. Mais malheureusement, le traitement des demandeurs d’asile et des réfugiés n’est pas conforme à cette image de la France.
Cependant, il y a des associations luttant contre les violations des droits de ces personnes. Ce qui montre qu’une certaine solidarité existe toujours au sein d’une partie de la population qui veut que l’on prenne au sérieux la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés, et les considère réellement comme des victimes.
Mais dans l’ensemble, il est difficile de parler encore de la France en tant que terre d’asile, étant donné que le respect qu’on accorde à un être humain et à ses droits fondamentaux n’est guère existant vis-à-vis des demandeurs d’asile et des réfugiés.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Situation der Asylsuchenden und Flüchtlinge in Frankreich. Dieses Land ist mehr geprägt von seinen geschichtlich bedingten Erfahrungen mit dem Phänomen der Einwanderung als seine europäischen Nachbarn und es verfügt über eine lange Tradition im Bereich des politischen Asyls. Ein Überblick über die Geschichte der Einwanderung verdeutlicht, dass sich die Einwanderungspolitik sowie das Asylrecht in Frankreich bedeutend entwickelt haben. Außerdem zeigen die aktuellen Zahlen der Asylanträge, dass Frankreich innerhalb Europas...
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Histoire de la politique d'immigration
- 1850-1914: Début d'une immigration considérable en France
- 1914-1931: Pôle mondial de l'immigration
- 1931-45 Répercussions de la crise économique et ‘l'abîme' de Vichy
- 1945-55 Après-guerre, la reconstruction
- 1955-68 L'immigration économique
- 1968-74: L'immigration, un problème social
- 1974-81 Contrôle des flux migratoires
- 1981-95: Une nouvelle politique d'immigration sous les socialistes ?
- 1995-2002: Protestations des sans-papiers
- 2002-2007 : La politique de l'immigration de Nicolas Sarkozy
- Données actuelles
- Chiffres de l'immigration et des demandes d'asile
- Immigration en France métropolitaine
- Demandeurs d'asile et réfugiés en France métropolitaine
- Autorités officielles françaises
- Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire
- Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Dispositions relatives au droit d'asile
- Les trois catégories du statut de réfugié
- La procédure d'une demande d'asile
- Restrictions du droit d'asile
- Politique actuelle sous la présidence de Nicolas Sarkozy
- Problèmes actuels
- Situation et traitement des immigrés
- Zones d'attentes
- Dépôt du dossier
- Recours
- Aide financière
- Nombre de places d'accueil
- Cas particuliers
- Exemple d'une expulsion avant l'exercice du droit au recours suspensif
- Exemple des conditions inhumaines de maintien dans les aérogares de Roissy
- Exemple de la situation des étrangers dans la région de Calais
- Impacts sur la situation des demandeurs d'asile et des réfugiés
- Die Geschichte der Einwanderung in Frankreich mit Schwerpunkt auf Asylrecht und Flüchtlinge
- Die aktuelle Situation von Einwanderern, Asylsuchenden und Flüchtlingen in Frankreich
- Die französische Einwanderungspolitik und deren Auswirkungen auf Asylsuchende und Flüchtlinge
- Die Herausforderungen und Probleme, denen Asylsuchende und Flüchtlinge in Frankreich begegnen
- Beispiele für die Verletzung von Rechten und die inhumanen Bedingungen in Frankreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der aktuellen Situation der Asylsuchenden und Flüchtlinge in Frankreich und analysiert die Entwicklung der französischen Einwanderungspolitik im historischen Kontext. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen und Problemen, denen sich Asylsuchende und Flüchtlinge in Frankreich gegenübersehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Bedeutung des Themas und die Relevanz der Einwanderungsgeschichte für die heutige französische Gesellschaft beleuchtet. Anschließend wird die Entwicklung der französischen Einwanderungspolitik von 1850 bis heute im Detail beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich den aktuellen Daten zur Einwanderung, den Asylantragszahlen und der Rolle der zuständigen französischen Behörden. Dabei wird auch auf die rechtlichen Bestimmungen zum Asylrecht und die verschiedenen Kategorien des Flüchtlingsstatus eingegangen.
Im vierten Kapitel werden die aktuellen Probleme im Umgang mit Einwanderern, Asylsuchenden und Flüchtlingen in Frankreich aufgezeigt. Es werden Beispiele für die Verletzung von Rechten und die inhumanen Lebensbedingungen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Themen Asylrecht, Flüchtlinge, Einwanderung, Frankreich, Politik, Menschenrechte, soziale Probleme, Diskriminierung, Integration, Inklusion, aktuelle Situation, historische Entwicklung, Probleme, Herausforderungen, Rechtssystem, Behörden, französische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Frankreich als klassisches Einwanderungsland?
Frankreich ist durch seine Kolonialgeschichte und eine lange Tradition des politischen Asyls stärker von Einwanderung geprägt als viele seiner europäischen Nachbarn.
Welche Probleme haben Asylsuchende in Frankreich heute?
Trotz hoher Aufnahmezahlen gibt es Kritik an unmenschlichen Behandlungen, prekären Bedingungen in Wartezonen (z.B. an Flughäfen) und einer Gesetzgebung, die den Schutz der Grundrechte oft vernachlässigt.
Wie hat sich die Einwanderungspolitik unter Nicolas Sarkozy verändert?
Die Arbeit analysiert die strengeren Maßnahmen und die politische Ausrichtung der Ära Sarkozy (2002-2007) im Hinblick auf Grenzkontrollen und Abschiebungen.
Was sind "Zones d'attentes"?
Dies sind Wartezonen an Grenzen und Flughäfen, in denen Asylsuchende festgehalten werden, bevor über ihre Einreise oder Abschiebung entschieden wird, oft unter völkerrechtlich kritisierten Bedingungen.
Welche Rolle spielen Hilfsorganisationen in Frankreich?
Zahlreiche Assoziationen kämpfen gegen die Verletzung von Menschenrechten und zeigen Solidarität mit Flüchtlingen, die sie als Opfer politischer oder inhumaner Umstände betrachten.
- Citar trabajo
- Lea Sarah Kulick (Autor), 2009, La France en tant que pays d’immigration, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166936