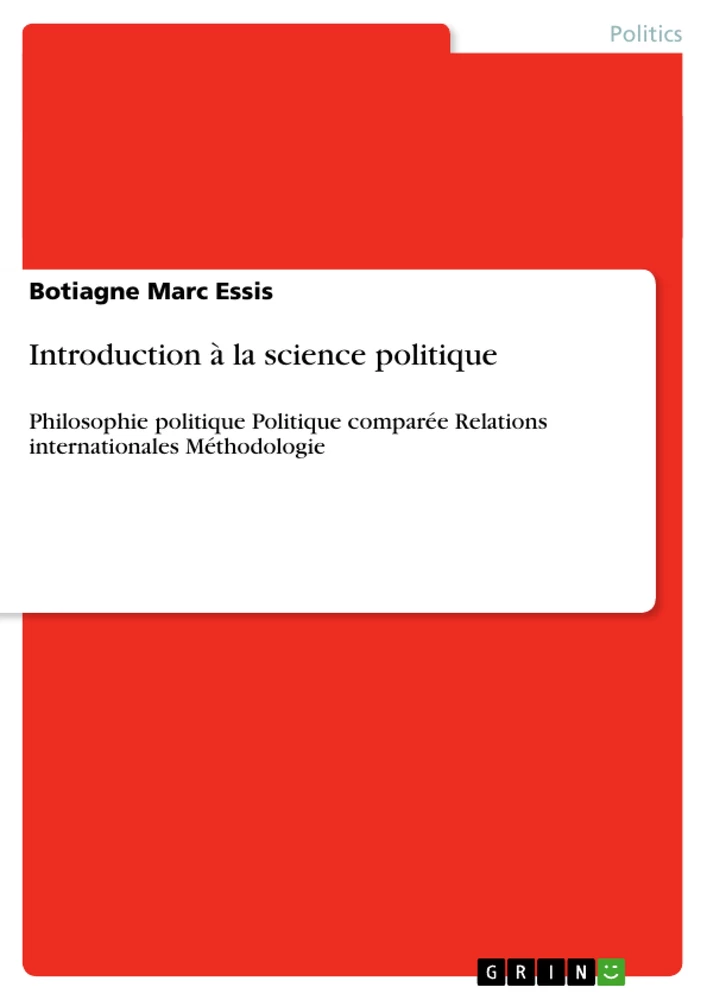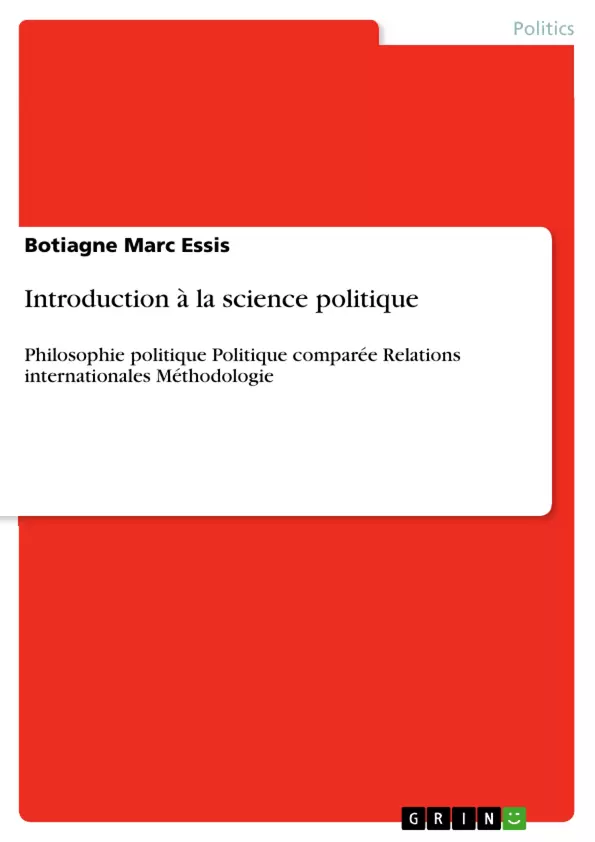Qu‟est-ce que la science politique ?, Quelle en est l‟organisation en tant que discipline académique ?, Quelles mutations organisationnelles et paradigmatiques cette discipline a-t-elle subies au fil du temps ?, Enfin, sur quels fondements épistémologiques et méthodologiques la science politique repose-t-elle ? Telle est la série de questions à laquelle cet ouvrage essayera humblement d‟apporter des réponses.
Pour ce faire, il sera, dans un premier temps, question de présenter la subdivision classique de la discipline des sciences sociales qu‟est la science politique (1). Il s‟agira ensuite d‟évoquer certaines déclinaisons thématiques transversales ayant marqué l‟évolution de la discipline (2). Enfin, cet ouvrage s‟appesantira sur les approches épistémologiques et méthodologiques qui auront, jusque-là, marqué aussi bien la recherche que l‟enseignement en science politique (3).
Inhaltsverzeichnis
- Préface
- Introduction
- Subdivision classique de la science politique
- Philosophie politique
- Philosophie politique de l'Antiquité
- Philosophie politique du Moyen-âge
- Philosophie politique moderne
- Philosophie politique postmoderne
- Politique comparée
- Notion de système politique
- Notion de comparaison
- Relations internationales
- Emergence des Relations internationales
- Théories des Relations internationales
- Le réalisme et le néoréalisme
- Le libéralisme et le néolibéralisme
- La théorie de l'impérialisme
- La théorie de la dépendance
- La théorie de l'interdépendance
- Les théories de l'intégration
- L'institutionnalisme
- Le constructivisme
- Le transnationalisme
- Le féminisme
- Déclinaisons thématiques transversales
- Démocratie et droits de l'Homme
- Résolution des conflits
- Gouvernance
- Sécurité
- Environnement
- Approches épistémologiques et méthodologiques
- L'approche normative et ontologique
- L'approche critique et dialectique
- L'approche empirique et analytique
- Conclusion
- Bibliographie
- Die Teilbereiche der Politikwissenschaft
- Methoden der Politikwissenschaft
- Die Unterscheidung der Politikwissenschaft von verwandten Disziplinen
- Die Bedeutung von interdisziplinärem Denken
- Die Rolle der Politikwissenschaft in Afrika und der Elfenbeinküste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Text „Introduction à la science politique“ zielt darauf ab, ein grundlegendes Verständnis der Wissenschaft der Politik zu vermitteln, insbesondere in Regionen, in denen diese Disziplin noch nicht etabliert ist. Das Werk konzentriert sich auf die verschiedenen Teilbereiche der Politikwissenschaft, von der politischen Philosophie bis zur internationalen Politik, sowie auf die methodischen Ansätze in der Forschung.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung des Buches behandelt die Bedeutung und die verschiedenen Bereiche der Politikwissenschaft, wobei insbesondere auf die Unterscheidung von der Politikwissenschaft zu verwandten Disziplinen eingegangen wird. Das erste Kapitel geht detailliert auf die klassische Einteilung der Politikwissenschaft ein, einschließlich der politischen Philosophie, der Politikvergleichung und der internationalen Beziehungen. Die Philosophie politische wird in ihrer historischen Entwicklung von der Antike über das Mittelalter bis zur Moderne und Postmoderne betrachtet. Die Politikvergleichung wird im Kontext der Systemtheorie und der Vergleichsmethoden diskutiert. Die internationalen Beziehungen werden in ihren historischen Entstehungsprozess und die wichtigsten Theorien, einschließlich Realismus, Liberalismus, Imperialismus und Interdependenztheorie, eingeführt.
Das zweite Kapitel widmet sich den Themen, die in der Politikwissenschaft eine zentrale Rolle spielen, wie beispielsweise Demokratie, Menschenrechte, Konfliktlösung, Governance, Sicherheit und Umwelt. Das dritte Kapitel beleuchtet die verschiedenen epistemologischen und methodischen Ansätze der Politikwissenschaft, darunter die normativen, kritischen und empirischen Ansätze.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Schlüsselbegriffe des Textes umfassen: Politikwissenschaft, Philosophie politique, Politique comparée, Relations internationales, Methodologie, Interdisziplinarität, Afrika, Elfenbeinküste, Demokratie, Menschenrechte, Konfliktlösung, Governance, Sicherheit, Umwelt, Epistemologie, Methodologie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die klassischen Teilbereiche der Politikwissenschaft?
Die Disziplin unterteilt sich klassisch in die Politische Philosophie, die Vergleichende Politikwissenschaft (Politique comparée) und die Internationalen Beziehungen.
Welche methodischen Ansätze gibt es in der Politikwissenschaft?
Man unterscheidet primär den normativ-ontologischen Ansatz (Wertefragen), den kritisch-dialektischen Ansatz und den empirisch-analytischen Ansatz (datengestützte Analyse).
Was ist der Gegenstand der Internationalen Beziehungen?
Dieser Bereich untersucht das Zusammenspiel von Staaten und anderen Akteuren auf globaler Ebene, basierend auf Theorien wie Realismus, Liberalismus oder Konstruktivismus.
Welche Rolle spielt die Interdisziplinarität?
Politikwissenschaft ist eng mit anderen Sozialwissenschaften wie Soziologie, Geschichte und Recht verknüpft, um komplexe gesellschaftliche Phänomene umfassend erklären zu können.
Welche transversalen Themen markieren die Entwicklung der Disziplin?
Moderne Schwerpunkte sind unter anderem Demokratie und Menschenrechte, Konfliktlösung, Governance, Sicherheit und Umweltpolitik.
Was untersucht die Politische Philosophie?
Sie befasst sich mit den ideengeschichtlichen Grundlagen von Macht, Staat und Gerechtigkeit von der Antike bis zur Postmoderne.
- Citar trabajo
- Botiagne Marc Essis (Autor), 2011, Introduction à la science politique, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178852