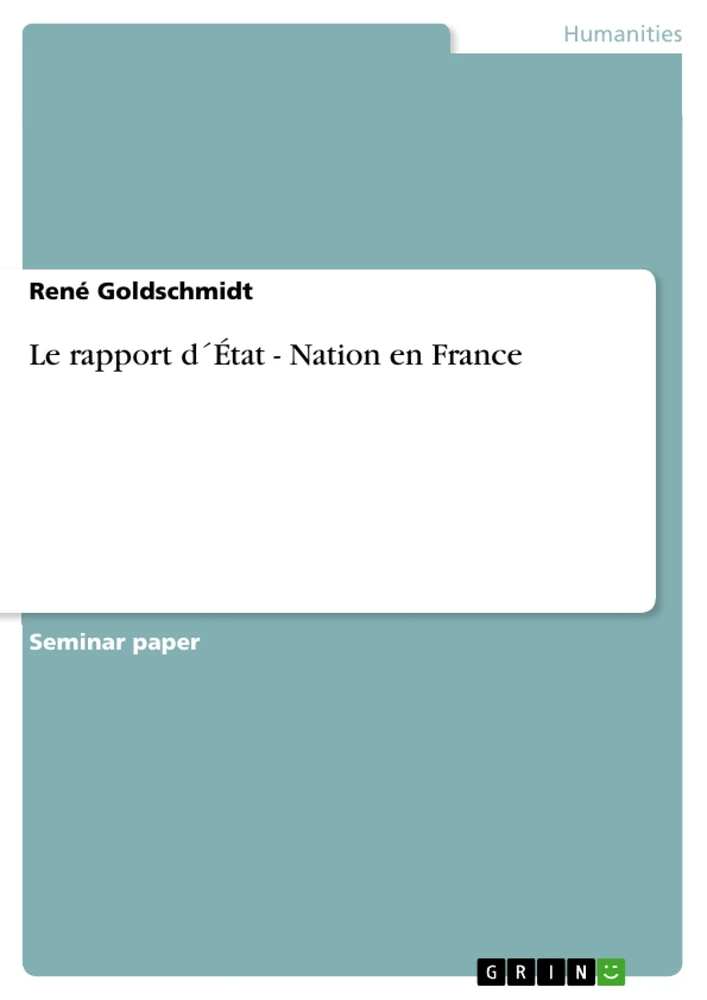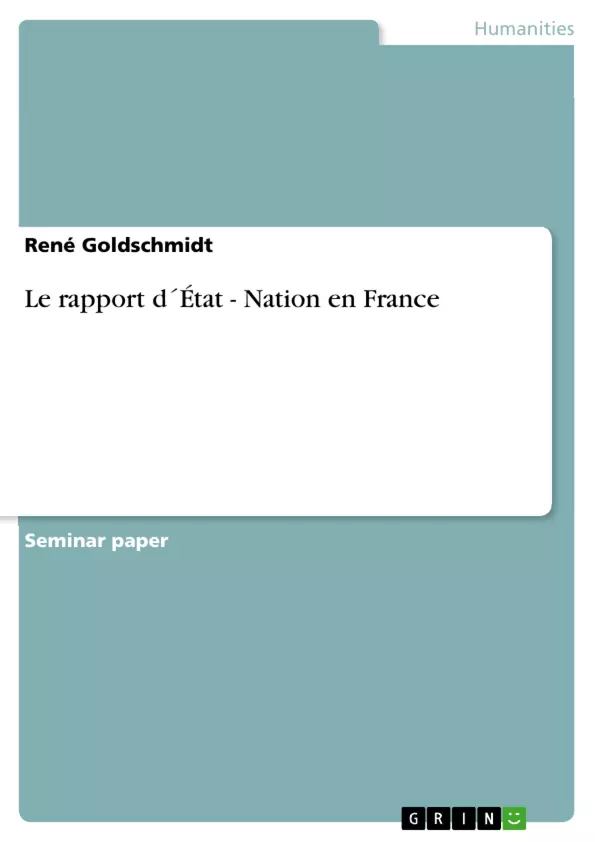Die vorliegende Arbeit ist bemüht den französischen Begriff der Nation, in Abgrenzung von üblichen Nationalbegriffen nach zu zeichnen.
Die ursprüngliche kulturelle Pluralität des heutigen Frankreichs und die etatistische Reaktion darauf werden in einem historischen Abriss dargestellt. Über die Analyse der Spannungsfelder Regionalismus und Zentralismus, Staat und Religion sowie Royalismus und Revolution wird der Leser auf den modernen Nation-Begriff hingeführt werden, der sich in Frankreich spätestens seit der III Republik durchgesetzt hat: die republikanische Nation.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Approche définitoire
- L'État
- La Nation
- Diversité et Unité
- Le régionalisme et la centralisation
- Catholicisme, Protestantisme, Laïcisme – L'État et la religion
- La France et ses Révolutions - La naissance de la République
- La Nation française
- Résumé
- Indication des Sources
- Monographies
- Articles de revues
- Sources internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert das komplexe und oft ideologisierte Verhältnis zwischen den Begriffen „Staat“ und „Nation“. Insbesondere soll die spezifische französische Bedeutung des Begriffs „Nation“ erörtert werden, die sich aufgrund der besonderen Geschichte Frankreichs von anderen, häufig verwendeten Konzepten unterscheidet.
- Definition der Begriffe „Staat“ und „Nation“
- Analyse der historischen Entwicklung des französischen Staates
- Untersuchung regionaler, religiöser und politischer Unterschiede in Frankreich
- Die Rolle von Vielfalt und Einheit in der französischen Gesellschaft
- Die Entwicklung des französischen Nationalbewusstseins im Kontext der Staatsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Introduction: Der Text stellt die Problematik des Verhältnisses zwischen „Staat“ und „Nation“ in Frankreich dar. Die Besonderheit des französischen Nation-Begriffs wird hervorgehoben, und die Struktur des Textes wird erläutert.
- Approche définitoire: In diesem Kapitel werden die Begriffe „Staat“ und „Nation“ definiert. Der Staat wird als eine Organisation mit den Merkmalen Territorium, Volk und politischer Macht verstanden. Die Definition der Nation betont die gemeinsame Abstammung und die Einheit des Volkes.
- Diversité et Unité: Der Text beleuchtet die vielfältigen kulturellen und politischen Unterschiede in Frankreich. Regionen, Religion und Politik werden als wichtige Faktoren betrachtet, die die französische Gesellschaft prägen.
Schlüsselwörter
Dieser Text befasst sich mit zentralen Begriffen wie „Staat“, „Nation“, „Nationalbewusstsein“, „Regionalismus“, „Religion“, „Laizismus“ und „Revolution“. Er analysiert das Verhältnis von Vielfalt und Einheit in der französischen Gesellschaft und beleuchtet die historische Entwicklung des französischen Staates im Kontext seiner besonderen Geschichte.
- Quote paper
- René Goldschmidt (Author), 2010, Le rapport d´État - Nation en France, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182077