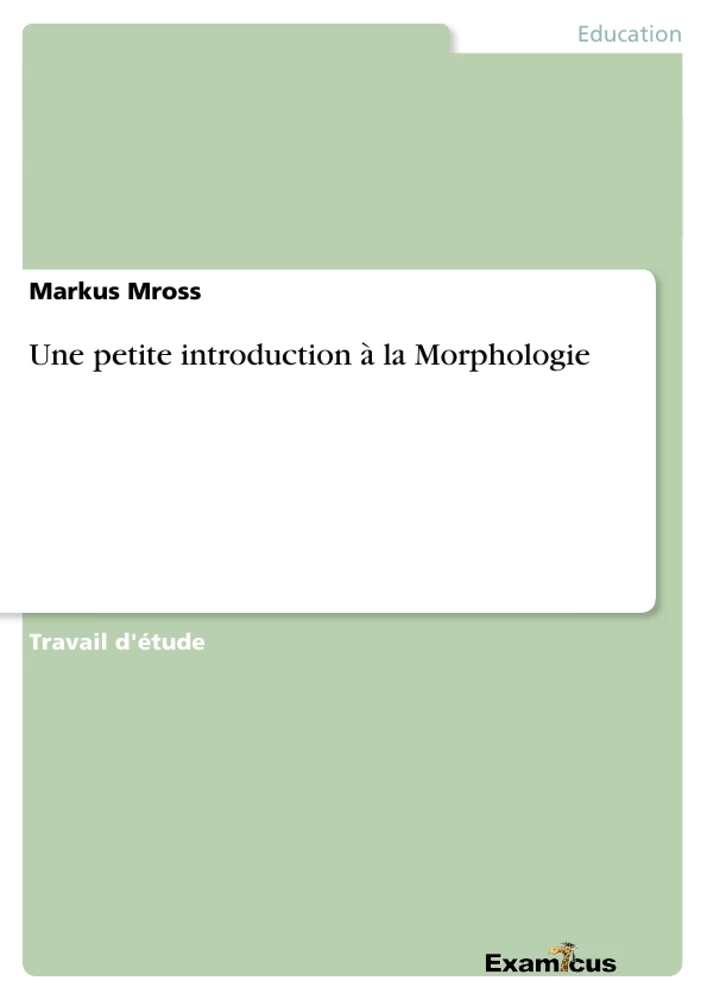Il y a trois types d´opération morphologique; la flexion (la morphologie flexionnelle),
la dérivation (la morphologie dérivationnelle) et la composition.
La flexion: il y a les opérations qui ne donnent pas de mots noveaux (l´ajout de
marques du pluriel, de terminaisons verbales, etc.), l´ajout d´un affixe ne crée pas un
noveau lèxeme (avec un changement au niveau grammatical, genre, nombre, personne,
etc., sans altération du sémantisme de la racine lexicale), les flexions verbales correspondent
à la conjugaison, les suffixes flexionnels ne créent pas de mots noveaux mais
de différentes formes d´un même mot, les suffixes flexionnels indiquent le temps, le
mode, la personne, le genre, les morphèmes flexionnels ne changent pas la nature syntaxique
d´une racine lexicale.
Par contre la dérivation (la morphologie dérivationnelle) ainsi que la composition
représentent des processus de formation de mots qui donnent de mots nouveaux.
Inhaltsverzeichnis
- La flexion, la composition et la dérivation
- La „morpheme based morphology“ et la „lexeme based morphology“
- Le lèxeme, le morphème et l'allomorphie
- De catégories morphologiques lexicales et flexionnelles
- Homonymie, Polysémie, Synonymie, Monosémie, Allomorphie, Morphème zéro
- Le séparationisme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Einleitung in die Morphologie zielt darauf ab, die grundlegenden Konzepte und Prozesse der Wortbildung zu erläutern. Sie befasst sich mit den verschiedenen Arten von morphologischen Operationen, den Beziehungen zwischen Lexemen, Morphemen und Allomorphen und der Unterscheidung zwischen „morpheme based morphology“ und „lexeme based morphology“.
- Flexion, Derivation und Komposition als grundlegende morphologische Operationen
- Das Konzept des Morphems und seine Unterscheidung in lexikalische und grammatische Einheiten
- Die Rolle von Allomorphie bei der Variation von Morphemen
- Die „Sign Base Morphology“ und die „lexeme based morphology“ als zwei verschiedene Ansätze zur Analyse der Wortbildung
- Unterscheidung von lexikalischen und Flexions-Kategorien
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die drei grundlegenden Operationen der Morphologie: Flexion, Derivation und Komposition. Es erklärt, wie diese Operationen die Struktur und Bedeutung von Wörtern beeinflussen.
- Das zweite Kapitel stellt die beiden Ansätze „morpheme based morphology“ und „lexeme based morphology“ gegenüber. Es beleuchtet die Unterschiede in ihrer Betrachtung von Morphemen und Lexemen.
- Das dritte Kapitel konzentriert sich auf das Verhältnis zwischen Lexemen, Morphemen und Allomorphen. Es beschreibt, wie die Bedeutung und die Funktion von Wörtern durch die verschiedenen Formen von Morphemen beeinflusst werden.
Schlüsselwörter
Morphologie, Flexion, Derivation, Komposition, Morphem, Lexeme, Allomorphie, „morpheme based morphology“, „lexeme based morphology“, Sign Base Morphology, lexikalische Kategorien, Flexions-Kategorien.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Grundtypen morphologischer Operationen?
Die Morphologie unterscheidet zwischen Flexion (Beugung), Derivation (Ableitung) und Komposition (Zusammensetzung).
Was ist der Unterschied zwischen Flexion und Derivation?
Die Flexion erzeugt verschiedene Formen desselben Wortes (z. B. Plural), während die Derivation neue Lexeme (Wörter) mit neuer Bedeutung schafft.
Was versteht man unter Allomorphie?
Allomorphie bezeichnet die Varianten eines Morphems, die zwar dieselbe Bedeutung haben, aber lautlich unterschiedlich realisiert werden.
Was unterscheidet "morpheme based" von "lexeme based" morphology?
Es sind zwei Ansätze: Der eine sieht das Morphem als kleinste Einheit, der andere stellt das Lexem (das Wort als abstrakte Einheit) in den Mittelpunkt der Analyse.
Was ist ein "Morphème zéro" (Nullmorphem)?
Ein Morphem, das keine lautliche Entsprechung hat, aber dennoch eine grammatische Funktion oder Bedeutung im Wortaufbau erfüllt.
- Quote paper
- Magister Markus Mross (Author), 2000, Une petite introduction à la Morphologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185941