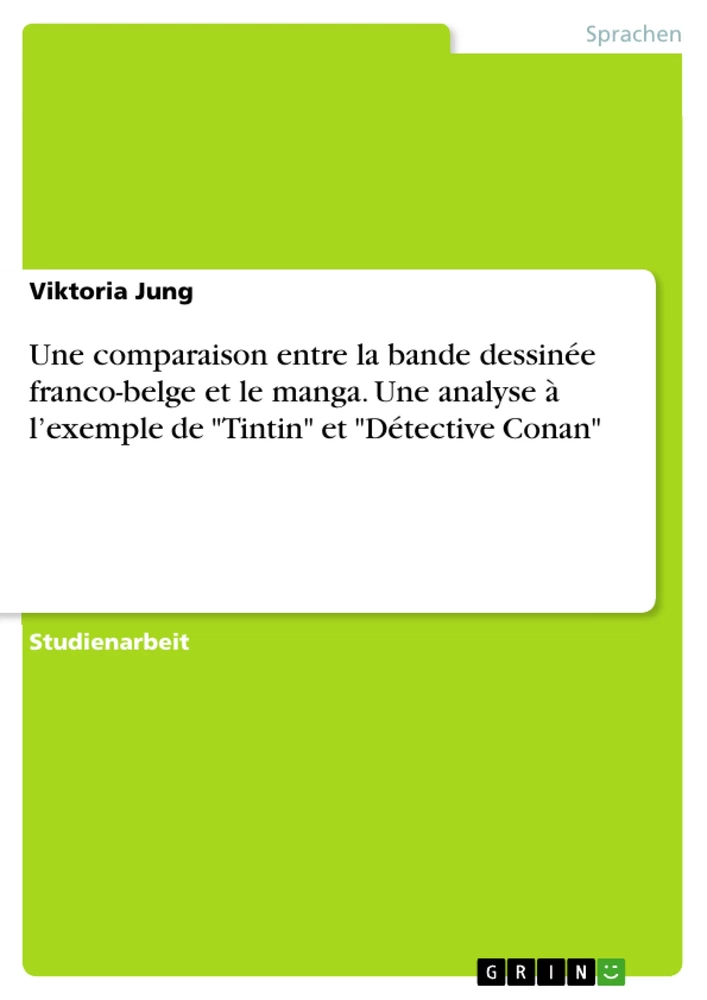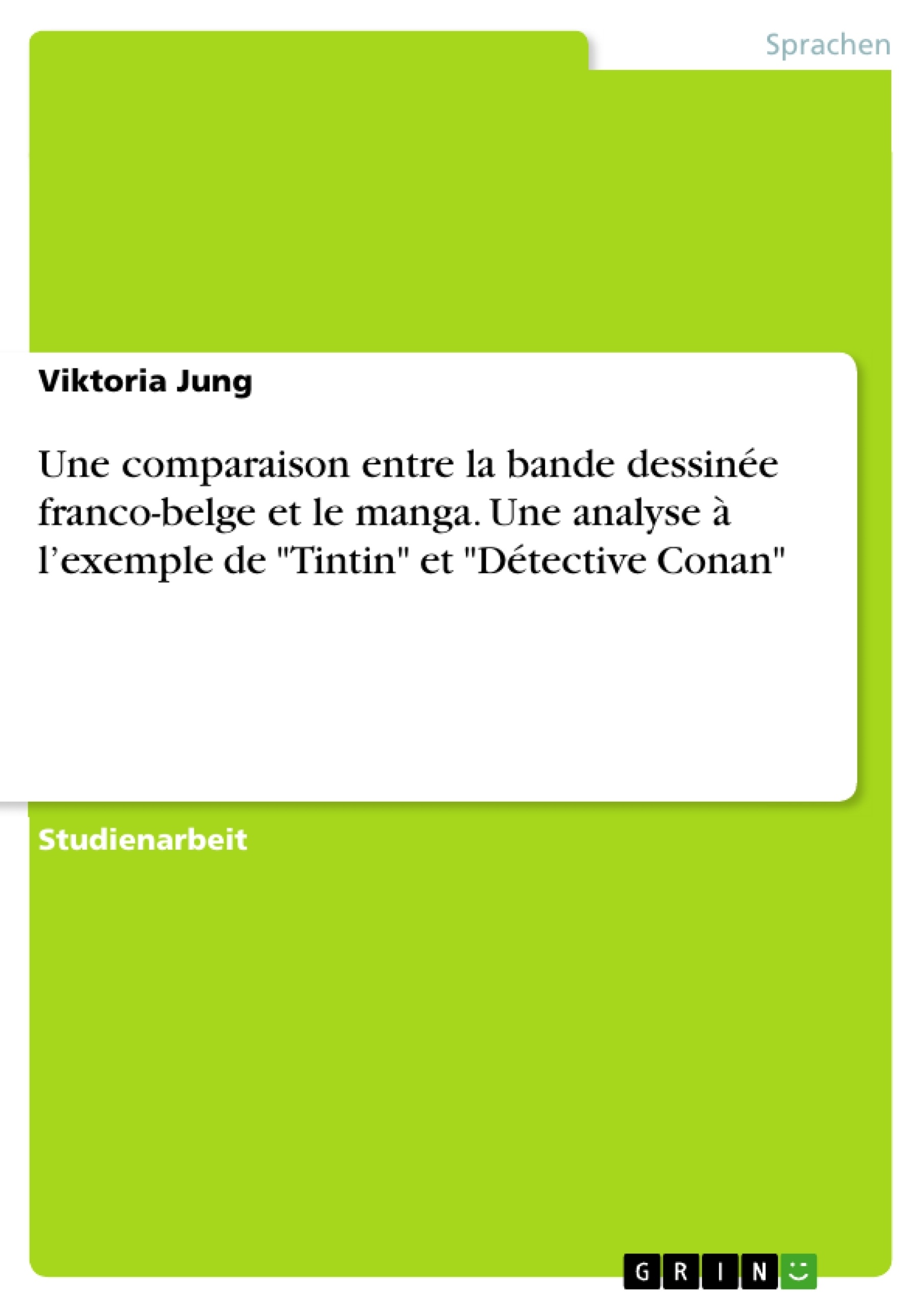Tout le monde les connaît, tout le monde en a déjà lues plusieurs: les bandes dessinées. Quand on parle de bandes dessinées, on pense immédiatement à Astérix, Tintin ou Mickey Mouse. Mais qu‘est-ce que c‘est exactement, une bande dessinée? Des images et des bulles de textes illustrant une bonne histoire pour les enfants? Ou est-ce quelque chose de plus subtil? Dans un premier temps, cette question essentielle devrait être analysée pour avoir une certaine idée de ce dont il s‘agit. Après une présentation brève des caractéristiques générales des bandes dessinées dans laquelle les éléments essentiels d‘une bande dessinée seront énumérés, j’étudierai la base théorique et les aspects d‘analyse pour enfin pouvoir comparer deux bandes dessinées différentes – la première étant Tintin, appartenant au genre bande dessinée franco-belge, et l‘autre Détective Conan, appartenant au genre bande dessinée japonaise, qu‘on connaît plus simplement sous le nom de Manga. Pour avoir non seulement une certaine orientation, mais aussi une base de réflexion pour cette étude, je présenterai avant tout les deux genres différents dans un contexte général. Puis pour une analyse plus approfondie, j’orienterai cette étude sur les œuvres Tintin et Les Bijoux de la Castafiore et Détecitve Conan Tome 1. La problématique de cette étude pourrait donc se révéler ainsi : En quoi la bande dessinée franco-belge et le manga sont-ils si proches et si différents à la fois ? Finalement, le but de ce projet est de tirer une comparaison de ces deux types de bandes dessinées aussi bien sur le fond que sur la forme.
Inhaltsverzeichnis
- Une comparaison entre la bande dessinée franco-belge et le manga
- Introduction
- Définition du terme
- Caractéristiques générales des bandes dessinées
- Eléments d'une bande dessinée
- Aspects d'analyse
- Présentation des différents genres
- La bande dessinée franco-belge
- Le Manga
- Comparaison entre la BD « Tintin » et le Manga « Détective Conan »
- Comparaison thématique
- Comparaison stylistique
- Résumé et Conclusion
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer vergleichenden Analyse der franco-belgischen und japanischen Comic-Kultur, repräsentiert durch die Werke „Tintin“ und „Détective Conan“. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Genres aufzuzeigen und die spezifischen Merkmale der jeweiligen Erzählformen zu beleuchten.
- Definition und Charakteristika der Bande dessinée und des Manga
- Analyse der narrativen Strukturen und stilistischen Besonderheiten
- Vergleich der Themen und Inhalte der beiden Genres
- Untersuchung der kulturellen und historischen Einflüsse auf die Entwicklung der Comics
- Rezeption und Bedeutung der Comics in der jeweiligen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Comic-Analyse ein und stellt die Relevanz des Themas heraus. Sie definiert den Begriff der Bande dessinée und des Manga und skizziert die wichtigsten Merkmale der beiden Genres.
Das Kapitel über die Charakteristika der Bande dessinée und des Manga beleuchtet die spezifischen Elemente und Aspekte der jeweiligen Comic-Form. Es werden die wichtigsten Elemente wie die Vignette, die Sprechblasen und die Onomatopoesie analysiert und in ihren Funktionen und Bedeutungen erläutert.
Die Präsentation der verschiedenen Genres bietet einen Überblick über die Geschichte und Entwicklung der franco-belgischen und japanischen Comic-Kultur. Es werden die wichtigsten Vertreter der jeweiligen Genres vorgestellt und ihre spezifischen Merkmale beleuchtet.
Der Vergleich zwischen „Tintin“ und „Détective Conan“ analysiert die beiden Werke auf verschiedenen Ebenen. Es werden die Themen und Inhalte der Geschichten, die narrativen Strukturen und die stilistischen Besonderheiten der beiden Comics gegenübergestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bande dessinée, den Manga, „Tintin“, „Détective Conan“, Comic-Analyse, Vergleichende Analyse, Narrative Strukturen, Stilistische Besonderheiten, Themen und Inhalte, Kulturelle Einflüsse, Rezeption und Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen franco-belgischen Comics und Mangas?
Die Arbeit vergleicht beide Genres hinsichtlich ihrer narrativen Strukturen, stilistischen Besonderheiten (wie Zeichenstil und Panel-Anordnung) sowie ihrer kulturellen Hintergründe am Beispiel von „Tintin“ und „Détective Conan“.
Welche Werke werden für den Vergleich herangezogen?
Analysiert werden konkret Hergés „Tintin“ (speziell „Les Bijoux de la Castafiore“) als Vertreter der franco-belgischen Tradition und Gosho Aoyamas „Détective Conan“ (Band 1) als japanischer Manga.
Welche formalen Elemente eines Comics werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit erläutert grundlegende Begriffe wie Vignetten (Panels), Sprechblasen, Onomatopoesie (Lautmalerei) und andere grafische Erzählmittel.
Inwiefern unterscheiden sich die Themen von „Tintin“ und „Détective Conan“?
Der thematische Vergleich zeigt, wie klassische Abenteuergeschichten der westlichen Tradition den oft komplexeren, seriellen Kriminalgeschichten der japanischen Manga-Kultur gegenüberstehen.
Welches Ziel verfolgt diese vergleichende Analyse?
Das Projekt möchte aufzeigen, inwiefern sich diese beiden weltweit erfolgreichen Comic-Formen in Form und Inhalt ähneln und wo ihre spezifischen kulturellen Unterschiede liegen.
Was bedeutet der Begriff „Bande dessinée“?
„Bande dessinée“ (kurz BD) ist die französische Bezeichnung für Comics, die im franco-belgischen Raum eine eigenständige künstlerische Tradition mit hohem kulturellem Stellenwert beschreibt.
- Quote paper
- Viktoria Jung (Author), 2011, Une comparaison entre la bande dessinée franco-belge et le manga. Une analyse à l’exemple de "Tintin" et "Détective Conan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289358