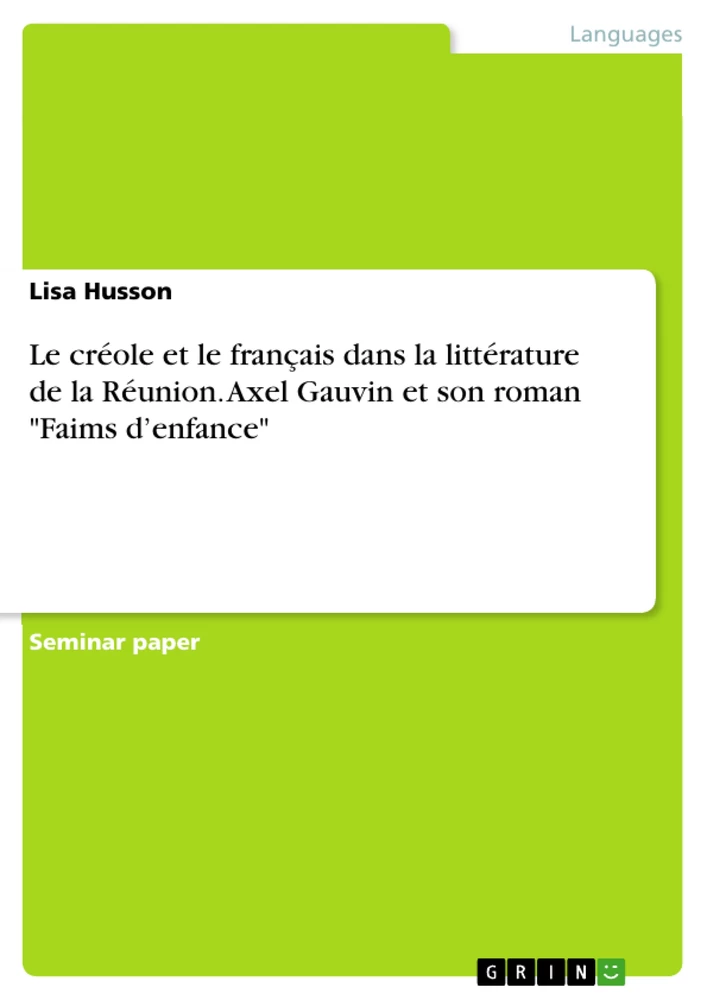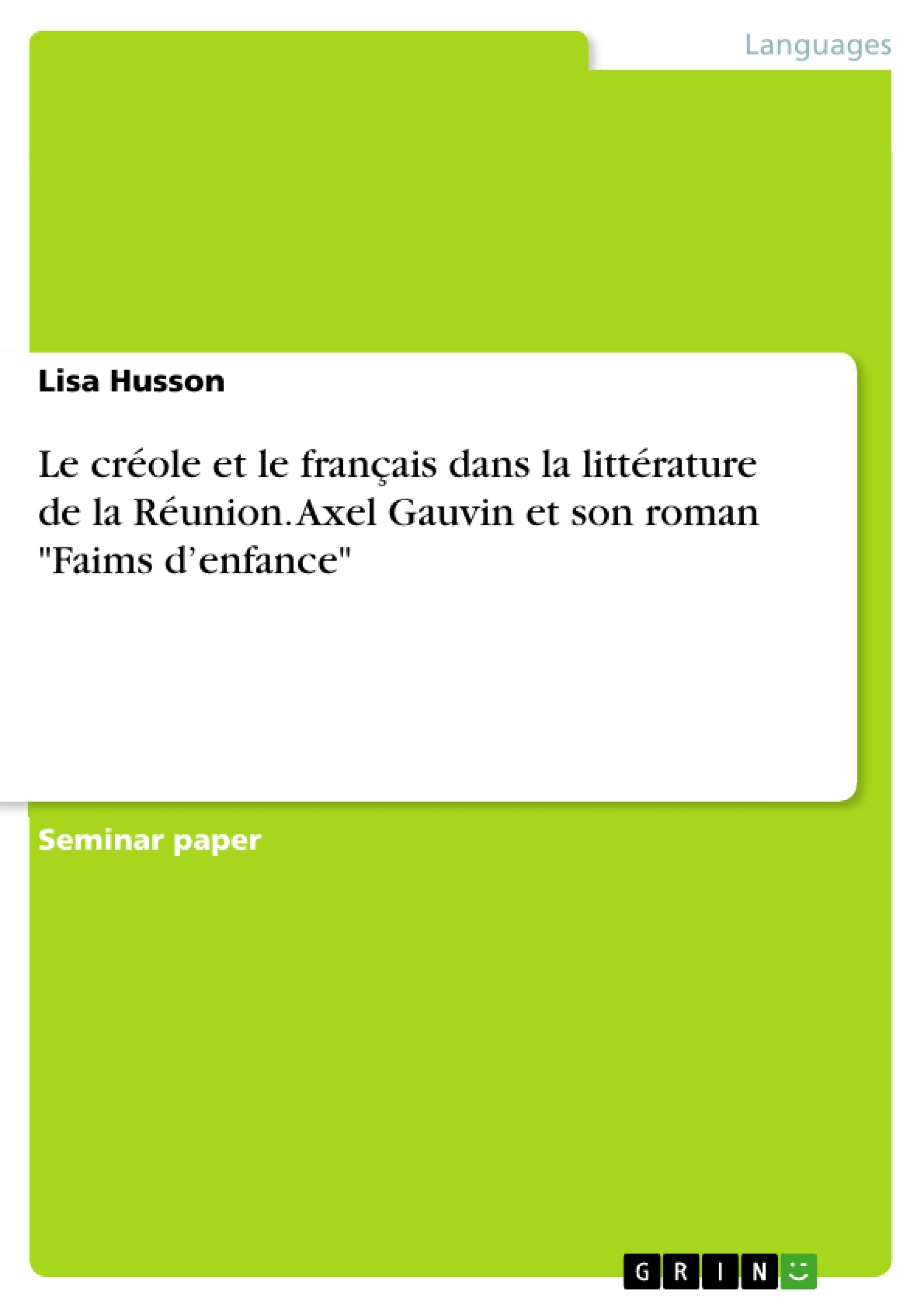En s’abordant avec la francophonie, plus concrètement avec les langues parlés dans les différentes espaces francophones, on remarque très vite que les langues créoles sont beaucoup mieux recherchées que les différentes variations du français.
Au cours du séminaire « Francophonie au grand large » je me suis penché sur la situation sur l’île de la Réunion. Etonnement j’ai pu trouver quelques livres qui se spécialisent, au moins dans quelques chapitres, sur le français réunionnais. Dans cet ouvrage j’éclairerai la situation linguistique réunionnaise, parlerai de l’auteur Axel Gauvin, défenseur de la culture et des langues de la Réunion, et appliquerai les caractéristiques du français réunionnais sur la langue du roman Faims d’enfance pour les prouver par un exemple littéraire.
La Réunion est une île sur laquelle il y a, jusqu’à nos jours, une coexistence de deux parlers : le créole et le français. Axel Gauvin montre dans son roman Faims d’enfance les difficultés d’une troisième culture : les Hindous. Venus d’un autre continent, comme les Français de la métropole, ils ont quand-même le statut inférieur des Créoles. Pour un lecteur qui s’y connaît peut-être seulement dans la culture française et dans la situation des Créoles sur les îles francophones, c’est très intéressant à voir la situation d’un différent point de vue : celui d’une minorité, des Hindous. Pourtant, je ne parlerai pas de la culture des Malabars qui se présente au lecteur du roman Faims d’enfance, je me consacrerai en ce qui suit juste aux activités de l’auteur et à la langue du roman.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- 1. La situation linguistique sur l'île de la Réunion
- 1.1 La situation de vue diatopique, socio-éthique et socio-situationnelle
- 1.2 Le français réunionnais
- 1.2.1 Le français régional réunionnais
- 1.2.2 Le triple rôle de la presse
- 1.2.3 Quelques caractéristiques du français de la Réunion
- 2. Bref aperçu de la littérature réunionnaise
- 3. Axel Gauvin - activiste important pour la culture et la langue réunionnaise
- 3.1 Biographie
- 3.2 Son roman Faims d'enfance
- 3.2.1 Résumé du roman
- 3.2.2 La langue dans les romans d'Axel Gauvin
- 3.2.3 Le français réunionnais dans le roman Faims d'enfance
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Situation auf der Insel Réunion, mit besonderem Fokus auf das Réunion-Französisch. Sie stellt den Autor Axel Gauvin vor, einen wichtigen Verfechter der Kultur und Sprache der Insel, und analysiert die sprachlichen Besonderheiten seines Romans "Faims d'enfance" als literarisches Beispiel.
- Die sprachliche Situation auf Réunion, insbesondere die Koexistenz von Französisch und Kreol
- Die Rolle des Réunion-Französisch als regionale Variante des Französischen
- Die literarische Repräsentation des Réunion-Französisch in Axel Gauvins Roman "Faims d'enfance"
- Axel Gauvins Engagement für die Kultur und Sprache der Insel
- Die Bedeutung der sprachlichen Vielfalt in der Francophonie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fokus der Arbeit und den Kontext der Untersuchung der sprachlichen Situation auf Réunion dar. Das erste Kapitel beleuchtet die sprachliche Situation auf Réunion, wobei insbesondere die Koexistenz von Französisch und Kreol, die Diglossie, sowie die verschiedenen Varietäten des Französischen und Kreol in den Blick genommen werden.
Das zweite Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die réunionnaise Literatur. Das dritte Kapitel widmet sich der Persönlichkeit Axel Gauvins, einem wichtigen Aktivisten für die Kultur und Sprache der Insel. Es beleuchtet seine Biografie und seinen Roman "Faims d'enfance", wobei die sprachlichen Besonderheiten des Romans im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Réunion-Französisch, Kreol, Diglossie, sprachliche Vielfalt, Francophonie, Axel Gauvin, "Faims d'enfance", Literatur, Kultur, Sprache, Insel Réunion.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Axel Gauvin?
Axel Gauvin ist ein bedeutender Autor und Aktivist von der Insel Réunion, der sich leidenschaftlich für den Schutz der lokalen Kultur und der kreolischen Sprache einsetzt.
Worum geht es in dem Roman "Faims d’enfance"?
Der Roman thematisiert die schwierige Situation der indischen Minderheit (Malabaren) auf Réunion und nutzt dabei spezifische sprachliche Merkmale des Réunion-Französisch.
Was charakterisiert das "Français réunionnais"?
Es handelt sich um eine regionale Variante des Französischen, die stark durch den Kontakt mit der kreolischen Sprache geprägt ist und eigene lexikalische und syntaktische Besonderheiten aufweist.
Wie ist das Verhältnis zwischen Kreol und Französisch auf Réunion?
Auf der Insel herrscht eine Situation der Diglossie, in der beide Sprachen koexistieren, jedoch oft in unterschiedlichen sozialen Kontexten (formell vs. informell) genutzt werden.
Welche Rolle spielt die Presse für die Sprache auf Réunion?
Die Presse spielt eine "dreifache Rolle" bei der Vermittlung und Festigung sprachlicher Normen und spiegelt die sprachliche Vielfalt der Insel wider.
- Citar trabajo
- Lisa Husson (Autor), 2010, Le créole et le français dans la littérature de la Réunion. Axel Gauvin et son roman "Faims d’enfance", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298738