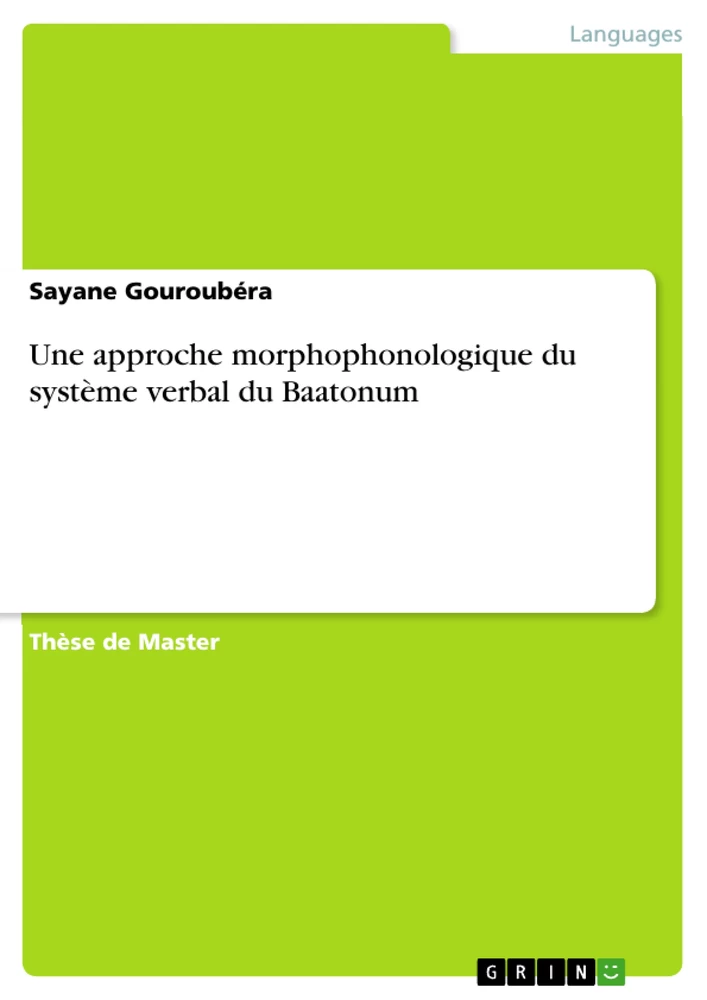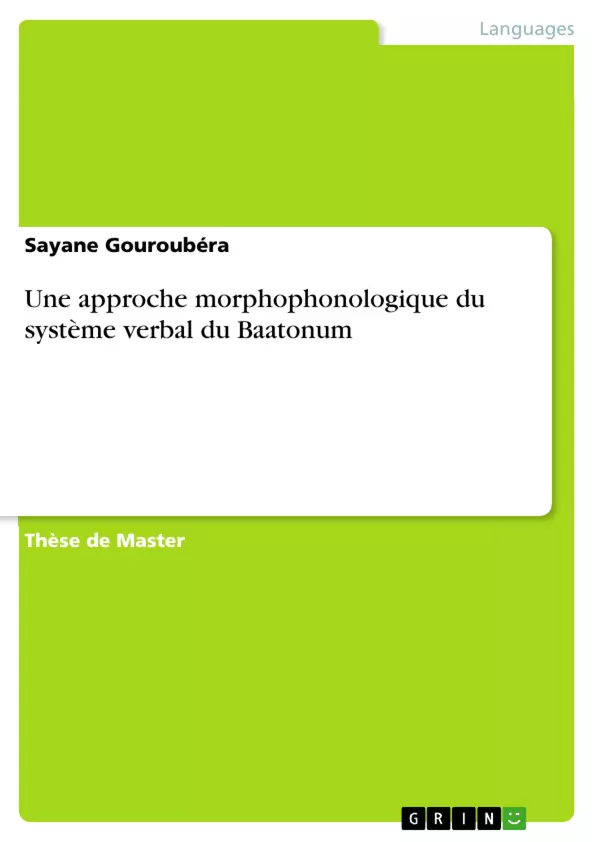Cette étude vise à rendre compte de manière formelle des changements subis par le verbe dans les différents paradigmes de conjugaison en baatonum. Elle est menée dans le cadre théorique de la phonologie autosegmentale et de la géométrie des traits distinctifs.
Sur le plan morphologique, il a été montré que les thèmes verbaux contiennent une voyelle finale dite voyelle thématique qui joue un double rôle, à savoir marquer l'infinitif et dériver des verbes à partir de radicaux polyvalents.
En ce qui concerne les processus morphophonologiques proprement dits, ils sont observés au double plan segmental et tonal. Sur le plan segmental, les processus suivants ont été analysés au niveau des voyelles: élision, assimilation de hauteur, assimilation d’aperture et alternance e/u. L’élision et l’alternance e/u affectent la voyelle thématique, tandis que les assimilations de hauteur et d’aperture affectent principalement la voyelle des radicaux de structure CV–. Les processus affectant les consonnes sont observés avec les radicaux de structure C1VC2–, où C2 peut s’élider, s’adoucir ou être assimilée. La consonne /d/ s’adoucit à [r], et peut s’élider également devant /s/. En dehors de /d/, la consonne /w/ s’élide aussi. Nous remarquons que l’élision de /w/ est systématiquement suivie de l’allongement compensatoire. L’élision de C2 a pour motif principal la simplification de la syllabe C1VC2 qui est marquée. Par ailleurs, la consonne nasale /m/ change en [n] devant l’une des /k, d, s, n/ en position C2. Nous avons interprété ce changement comme étant respectivement issu de la coronalisation par propagation et de la coronalisation par défaut.
Sur le plan tonal, le paradigme considéré est celui des verbes dérivés. Parmi les onze extensions verbales décrites, seul le bénéfactif a un ton propre qui est HB. Le directif, le factitif, le réciprocif, l’allatif, le passif, l’itératif, l’adversatif, l’applicatif, l’inchoatif et le séparatif reçoivent leur ton suivant des règles de propagation et d’assignation tonale. Il y a propagation seulement lorsque le radical verbal porte un ton H’. Nous avons également vu que les changements qu’entraîne le ton de la voyelle thématique jouent un grand rôle dans la formation des schèmes tonals des verbes dérivés. L’analyse tonale des verbes apporte une preuve supplémentaire de la distinction entre ton H’ accent et H non accent. Par ailleurs, cette analyse montre également que la voyelle suffixale /a/ a la propriété d’abaisser les tons.
TABLE DES MATIERES
0. INTRODUCTION
0.1 Généralités sur la langue
0.1.1 Origine des baat mbu
0.1.2 Localisation et situation linguistique
0.1.3 Classification
0.2 Notes préliminaires sur le système verbal du baat num
0.2.1 Revue de la littérature
0.2.2 Quelques précisions d’ordre terminologique
0.2.2.1 Morphophonologie
0.2.2.2 Thème verbal
0.2.2.3 Extension verbale
0.3 Problématique
0.4 Objectif
0.5 Cadre théorique
0.6 Présentation de l’étude
CHAPITRE 1 : PHONOLOGIE DES VERBES
1.0 Introduction
1.1 Consonnes et voyelles
1.2 Syllabes
1.3 Tons
1.3.1 Inventaire des tons
1.3.2 Schèmes tonals des radicaux verbaux
1.3.3 Rappel des règles tonales
1.4 Tons des extensions verbales
1.4.1 Point de méthode
1.4.2 Hypothèses et analyse
1.5 Conclusion
CHAPITRE 2 : MORPHOLOGIE DES VERBES
2.0 Introduction
2.1 Verbes d’action
2.1.1 Structure du radical
2.1.2 Suffixe thématique
2.1.3 Rôle des voyelles thématiques
2.1.4 Extensions verbales
2.2 Verbes d’état
2.2.1 Traits morphologiques des verbes d’état
2.2.2 Statif
2.3 Formation de l’aspect
2.4 Résumé
CHAPITRE 3 PROCESSUS MORPHOPHONOLOGIQUES
3.0 Introduction
3.1 Processus affectant les voyelles
3.1.1 Alternance e/u
3.1.2 Elision vocalique
3.1.2.1 Elision vocalique lors de la formation de l’aspect
3.1.2.1.1 Elision vocalique lors de la formation de l’accompli affirmatif
3.1.2.1.2 Elision vocalique lors de la formation de l’impératif et de l’ingressif
3.1.2.1.3 Elision vocalique lors de la formation de l’accompli négatif
3.1.2.1.4 Elision vocalique lors de la formation de l’habituel
3.1.2.2 Elision vocalique lors de la suffixation des extensions verbales
3.1.3 Assimilation vocalique
3.1.3.1 Assimilation vocalique lors de la formation de l’aspect
3.1.3.2 Assimilation vocalique lors de la suffixation des extensions verbales
3.1.3.2.1 Assimilation vocalique lors de la formation du pluratif
3.1.3.2.2 Assimilation vocalique lors de la formation du séparatifet de l’inchoatif
3.1.3.2.3 Discussion
3.2 Processus morphophonologiques déclenchés par les consonnes
3.2.1 Epenthèse
3.2.2 Lénition
3.2.3 Elision
3.2.4 Processus morphophonologiques affectant la nasale m
3.3 Résumé
CHAPITRE 4 : MORPHOTONOLOGIE
4.0 Introduction
4.1 Séparatif
4.1.1 Présentation des faits
4.1.2 Analyse
4.2 Inchoatif
4.2.1 Présentation des faits
4.2.2 Analyse
4.3 Formation de l’adversatif et de l’applicatif
4.3.1 Présentation des faits
4.3.2 Analyse
4.4 Itératif
4.4.1 Présentation des faits
4.4.2 Analyse
4.5 Formation du réciprocif, de l’allatif et du passif
4.5.1 Présentation des faits
4.5.2 Analyse
4.6 Factitif
4.6.1 Présentation des faits
4.6.2 Analyse
4.7 Directif
4.7.1 Présentation des faits
4.7.2 Analyse
4.8 Bénéfactif
4.8.1 Présentation des faits
4.8.2 Analyse
4.9 Résumé
5. CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
0. INTRODUCTION
Dans ce chapitre introductif, il s’agira pour nous de donner quelques renseignements généraux sur la langue baat nu dans un premier temps. Ensuite, nous donnerons un bref aperçu de notre démarche méthodologique, puis nous présenterons notre étude.
0.1 Généralités sur la langue
0.1.1 Origine des Baat mbu
Si l’origine et la datation du pouvoir wasangari semblent connues, celle des Baat mbu est en revanche incertaine. La tradition orale fait remonter l’origine des baat mbu à leur ancêtre Kisira qui aurait vécu à Badar non loin de La Mecque. Il a fuit pour se protéger des représailles du Prophète Mahomet qui vainement a tenté de le convertir à l’islam. Stewart (1993) montre cependant qu’il n’est nullement évident qu’il s’agit d’une vérité historique, l’existence de Kisira tenant plus du mythe que de la réalité. Stewart rapporte, en revanche, que les Baat mbu ont transité par Dosso dans la vallée du Niger autour du XVe siècle. Là-bas, ils ont fondé un village appelé Nikki dont la population actuelle confirme avoir été précédée par les Baat mbu.
0.1.2 Localisation et situation linguistique
Le baat num est l’une des plus “grandes langues” du nord Bénin. Mais la zone d’extension de cette langue dépasse les frontières béninoises. Des Baat mbu habitent quelques villages dans la partie orientale du Cercle de Sokodé au Togo près de la frontière béninoise selon Lavergne de Tressan (1953). Malheureusement, nous ne disposons d’aucune littérature récente sur ce peuple. Le baat num est également parlé au Nigéria. Selon Grimes (1992), les Baat mbu du Nigéria sont au nombre de 100 000. Le baat num est parlé dans les régions de Okuta, Kaiama et Bussa. Il couvre une aire de 20 000 km2 (Lombard 1965). Au Bénin, le baat num est parlé par 460 000 personnes selon Grimes (1992). Il est parlé sur une aire de 50 000 km2 (Lombard 1965) dans les départements du Borgou et de l’Atacora (ancien découpage). Il est parlé à Kandi, Banikoara, Nikki et Parakou. Au total, le nombre de locuteurs au Bénin et au Nigéria s’élève à 560 000. Il faut souligner que le baat num connaît plusieurs variantes dialectales. Les variations sont aussi bien phonétiques que morphologiques (Prost 1979). Les variantes de Nikki et de Parakou sont considérées comme “centrales” notamment par Welmers (1952) et par Grossenbacher (1974).
Les Baat mbu ont pour voisins immédiats au Sud (dans la Sous-Préfecture de Tchaourou) les Nagos. Ceux-ci parlent le caab qui est un dialecte yoruba. Les faits de contact entre les deux langues sont mal connus. Toutefois, l’hypothèse d’une influence du caab sur le baat num n’est pas exclue. Les Gourmantché, les B tammarib , et les Yowa sont les voisins des Baat mbu au nord-ouest. Il faut noter qu’il s’agit là de langues apparentées au baat num. Au nord-est, les Baat mbu sont côtoyés par les Boko et les Mokolé. Les Baat mbu et les Boko sont historiquement liés (voir Lombard 1965 et Stewart 1993). Les Mokolé sont en revanche locuteurs d’un dialecte yoruba. La majorité des locuteurs du mokolé sont en effet baat nuphones. Enfin, il faut noter que dans la région de Parakou et de Kandi, les Baat mbu cohabitent avec les Dendi locuteurs d’un dialecte songhay.
0.1.3 Classification
L’appartenance du baat num au groupe voltaïque ou gur est désormais certaine. En revanche, la place du baat num au sein de l’arbre généalogique semble toujours poser des problèmes. Naden (1989) classe le baat num comme « Possible Central Gur ». Mais Manessy (1993,1999) précise l’appartenance du baat num au gur central sud à côté du padogho et du kulango :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 1 : le bariba (baat num) parmi les langues gur d’après Manessy (1999 : 16)
0.2 Notes préliminaires sur le système verbal du baat num
0.2.1 Revue de la littérature
Le baat num a fait l’objet d’un nombre considérable de travaux antérieurs. Nous nous attarderons ici sur les auteurs ayant décrit le système verbal. La première monographie consacrée au baat num est celle de Welmers (1952). L’auteur donne un aper u sur la phonologie et la morphologie de la langue. Pour ce qui nous intéresse ici, cet auteur décrit le système verbal du baat num en établissant vingt cinq classes verbales. Divers critères ont motivé cette classification, notamment la forme du « past », la comparaison des formes verbales appelées par lui le « consecutive » et le « continuative » et sur la base de la structure tonale du « consecutive ». Comme on peut le remarquer, cette classification est basée sur le comportement des formes verbales lors de la suffixation des marques aspectuelles et des différentes modalités verbales. Les verbes sont rangés dans une même classe morphologique suivant qu’ils attestent le même processus morphophonologique lors de la suffixation d’un morphème aspectuel donné. Une telle classification est sans doute pertinente en ce qu’elle est pratique pour la didactique. Mais, elle ne fait pas ressortir la régularité du système verbal décrit, parce qu’elle n’explique pas les phénomènes morphophonologiques rencontrés. C’est ce qui explique d’ailleurs le nombre pléthorique de classes morphologiques obtenues.
Les travaux de Welmers ont sans doute influencé la description du système verbal du baat num. En effet, juste après Welmers, on peut citer Soutar (1970), Grossenbacher (1974), Prost (1979), Toungara (1996) et Horn (1998) qui ont travaillé sur le système verbal du baat num.
Soutar (1970), Prost (1979) et Grossenbacher (1974) ont chacun proposé une classification du système verbal du baat num proche de celle de Welmers i.e. basée sur les changements lors de la conjugaison.
Soutar (1970) et Prost (1979) reconnaissent 25 classes verbales comme Welmers. Toutefois, au niveau de la classification « primaire » (celle qui est faite selon la forme de l’accompli), Grossenbacher (1974) identifie sept classes contrairement à Welmers. En dehors de cela, il faut noter qu’il y a des différences terminologiques suivant les auteurs. Ceci pousse Horn (1998) à esquisser une étude des formes verbales du « past » et du « consecutive » de Welmers dans leur occurrence, leur interdépendance et leur compatibilité afin de pouvoir les ranger dans les différentes catégories temporelles, aspectuelles et modales. Mais cet auteur (Horn 1998) ne s’attarde pas sur l’étude et l’explication des processus morphophonologiques rencontrés.
Nous pouvons faire les remarques suivantes :
- les descriptions du système verbal du baat num n’expliquent ni n’analysent les variations de formes ;
- la voyelle finale des verbes joue un rôle important dans la classification ;
- le comportement tonal est un facteur important dans la classification même si les phénomènes tonologiques ne sont pas analysés ;
Compte tenu des remarques ci-dessus, il ressort qu’il existe encore des zones d’ombre dans la morphologie des verbes du baat num. Avant de revenir sur ces points (voir §0.3), il est d’abord important de procéder à des précisions terminologiques.
0.2.2 Quelques précisions d’ordre terminologique
0.2.2.1 Morphophonologie
La morphophonologie peut être définie comme la description des alternances morphophonémiques selon Trask (1996). Elle décrit la structure phonologique des morphèmes et établit les règles de la structure des morphèmes. Dans les langues naturelles, la description morphologique prend nécessairement en compte la variation des formes. L’étude morphophonologique pour nous, revient donc à l’analyse et à l’explication des différents allomorphes. Comme nous venons de le voir, la présente étude exige une étude morphologique munitieuse. Pour ce faire, nous allons définir un certain nombre de termes en évoquant leur implication méthodologique, et en même temps leur pertinence pour la présente étude.
0.2.2.2 Thème verbal
Nous appelons thème verbal dans cette étude, la forme verbale constituée d’un radical et d’une voyelle thématique. Le radical verbal est la partie du verbe qui n’est pas un affixe et à laquelle est lié le signifié. Une telle définition pose un problème. En effet, l’on se demande quels sont les arguments internes militant en faveur de la distinction de deux paradigmes au niveau des verbes, à savoir le paradigme des radicaux verbaux d’une part, et le paradigme des voyelles thématiques de l’autre. En quoi cette distinction peut être pertinente pour notre description morphologique ?
D’entrée de jeu, il faut remarquer que cette hypothèse est fondée sur le fait que dans le lexique, les verbes se présentent sous la forme ‘radical + voyelle thématique’. Comme catégorie morphologique, les voyelles thématiques forment une classe homogène se distinguant par des critères formels. Ainsi, dans le thème verbal, la voyelle thématique est celle qui s’élide lors de la formation de l’aspect par exemple (1a). La voyelle thématique est également sujette à l’alternance vocalique (voir 1b). Nous illustrons notre propos à travers les exemples suivants :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
L’un des arguments supplémentaires militant en faveur de la distinction des voyelles thématiques comme une catégorie morphologique, est leur rôle dans un type de dérivation particulier par lequel des verbes sont formés à partir de radicaux verbo-nominaux. L’on remarque en effet, que les radicaux verbonominaux prennent une voyelle thématique pour devenir des verbes :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
De ce qui précède, il ressort qu’il existe des arguments internes militant en faveur de la considération des voyelles thématiques des verbes comme une catégorie morphologique à part entière. A ce titre, nous verrons dans cette étude que les voyelles thématiques ont un rôle important dans la phonologie/tonologie des verbes du baat num. Nous schématisons la structure du thème verbal de la façon suivante :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 2 : Structure du thème verbal Thème verbal
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
0.2.2.3 Extension verbale
Nous appelons extension verbale le suffixe qui, lorsqu’il est ajouté au thème ou au radical verbal, en modifie le sens. Les thèmes verbaux obtenus après la suffixation des extensions sont des thèmes verbaux élargis. Comme nous le voyons, en baat num, il est pertinent de distinguer deux ordres d’extensions verbales, les extensions de l’ordre et les extensions de l’ordre . Les extensions de 1 2 l’ordre sont suffixées au radical verbal, tandis que les extensions de l’ordre sont 1 2 suffixées au thème verbal. La structure des thèmes et radicaux verbaux élargis est la suivante :
Figure 3
a.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
b.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nous discuterons de la pertinence de cette distinction en § 2.1.4.
0.3 Problématique
En § 0.2.1, nous avons essayé de donner un aper u de l’acquis des travaux sur le système verbal du baat num et la question se pose maintenant de savoir pourquoi une approche morphophonologique du système verbal de cette langue, étant donné que le système verbal est déjà connu. Nous estimons tout simplement que la préoccupation de cette étude est pertinente parce qu’elle n’a pas été prise en compte par les recherches antérieures. En effet, si l’on prend par exemple un thème verbal comme duur-e ‘semer’, il est intéressant de savoir pourquoi il apparaît sous les formes duur-u-, dúúr-ù- et duur- ? Comment rendre compte du changement de /e/ en [u] ? Comment expliquer les changements des tons du radical et de la voyelle thématique ? De ce qui précède, il ressort qu’un morphème verbal peut avoir plusieurs allomorphes. Et comme on peut le remarquer, aucun des travaux antérieurs n’a essayé de rendre compte des variations de forme. C’est la raison pour laquelle nous entreprenons la présente étude.
0.4 Objectif
L’objectif principal de cette étude est de rendre compte des phénomènes décrits dans la section précédente. On remarque que les tons et les segments des morphèmes verbaux changent. L’analyse et l’explication de ces changements de forme est donc notre préoccupation principale. Subsidiairement, nous essaierons de mettre en exergue l’économie du système verbal du baat num, non pas à travers les classes de conjugaison, mais à travers l’analyse et la systématisation des phénomènes morphophonologiques.
0.5 Cadre théorique
Cette étude est descriptive et non théorique. Cependant, le choix du cadre théorique est d’une importance capitale pour nous. En effet, le plus important pour nous est d’expliquer un certain nombre de phénomènes phonologiques. Aussi avons-nous choisi d’utiliser la théorie de la phonologie autosegmentale de Goldsmith (1976) à laquelle nous couplons la géométrie des traits distinctifs (Clements, 1991). Un tel choix théorique nous offre une forte adéquation explicative sur les plans suivants :
(i) l’analyse des changements de voyelle ;
(ii) la description des faits tonals ;
(iii) la description des changements de consonnes.
En effet, l’adoption de la théorie de la géométrie des traits nous permet par exemple de rendre compte d’un cas d’assimilation trancatégorielle, i.e. d’une voyelle par une consonne. D’autre part, l’adoption de la théorie autosegmentale et la théorie de la sous-spécification (Archangeli, 1984) dans la structure profonde nous permet de mieux rendre compte des faits tonals. En effet, la théorie de la sous-spécification permet de poser l’existence d’éléments non spécifiés pour un trait phonologique donné dans une représentation abstraite. Lorsqu’un élément est non spécifié, il est versatile en surface. Lorsque nous transposons cette vision théorique sur les faits tonals, nous remarquons que les schèmes tonals des morphèmes verbaux changent suivant les contextes. Aussi pouvons-nous poser l’existence de morphèmes atonals, i.e. dépourvus de tons dans la forme de base. Les morphèmes atonals reçoivent leur ton de deux manières, soit par propagation ou par une règle d’assignation par défaut. Soulignons que l’adoption d’un cadre théorique strictement linéaire ne nous offrirait pas une telle adéquation explicative.
0.6 Présentation de l’étude
En dehors de l’introduction et de la conclusion, la présente étude est composée de quatre chapitres essentiels. Le Chapitre 1 donne un aperçu des traits phonologiques des verbes du baat num, et rappelle les règles tonales. Le Chapitre 2 présente la morphologie des verbes. Le Chapitre 3 et le Chapitre 4 sont respectivement consacrés à l’analyse des processus morphophonologiques et morphotonologiques.
CHAPITRE 1 : PHONOLOGIE DES VERBES
1.0 Introduction
Le présent chapitre a pour objectif de présenter les traits phonologiques des verbes du baat num. Dans un premier temps il s’agira de présenter le système phonologique de la langue, puis de mettre en exergue des particularités de la distribution des sons dans le système verbal.
1.1 Consonnes et voyelles
En suivant Saka (1989), l’inventaire des consonnes phonologiques du baat num s’élève à quatorze unités reparties dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Consonnes du baat num
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Pour spécifier les consonnes du baat num, nous utilisons les traits [voix],
[coronal], [labial], [dorsal], [nasal], [cons], [continu] et [sonant] en suivant
Clements (1991, 1993) qui prône l’usage unifié des mêmes traits distinctifs aussi bien pour les consonnes que les voyelles. Pour cet auteur, dans la représentation géométrique, les consonnes et les voyelles sont toutes spécifiées pour les mêmes traits de lieu d’articulation qu’il appelle traits de lieu C et trait de lieu V (voir Clements 1993 : 103). A notre avis, cette position théorique permet de mieux rendre compte des rapports entre consonnes et voyelles en baat num. Nous discutons, notamment, d’un cas d’assimilation transcatégorielle, i.e. entre une consonne et une voyelle, en §3.1.3.2.1. Le tableau suivant montre les spécifications des consonnes du baat num :
Tableau 2 : Spécifications des consonnes du baat num
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tableau 3 : Voyelles du baat num
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Pour caractériser les voyelles du baat num, nous utilisons encore le système des traits distinctifs unifiés de Clements (1991, 1993). Ces traits distinctifs nous permettent de mieux rendre compte des changements de hauteur vocalique que les traits [haut] et [bas] traditionnels ne permettent pas de capturer avec précision. Nous discutons de ces processus de changement de hauteur vocalique en §3.1.3.1 et §3.1.3.2.2. Pour spécifier les voyelles nous utilisons les traits [ouvert ], 1 [ouvert ],2[coronal], [labial] et [nasal]. Le tableau suivant montre les spécifications des phonèmes vocaliques du baat num :
Tableau 4 : Spécifications des voyelles du baat num
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Le trait [ouvert] est redondant pour les consonnes. En revanche, il caractérise la hauteur vocalique. En dehors du trait [ouvert], nous avons utilisé les traits [coronal], [labial], [nasal] et [dorsal]. Le trait [coronal] caractérise les voyelles d’avant, tandis que les traits [labial] et [dorsal] caractérisent les voyelles arriéres. Le trait dorsal est redondant au niveau des voyelles postérieures. Nous l’avons inclus dans notre matrice afin de pouvoir rendre compte de la dorsalisation de la voyelle /i/.
1.2 Syllabes
Les types syllabiques suivants sont enregistrés : CV, CVV et CVC. Parmi les morphèmes verbaux, seuls les radicaux peuvent avoir la structure CVC. Les exemples suivants illustrent les types syllabiques du baat num :
(1) a. CV ye ‘cuir’
b. CVV díí.rì ‘trembler’
c. CVC.V seb.e ‘vêtir’
La distribution des consonnes dans les syllabes fermées CVC mérite une attention particulière. Pour des raisons de commodité descriptive, nous matérialiserons cette syllabe par[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] où C est la consonne initiale et C la consonne finale. [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ]peut être l’une quelconque des consonnes du Tableau 1. En revanche, le nombre des unités pouvant apparaître en position C2 est limité. En effet, en position C2, nous avons seulement les consonnes /b m t d n s k w/ :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Comme on peut le remarquer en 6d, la consonne /d/ devient [r] en surface. Nous reviendrons sur ce changement en §3.2.2. Il faut noter que l’inventaire des unités pouvant apparaître en position C2 dans le système verbal est différent de celui du système nominal de par l’existence des consonnes /w/ et /t/. Selon Manessy (1993 : 86), seules les consonnes /b m n d1 s k/ apparaissent en position C2 dans le système nominal du baat num. Par ailleurs, il faut remarquer que l’inventaire
des consonnes en position C2 du système verbal est remarquablement proche de celui reconstruit pour le proto-Oti-Volta : *B, *M, *N, *D, *L, *S, *G (Manessy 1975 : 48) et pour le proto-gurunsi (Manessy 1969 : 30) : *W, *M, *N, *D, *L, *S, *K. Cet auteur pose que ces consonnes en position C2 sont les vestiges d’un suffixe
ajouté au radical CV. Au plan synchronique, aucun argument ne nous permet pourtant de soutenir une telle position pour les consonnes finales du baat num.
1.3 Tons
1.3.1 Inventaire des tons
Le baat num comporte les tons ponctuels S, H, M, B et les tons modulés HB, SB et BM :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
En suivant Doneux (1965) et Gbéto et Gouroubéra (à paraître), nous pensons que seuls les tons S, H et B sont phonologiques. Les tons modulés sont analysables en des séquences de tons ponctuels. La preuve de cette affirmation est le fait que les tons SB et HB varient librement avec S et B. En ce qui concerne le ton BM, il n’apparaît qu’associé à la voyelle thématique /a/ qui a un effet abaissant sur la réalisation tonale. Cette voyelle abaisse donc le ton M qui lui est assigné par défaut comme on le verra dans la section suivante. Lorsque le ton M est abaissé dans ces conditions, il se réalise avec un contour descendant. Ceci produit le ton BM. Par ailleurs, le ton M est assigné par défaut aux UPTs atonales que sont notamment, les suffixes verbaux et certains types de radicaux.
1.3.2 Schèmes tonals des radicaux verbaux
Les morphèmes verbaux pris en compte dans cette description sont les radicaux, la voyelle thématique, les marques aspectuelles et les extensions verbales. Les radicaux verbaux portent les schèmes tonals S, H’, H, HB et . est mis pour les radicaux atonals. En surface, les radicaux atonals portent le ton M qui leur est assigné par défaut :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gbéto et Gouroubéra (à paraître) ont suggéré l’existence de deux types de tons H : le ton H’ accent et le ton H non accent. Le ton H’ est celui qui se propage, tandis que le ton H non accent ne se propage pas. Le ton H’ se rehausse à S devant B, tandis que le ton H ne se rehausse pas. Cette différence est capitale dans la tonologie des verbes dérivés comme nous le verrons au Chapitre 4.
1.3.3 Rappel des règles tonales
Les morphèmes atonals que sont les radicaux verbaux atonals et les voyelles thématiques reçoivent leur ton suivant diverses règles. Selon Gbéto et Gouroubéra (à paraître), les voyelles thématiques reçoivent leur ton, soit par Propagation du Ton H’ (PTH’), soit par Assignation du ton B suffixal (ATBS) par défaut ou par Assignation du ton M suffixal (ATMS). Comme le suffixe /a/, le radical atonal reçoit le ton M par défaut selon ATMR (Assignation du ton M au radical). Le ton M assigné au radical atonal se propage sur la voyelle thématique selon PTMR (Propagation du ton M radical). Nous résumons ces règles en (5) :
(5) a. PTH’ : propager le ton H’ de la gauche vers la droite
b. ATBS : assigner le ton B au suffixe thématique
c. ATMS : assigner le ton M au suffixe thématique /-a/
d. ATMR : assigner le ton M au radical atonal
e. PTMR : propager le ton M assigné au radical sur le suffixe
thématique (de la gauche vers la droite)
ATBS s’applique seulement lorsque le radical verbal porte un ton qui ne se propage pas, i.e. les tons S, H, et HB et que la voyelle thématique n’est pas /-a/. Lorsque la voyelle thématique est /-a/, il y a plutôt assignation du ton M selon ATMS. Il faut noter que l’application des règles entraînent de nouveaux processus que sont le Rehaussement du ton B suffixal (RTBS) devant le ton S, l’Abaissement du ton H’ (Ab-H’) propagé à M par la voyelle thématique /a/, et l’Abaissement de M (Ab-M) assigné à la voyelle thématique /a/, créant le ton modulé BM :
(6) a. RTBS : rehausser le ton B suffixal à M lorsque le radical est intoné S
b. Ab-H’ : abaisser le ton H’ propagé à M lorsque la voyelle thématique est /a/
c. Ab-M : abaisser le ton M à BM lorsqu’il est assigné à la voyelle thématique /a/
Pour illustrer les règles en (5) et en (6), nous proposons de dériver les thèmes [kasu] ‘chercher’, [wobure] ‘se laver’, [sabe] ‘domestiquer’, [gura ] ‘ramasser’, [k kìrì] ‘amadouer’, et [duure] de la manière suivante :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
En dehors des règles ci-dessus, nous avons également des règles tonales qui s’appliquent lors de la formation de l’aspect verbal. Nous n’allons pas rappeler ces règles de façon systématique. Nous allons plutôt citer les règles dont nous avons besoin dans la présente étude. Il s’agit de AHB (Assignation de HB), UH’ (Upstep du ton H’),[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] (Règle de simplification de SB à S), DISS (Dissimilation tonale) et AH’ (Assignation de H’) :
(8) a. AHB : assigner HB au radical atonal
b. UH’ : rehausser H’ à S devant B
c. RS : [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]SB à S
d. DISS :[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]HS
e. ATH’ : Assigner H’ à la voyelle thématique
Les règles sus-citées s’appliquent dans des contextes particuliers. AHB, s’applique par exemple lors de la formation du progressif. Par contre, les règles restantes s’appliquent lors de la formation de l’accompli négatif. Pour illustrer l’application de ces règles, nous dérivons /doon-a+m / (partir-VT+PROG), /kas- u+ + / (chercher-VT+ACC+A.N), /ged-e+a+ / (parler-VT+ACC+A.N) en supposant que l’ordre d’application AHB/ATBSATH’/PTH’/ASSOciation/UH’/DISS /RS :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.4 Tons des extensions verbales
1.4.1 Point de méthode
Pour déterminer les tons des extensions verbales, nous utiliserons une méthode en deux étapes. La première étape consiste à tester toutes les extensions verbales avec les radicaux verbaux atonals. Cette étape vise à déterminer si l’extension verbale a un ton propre. Si l’extension verbale a un ton propre, le dérivé verbal apparaîtra avec un schème tonal autre que M. Si par contre, le dérivé verbal apparaît avec un schème tonal M, l’extension verbale est atonale dans la mesure où elle ne contribue à la réalisation du schème tonal du dérivé verbal. Cette méthode a déjà été utilisée dans la littérature par Mutaka (1994) pour le kinande, une langue bantu. Le tableau suivant illustre cette méthode :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
En observant le tableau ci-dessus, l’on remarque que seule la suffixation du bénéfactif influence le ton du radical. Il en ressort que le bénéfactif a un ton propre contrairement aux autres extensions verbales. Nous abordons ainsi la deuxième phase de notre méthode qui consiste à poser des hypothèses pour déterminer le ton du bénéfactif.
1.4.2 Hypothèses et analyse
Selon le contexte tonal, le suffixe du bénéfactif apparaît avec les tons S, M, BM ou HB. Aussi, posons-nous quatre hypothèses dont chacune suppose que le ton du bénéfactif est l’un des allotones. Nous passons en revue chacune des quatre hypothèses afin d’adopter la plus adéquate. Pour ce faire, nous allons d’abord citer les schèmes tonals de la forme du bénéfactif que nous avons au Tableau 8 du Chapitre 4 :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Les hypothèses, précisons-le, ne prendront en compte que le ton du bénéfactif. Nous ne discutons pas ici des tons du radical et de la voyelle thématique. Pour les détails concernant ces tons, le lecteur peut se référer au Chapitre 4. La première hypothèse suppose que le ton du bénéfactif est S. Ainsi, pour dériver les tons du bénéfactif dans les différents paradigmes, nous avons les règles de réalisation suivantes :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
En 11d, la variante HS-M peut s’expliquer par une règle d’abaissement de S à M devant B. En 11b, le ton S du bénéfactif est conservé dans la variante H-S. Cependant, il s’agit des seuls cas où les changements sont motivés. En effet, l’on ne s’explique pas par exemple, comment S se réalise HB en 11c. Visiblement cette hypothèse n’est pas défendable. Nous passons en revue la deuxième hypothèse qui suppose que M est le ton du bénéfactif.
Si M est le ton du bénéfactif, l’on dérive les schèmes tonals de cette forme verbale de la manière suivante :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Cette hypothèse semble intéressante dans la mesure où l’on peut poser une règle de réalisation fort productive, de M à HB. Mais cette règle manque de motivation phonétique. Par ailleurs, il est difficile de rendre compte de l’allotones S du bénéfactif en 12b. Il y a donc des raisons pour abandonner cette hypothèse pour explorer celle de l’allotone BM.
Si le ton du bénéfactif est BM, l’on dérivera les formes du bénéfactif ainsi qu’il suit :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
L’allotone M en 13a et 13b peut se justifier par un processus de simplification de BM. Il est en de même de BM en 13d, qui est conservé. Cependant, il est difficile de rendre compte des allotones HB et S. Ceci nous amène également à laisser tomber cette hypothèse pour explorer celle qui suppose que HB est le ton du bénéfactif.
Si le ton du bénéfactif est HB, nous dériverons les schèmes tonals du bénéfactif de la manière suivante :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Cette hypothèse présente des avantages certains. D’une part, la forme de base est conservée dans toutes les formes de surface, à l’exception des variantes en 14a-b et 14d. Il s’agit respectivement des allotones S, M et BM. M peut être phonétiquement la réalisation de HB. Nous reviendrons sur les détails de ce processus au Chapitre 4. Par ailleurs, le ton B de BM est issu de l’assignation de HB aux radicaux atonals. Lorsque ceux-ci sont monosyllabiques, le deuxième ton s’associe à la voyelle thématique. Quant à S, il est issu de la simplification de SM comme nous le verrons au Chapitre 4. Ainsi, il ressort que HB est le ton du bénéfactif.
[...]
1 Dans son inventaire, cet auteur écrit plutôt r à la place de d.
2 Les verbes d’état n’ont pas de thème verbal simple comme les verbes d’action. Pour cela, la glose que nous donnons de ce verbe est celui du dérivé inchoatif.
Questions fréquemment posées sur l'aperçu linguistique
Quel est le sujet principal de ce document ?
Ce document est un aperçu linguistique complet qui comprend le titre, la table des matières, les objectifs et les thèmes clés, les résumés des chapitres et les mots clés. Il se concentre sur le système verbal d'une langue spécifique, appelée baat num, et analyse ses aspects phonologiques, morphologiques et morphotonologiques.
Quels sont les objectifs de cette étude ?
L'objectif principal de cette étude est de rendre compte des phénomènes de changements tonals et segmentaux des morphèmes verbaux en baat num. L'étude vise à analyser et expliquer les variations de forme, ainsi qu'à mettre en évidence l'économie du système verbal à travers une systématisation des phénomènes morphophonologiques.
Quelle est la classification de la langue baat num ?
La langue baat num appartient au groupe voltaïque ou gur. Plus précisément, elle est classée dans le gur central sud, à côté du padogho et du kulango.
Quels aspects de la phonologie des verbes sont abordés dans ce document ?
Le document aborde les consonnes et les voyelles de la langue, les types syllabiques et leur structure, ainsi que les tons. Il présente l'inventaire des tons (S, H, M, B, HB, SB et BM), les schèmes tonals des radicaux verbaux et rappelle les règles tonales qui s'appliquent lors de la formation de l'aspect verbal.
Qu'est-ce qu'un thème verbal, selon cette étude ?
Un thème verbal est défini comme la forme verbale constituée d'un radical et d'une voyelle thématique. La voyelle thématique est celle qui s'élide lors de la formation de l'aspect et qui est sujette à l'alternance vocalique. Les voyelles thématiques forment une classe homogène se distinguant par des critères formels.
Qu'est-ce qu'une extension verbale ?
Une extension verbale est un suffixe qui, lorsqu'il est ajouté au thème ou au radical verbal, en modifie le sens. Les thèmes verbaux obtenus après la suffixation des extensions sont des thèmes verbaux élargis.
Quels sont les processus morphophonologiques examinés dans l'étude ?
L'étude examine divers processus morphophonologiques affectant les voyelles (alternance, élision, assimilation) et les consonnes (épenthèse, lénition, élision). Elle analyse également les processus affectant la nasale m.
Quelle est la méthodologie utilisée pour déterminer les tons des extensions verbales ?
La méthode comprend deux étapes : d'abord, tester toutes les extensions verbales avec les radicaux verbaux atonals pour déterminer si l'extension verbale a un ton propre. Ensuite, si l'extension verbale a un ton propre, poser des hypothèses pour déterminer ce ton spécifique.
Quel cadre théorique est utilisé dans cette étude ?
L'étude utilise la théorie de la phonologie autosegmentale de Goldsmith (1976), couplée à la géométrie des traits distinctifs (Clements, 1991). Ce choix théorique offre une adéquation explicative pour l'analyse des changements de voyelle, la description des faits tonals et la description des changements de consonnes.
Quels sont les chapitres principaux de l'étude ?
En dehors de l'introduction et de la conclusion, l'étude est composée de quatre chapitres essentiels : phonologie des verbes, morphologie des verbes, analyse des processus morphophonologiques et morphotonologie.
Questions fréquentes
Quel est l'objectif principal de cette étude sur le Baatonum?
L'étude vise à expliquer de manière formelle les changements morphophonologiques subis par le verbe dans les paradigmes de conjugaison de la langue Baatonum.
Qu'est-ce qu'une voyelle thématique dans le système verbal?
C'est une voyelle finale du thème verbal qui sert à marquer l'infinitif et à dériver des verbes à partir de radicaux polyvalents.
Quels processus affectent les voyelles au niveau segmental?
L'analyse porte sur l'élision, l'assimilation de hauteur, l'assimilation d'aperture et l'alternance entre les voyelles 'e' et 'u'.
Comment les consonnes sont-elles affectées dans les radicaux C1VC2?
La consonne C2 peut subir une élision, un adoucissement (lénition) ou une assimilation, souvent pour simplifier la structure syllabique.
Quelle est l'importance du ton dans les verbes dérivés?
L'étude montre que seul le bénéfactif possède un ton propre (HB), alors que les autres extensions reçoivent leur ton par des règles de propagation et d'assignation.
Où est parlée la langue Baatonum?
Le Baatonum (ou Bariba) est parlé principalement au nord du Bénin, ainsi qu'au Nigeria et au Togo, par environ 560 000 locuteurs.
- Arbeit zitieren
- Sayane Gouroubéra (Autor:in), 2005, Une approche morphophonologique du système verbal du Baatonum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303951