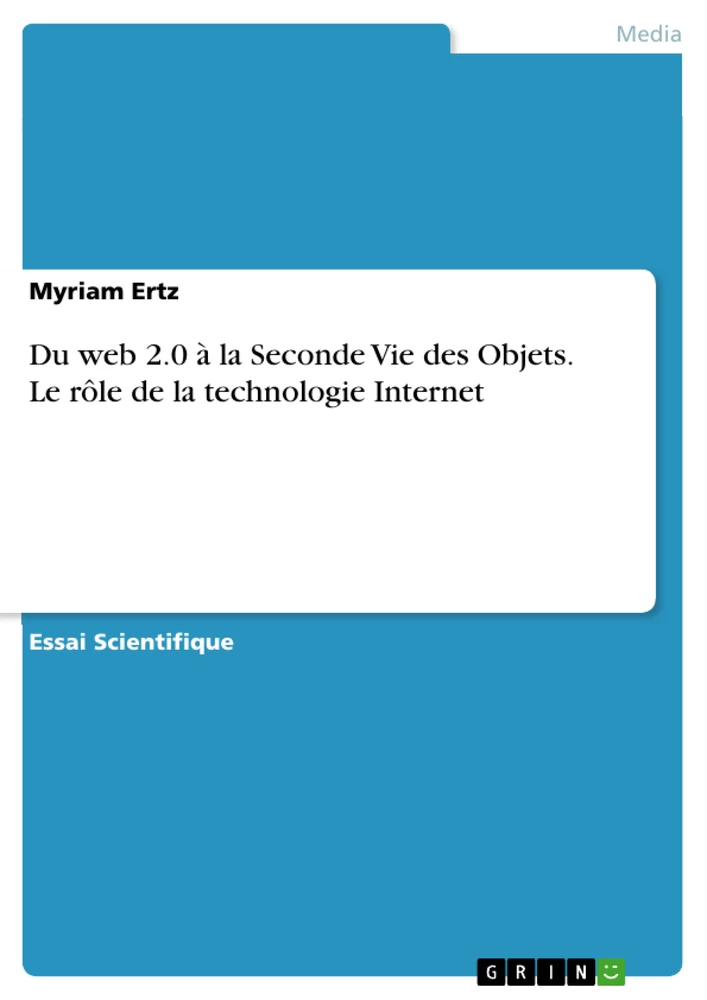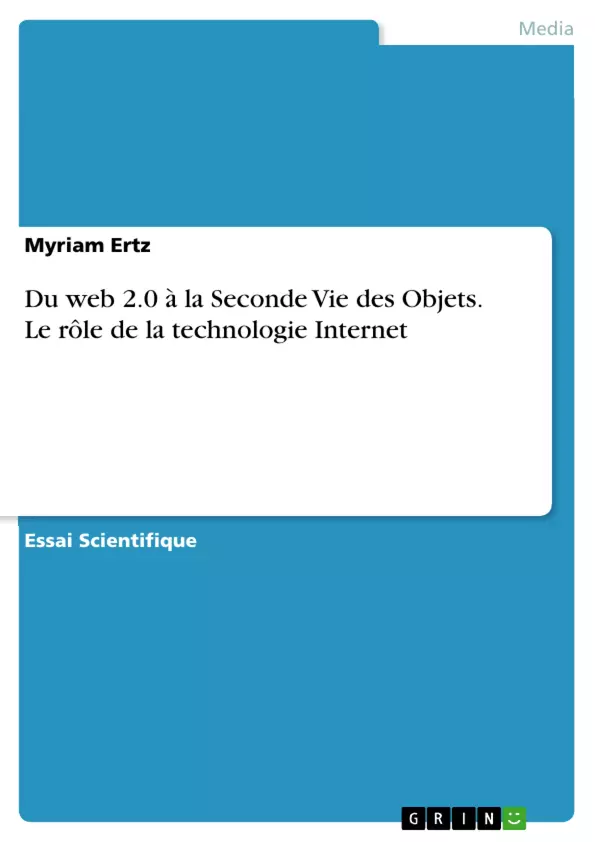Les évolutions relatives aux pratiques de consommation sont étroitement liées aux développements technologiques. L'évolution de la technologie Internet de sa configuration 1.0 vers sa configuration 2.0 a notamment amplifié les pratiques informelles dites de "Seconde Vie des Objets". Alors qu'auparavant le troc, le don, le marché de l'occasion ou encore la location d'objets usagés demeuraient relativement limitées. Internet a toutefois fait volet en éclat les frontières sociales ou géographiques en contribuant à renforcer la prévalence de ces pratiques à des niveaux jamais atteints par le passé. Cet essai juxtapose l'évolution du web en quatre phases clés ainsi que l'évolution des pratiques d'échange que chacune de ces phases a permis d'amplifier. Le mouvement de l' "Open Access" facilite l'échange de données, le "file-sharing" facilite l'échange de fichiers, le renforcement de la Seconde Vie des Objets permet l'échange d'Objets et enfin l'émergence de la Consommation Collaborative permet l'échange de services. Cet essai discute également de l'évolution des différents aspects favorisants et inhibiteurs propres à chacune de ces phases. Cet essai fournit ainsi les clés pour une meilleure compréhension de la résurgence de pratiques considérées jusque-là comme étant largement marginales, informelles et épi-phénoménales à la société de consommation. Il met également en lumière les fondements d'une relation plus liquide envers les objets de la part des consommateurs; et met en exergue la manière dont Internet a amené à un décloisonnement sur trois niveaux distincts: (1) entre les produits neufs et usagés; (2) entre le canal en ligne et hors ligne; (3) entre les différentes pratiques de redistribution des objets.
Inhaltsverzeichnis
- PARTIE 1 : LES PHASES CLÉS DE L'ÉVOLUTION DU WEB ET LEUR LIEN AVEC LA SECONDE VIE DES OBJETS
- Chapitre 1: Évolution technologique et impact sur la consommation
- Chapitre 2: Couplage techno-consumériste de l'évolution d'Internet
- Chapitre 3: Internet et les pratiques de Seconde Vie des Objets
- Chapitre 4 : Internet et la Consommation Collaborative : une extension de la SVO
- PARTIE II : CARACTÉRISTIQUES DU WEB ET LEUR RELATION AVEC L'ÉVOLUTION DES PHASES D'ÉCHANGES
- Chapitre 5: L'accès à l'information
- Chapitre 6: Structure « mercatique »
- Chapitre 7: La technologie mobile
- Chapitre 8: Systèmes de confiance
- Chapitre 9: Outils d'aides à la Décision
- Chapitre 10: Autres principes
- Chapitre 11 : Intégration des caractéristiques d'Internet
- Chapitre 12: Les freins à la SVO relatifs à Internet
- Chapitre 13: Cadre intégrateur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der technologischen Entwicklung des Internets, insbesondere des Web 2.0, auf die Praktiken der „Second Life of Objects“ (SVO). Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen der Evolution des Internets und der Veränderung von Konsumverhalten und Austauschpraktiken aufzuzeigen.
- Die Evolution des Internets und ihr Einfluss auf Konsumgewohnheiten
- Die Rolle des Web 2.0 bei der Förderung von Austausch und kollaborativem Konsum
- Der Einfluss von Online-Plattformen auf die Wahrnehmung und den Umgang mit gebrauchten Gütern
- Die Bedeutung von Vertrauen und Informationszugang im Kontext von SVO
- Die Herausforderungen und Hemmnisse bei der Verbreitung von SVO-Praktiken im digitalen Raum
Zusammenfassung der Kapitel
Chapitre 1: Évolution technologique et impact sur la consommation: Dieses Kapitel analysiert den tiefgreifenden Einfluss technologischer Entwicklungen auf Konsummuster und Lebensstile. Es wird die These vertreten, dass die Internettechnologie die Kommodifizierung, also die Möglichkeit des Austauschs von Gütern, erheblich erweitert hat. Im Fokus steht dabei der Wandel vom traditionellen „One-to-Many“-Modell der Massenmedien zum interaktiven „Many-to-Many“-Modell des Web 2.0, welches die Partizipation der Konsumenten und den Austausch von Informationen und Gütern online fördert. Die Entwicklung vom Web 1.0 zum Web 2.0 wird als kumulativer Prozess dargestellt, der zu erhöhter Interaktivität und kollaborativem Konsum geführt hat. Der Web 2.0 wird als technologische Hilfe dargestellt, die Zeit, Raum und Energie der Konsumenten spart und so neue Handlungsspielräume eröffnet. Die zunehmende Synchronisationsfähigkeit des Internets wird als Schlüsselfaktor für die Steigerung der Austauschhäufigkeit und Kommodifizierung hervorgehoben.
Chapitre 2: Couplage techno-consumériste de l'évolution d'Internet: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung zwischen der technologischen Entwicklung des Internets und dem veränderten Konsumverhalten. Ausgehend von der virtuellen Natur des Internets, werden Entwicklungen wie Open Source und Peer-to-Peer (P2P) File-Sharing als Wegbereiter für neue Formen des Austauschs, auch jenseits kommerzieller Strukturen, betrachtet. Der Text analysiert die ambivalente Rolle des File-Sharing, einerseits als Herausforderung für die Unterhaltungsindustrie, andererseits als Ausdruck einer neuen Konsumkultur, die auf freiem, uneingeschränkten Austausch basiert. Die Entstehung von User-Generated Content und virtuellen Communities wird als Zeichen einer Emanzipation vom traditionellen Konsummodell und einer Stärkung der Konsumentensouveränität interpretiert. Die Konsumenten werden dabei als aktive Gestalter ihrer Konsumwelt beschrieben, die durch kollektive Weisheit und Ressourcen, die das Internet bietet, ihre Abhängigkeit vom traditionellen Markt verringern. Der zunehmende "Brackage" (de Certeau), das innovative Finden neuer Wege zum Zugang zu Gütern, wird als Folge des veränderten Konsumverständnisses dargestellt.
Schlüsselwörter
Web 2.0, Second Life of Objects (SVO), Konsumverhalten, kollaborativer Konsum, technologische Entwicklung, Online-Plattformen, Austauschpraktiken, Kommodifizierung, virtuelle Communities, Vertrauen, Informationszugang.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Einfluss des Internets auf die „Second Life of Objects“
Was ist das zentrale Thema des Dokuments?
Das Dokument untersucht den Einfluss der technologischen Entwicklung des Internets, insbesondere des Web 2.0, auf die Praktiken der „Second Life of Objects“ (SVO). Es analysiert den Zusammenhang zwischen der Evolution des Internets und der Veränderung von Konsumverhalten und Austauschpraktiken.
Welche Phasen der Internetentwicklung werden behandelt?
Das Dokument betrachtet die Entwicklung des Internets von Web 1.0 zu Web 2.0 und deren Auswirkungen auf den Konsum und den Austausch von Gütern. Es werden die damit verbundenen technologischen Fortschritte und deren Einfluss auf das Konsumverhalten detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielt das Web 2.0 im Kontext von SVO?
Das Web 2.0 wird als Schlüsselfaktor für die Förderung von Austausch und kollaborativem Konsum im Kontext von SVO dargestellt. Die interaktive Natur des Web 2.0, mit seinen Möglichkeiten der Partizipation und des Informationsaustauschs, ermöglicht neue Formen des Umgangs mit gebrauchten Gütern.
Welche Aspekte des Konsumverhaltens werden untersucht?
Das Dokument analysiert den Wandel vom traditionellen „One-to-Many“-Modell der Massenmedien zum interaktiven „Many-to-Many“-Modell des Web 2.0. Es werden die Auswirkungen auf Konsumgewohnheiten, die Entstehung von User-Generated Content und virtuellen Communities, sowie die zunehmende Konsumentensouveränität untersucht.
Welche Bedeutung haben Online-Plattformen für SVO?
Online-Plattformen spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung und dem Austausch von gebrauchten Gütern im Kontext von SVO. Das Dokument untersucht den Einfluss dieser Plattformen auf die Wahrnehmung und den Umgang mit gebrauchten Gütern.
Welche Faktoren beeinflussen den Erfolg von SVO-Praktiken?
Der Erfolg von SVO-Praktiken hängt stark von Faktoren wie Vertrauen, Informationszugang und der Überwindung von Hemmnissen im digitalen Raum ab. Das Dokument analysiert die Bedeutung von Vertrauenssystemen und die Herausforderungen, die die Verbreitung von SVO-Praktiken im Internet begleiten.
Welche Kapitel sind im Dokument enthalten und worum geht es in ihnen?
Das Dokument ist in zwei Teile gegliedert. Teil 1 befasst sich mit den Schlüsselphasen der Web-Entwicklung und deren Zusammenhang mit SVO. Teil 2 analysiert die Charakteristiken des Webs und deren Beziehung zur Entwicklung von Austauschphasen. Die einzelnen Kapitel behandeln Themen wie technologische Entwicklung, Konsumverhalten, kollaborativer Konsum, Online-Plattformen, Vertrauen, Informationszugang und Hemmnisse für SVO.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Web 2.0, Second Life of Objects (SVO), Konsumverhalten, kollaborativer Konsum, technologische Entwicklung, Online-Plattformen, Austauschpraktiken, Kommodifizierung, virtuelle Communities, Vertrauen, Informationszugang.
- Quote paper
- Myriam Ertz (Author), 2015, Du web 2.0 à la Seconde Vie des Objets. Le rôle de la technologie Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306330