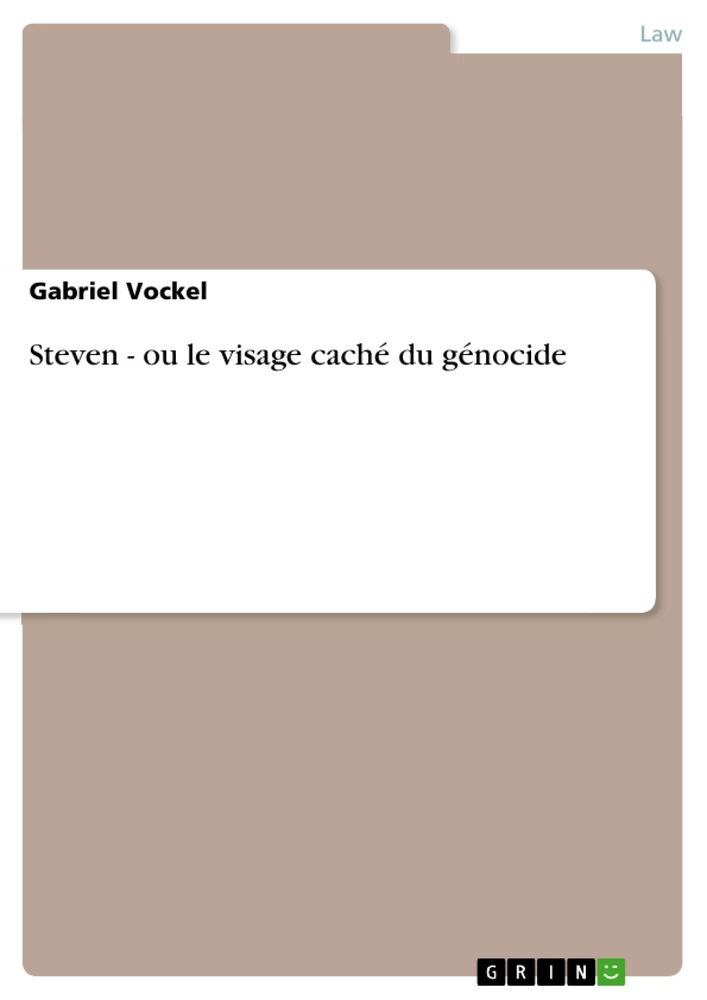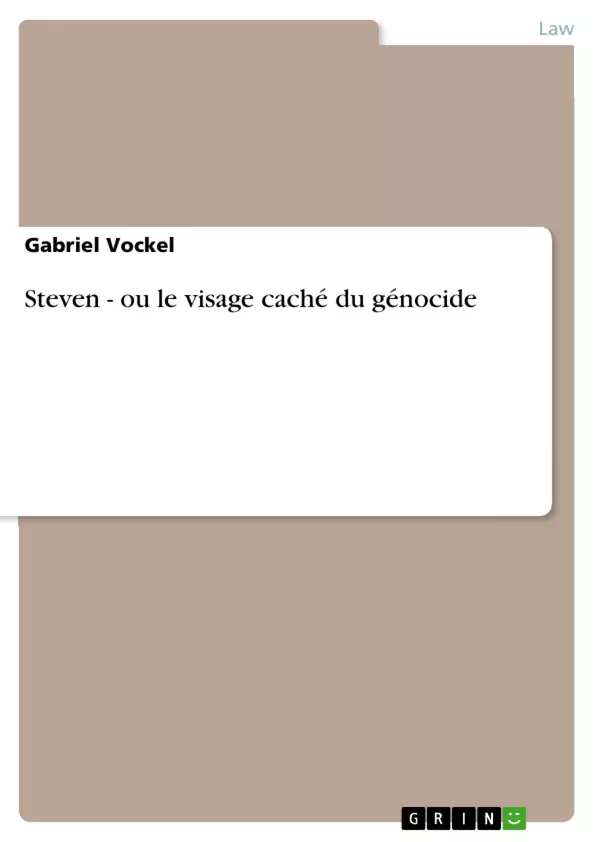Plus je m’éloigne du centre de la capitale de Kigali en me servant d’un taxi vélo qui pédale le long de la rue parsemée de trous et entourée d’une mer de bananier, plus la région de l’Afrique centrale devient rurale. Nous pilotons le vélo à travers un dédale de cabanes en torchis rouge, de petites maisons, de cyclistes et d’étals bourrés qui fourmillent, semble-t-il, pêle-mêle. Partout surgissent de petites collines et de plus grandes collines – ce n’est pas sans motif qu’on nomme ce minuscule morceau du continent africain « le pays des milles collines ». Au bord de la route beaucoup de gens marchent avec des poids lourds sur leur tête. Souvent nous dépassons aussi
d’autres cyclistes qui portent péniblement une armoire ou d’autres fardeaux. Moi, le blanc sous ses traits d’un serpent à lunettes, provoque bien sûr des signes joyeux et cela avant tout chez les enfants qui jouent ici devant les cabanes et maisons et souvent j’entends m’appeler gentiment : « Hello, Mzungu », hé, homme blanc ! Nous traversons une rivière où quelques femmes sont en train de puiser de l’eau pour remplir des bidons qu’elles portent avec peine dans leur village situé tout près derrière la prochaine montagne. Ce tableau idyllique incroyable, le vert intense de la flore ne s’emboîte pas avec les
événements de 1994 dans ce pays avec à peu près la superficie du Brandenbourg, entourant la capitale allemande de Berlin, ces événements qui ont, un ans après, conduit, grâce à la fameuse « résolution 955 » du Conseil de Sécurité de l’ONU, à la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda dans le pays voisin de la Tanzanie.Après de nombreux faits antécédents de l’ancienne colonie d’abord allemande, puis belge caractérisés par des actes cruels commis sans fin soit par les Hutus soit par les Tutsis au
détriment respectif de l’autre côté ethnique, un avion s’est écrasé au sol le 6 avril 1994 aux alentours de l’aéroport de Kigali. A bord était les présidents du Rwanda et du Burundi – un attentat, paraît-il, mais cela n’a jamais été prouvé. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Kigali, der Ruanda, Ende Juli 2002
- Das traditionelle « Gacaca »-Gericht
- Steven erzählt seine Geschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit den Folgen des Völkermords in Ruanda im Jahr 1994. Der Autor schildert seine Begegnung mit Steven, einem Überlebenden des Völkermords, während eines traditionellen « Gacaca »-Prozesses in einem kleinen Dorf außerhalb von Kigali.
- Die Auswirkungen des Völkermords auf die Überlebenden
- Die Rolle der traditionellen Gerichtsbarkeit in Ruanda
- Die Schwierigkeit der Versöhnung und des Zusammenlebens nach dem Völkermord
- Die anhaltende Angst und Unsicherheit in Ruanda
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Beschreibung der Fahrt des Autors vom Zentrum von Kigali in ein ländliches Gebiet. Der Autor schildert die Schönheit der Landschaft, die jedoch im Kontrast zu den Ereignissen des Völkermords von 1994 steht. Er erläutert kurz den Hintergrund des Völkermords und die anschließende Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda.
Im nächsten Kapitel beschreibt der Autor seinen Besuch eines traditionellen « Gacaca »-Prozesses. Er beobachtet die Gerichtsverhandlung und lernt einen Mann namens Steven kennen, der sich bereit erklärt, seine Geschichte zu erzählen.
Steven schildert im Detail das Schicksal seiner Familie während des Völkermords. Er berichtet, wie seine Eltern und Geschwister ermordet wurden und wie er selbst, als einziger Überlebender seiner Familie, mit dem Trauma des Völkermords zu kämpfen hat.
Schlüsselwörter
Völkermord, Ruanda, Gacaca-Gericht, Trauma, Versöhnung, ethnische Konflikte, Überleben, Geschichte, Erinnerung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Geschichte von Steven?
Steven ist ein Überlebender des Völkermords in Ruanda (1994), der als einziger seiner Familie die Massaker überlebte und nun von seinem Trauma berichtet.
Was sind „Gacaca“-Gerichte?
Das sind traditionelle ruandische Dorfgerichte, die nach dem Völkermord zur rechtlichen Aufarbeitung und zur Förderung der Versöhnung eingesetzt wurden.
Welche Rolle spielt Kigali in dem Text?
Kigali ist die Hauptstadt Ruandas; der Autor beschreibt die Reise von der Stadt in die ländlichen Gebiete, wo die Folgen des Völkermords noch immer präsent sind.
Was war die „Resolution 955“ der UNO?
Diese Resolution führte zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (ICTR) im benachbarten Tansania.
Warum wird Ruanda „Land der tausend Hügel“ genannt?
Der Name bezieht sich auf die charakteristische topografische Beschaffenheit des Landes mit seinen zahlreichen kleinen und großen Hügeln.
- Quote paper
- Master of Arts in Diplomacy, Law and Global Change Gabriel Vockel (Author), 2002, Steven - ou le visage caché du génocide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66217