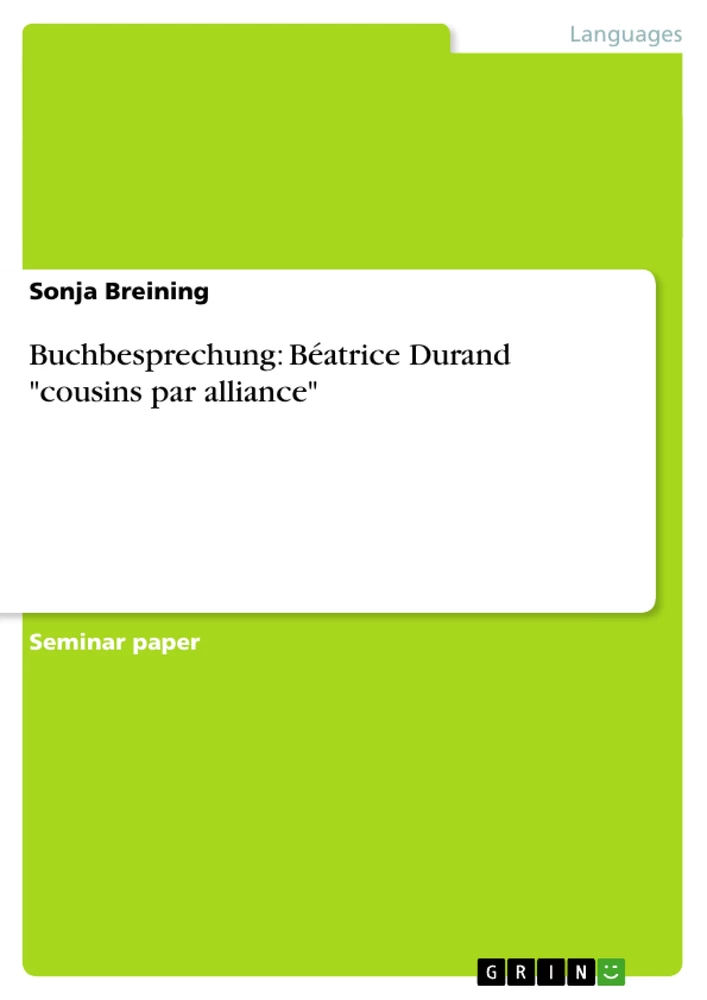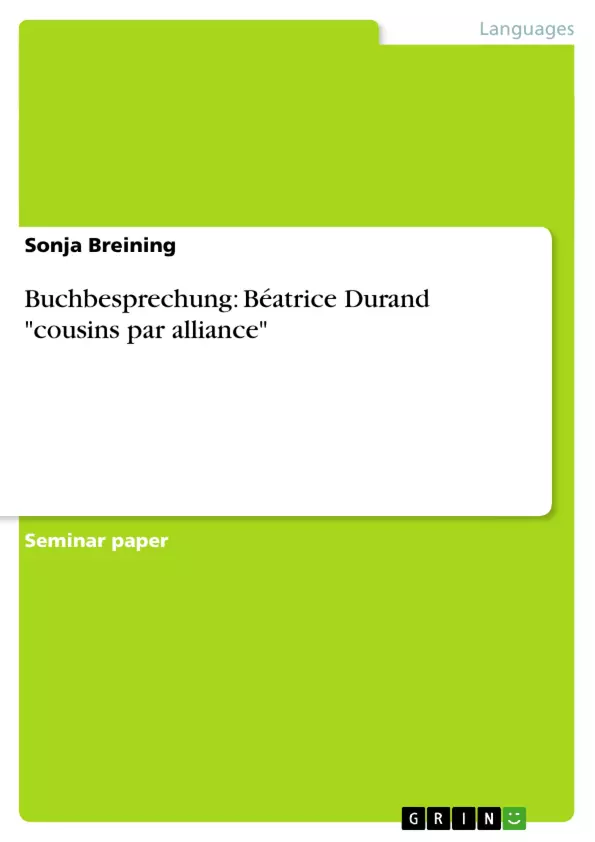Quelle est l′originalité du livre de Béatrice Durand cousins par alliance? L′auteur explique elle-même qu′elle veut se concentrer sur un domaine qu′elle trouve négligé dans la littérature francophone à propos de l′Allemagne: celui de la vie quotidienne. Elle veut s′éloigner des stéréotypes et clichés qui dominent encore,selon elle, dans la presse et les ouvrages spécialisés (voir page 7) en renonçant à tout expliquer par l′histoire comme beaucoup d′auteurs (voir page 10). Les protagonistes du livre ne sont pas des philosophes ou des intellectuels, mais des gens « normaux » représentatifs de la majorité de la population.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I) Introduction Warum dieses Buch?
- II) Die Erziehung in der Familie und das Bildungssystem
- 1.) Kinder haben: Probleme und Erwartungen
- 2.) Die Geburt und die ersten Lebensjahre des Kindes
- 3.) Die "Krabbelgruppen" und der Kindergarten
- 4.) Das Schul- und Hochschulsystem
- III) Das Berufsleben und die Freizeit
- IV) Charakteristische Züge der Deutschen
- V) Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Béatrice Durand beschäftigt sich in ihrem Buch "Cousins par alliance" mit dem Alltag in Deutschland und dessen Vergleich zur französischen Kultur. Sie will mit Stereotypen aufräumen und zeigen, wie die Lebensrealitäten von "normalen" Menschen in beiden Ländern aussehen. Das Buch befasst sich mit verschiedenen Themen, die den Alltag in Deutschland prägen.
- Vergleich der Familienstrukturen und Erziehungsstile in Deutschland und Frankreich
- Untersuchung des Bildungssystems in Deutschland im Vergleich zu Frankreich
- Analyse der Arbeitswelt und der Freizeitgestaltung in Deutschland
- Präsentation von typischen Merkmalen der deutschen Gesellschaft
- Vertiefung der kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
In Kapitel I stellt Béatrice Durand die Intention ihres Buches vor und erklärt, warum sie sich für den Vergleich des Alltags in Deutschland und Frankreich entschieden hat. Sie erläutert, dass sie sich auf die Lebenswelt von "normalen" Menschen konzentrieren möchte und dabei Stereotypen hinterfragen möchte.
Kapitel II befasst sich mit der Erziehung in der Familie und im Bildungssystem. Durand geht auf die Unterschiede in den Geburtenraten, den Familienmodellen und den Erwartungen an Eltern ein. Sie beschreibt die Bedeutung der Familie in Deutschland und die Rolle der Mutter bei der Erziehung der Kinder. Sie analysiert die verschiedenen Formen der Kinderbetreuung und die spezifischen Merkmale des deutschen Kindergarten- und Schulsystems.
Kapitel III behandelt das Berufsleben und die Freizeitgestaltung in Deutschland. Durand beleuchtet die Arbeitsbedingungen, die Work-Life-Balance und die Freizeitaktivitäten in Deutschland. Sie vergleicht diese Aspekte mit der Situation in Frankreich und zeigt, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen.
Kapitel IV widmet sich den charakteristischen Merkmalen der deutschen Gesellschaft. Durand beleuchtet die typischen Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und Eigenheiten der Deutschen und setzt diese in Bezug zu den französischen Lebensgewohnheiten.
Das Buch endet mit einer Schlussfolgerung, die die wichtigsten Erkenntnisse und Beobachtungen des Buches zusammenfasst und eine Gesamteinschätzung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Frankreich bietet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Das Buch "Cousins par alliance" konzentriert sich auf die Analyse des Alltags in Deutschland und Frankreich. Zu den Schlüsselbegriffen gehören: Familienleben, Erziehung, Bildung, Arbeit, Freizeit, Kultur, Stereotype, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, deutsch-französische Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt das Buch "Cousins par alliance" von Béatrice Durand?
Das Buch untersucht den Alltag in Deutschland und Frankreich und vergleicht kulturelle Unterschiede in Bereichen wie Erziehung, Bildung und Berufsleben.
Welche Unterschiede gibt es im Bildungssystem beider Länder?
Durand analysiert die verschiedenen Ansätze von der Krabbelgruppe über den Kindergarten bis hin zum Schul- und Hochschulsystem in Deutschland und Frankreich.
Wie wird das deutsche Berufsleben im Vergleich zu Frankreich dargestellt?
Das Buch beleuchtet Arbeitsbedingungen, die Work-Life-Balance und die spezifische Freizeitgestaltung der Deutschen im Vergleich zu ihren französischen Nachbarn.
Mit welchen Stereotypen will die Autorin aufräumen?
Sie möchte weg von rein historischen Erklärungen und zeigt stattdessen das Leben "normaler" Menschen jenseits intellektueller Klischees.
Welche typischen Charakterzüge der Deutschen werden thematisiert?
Die Arbeit präsentiert Merkmale der deutschen Gesellschaft, die Durand als charakteristisch im Vergleich zur französischen Lebensart identifiziert.
- Citation du texte
- Sonja Breining (Auteur), 2002, Buchbesprechung: Béatrice Durand "cousins par alliance", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115607