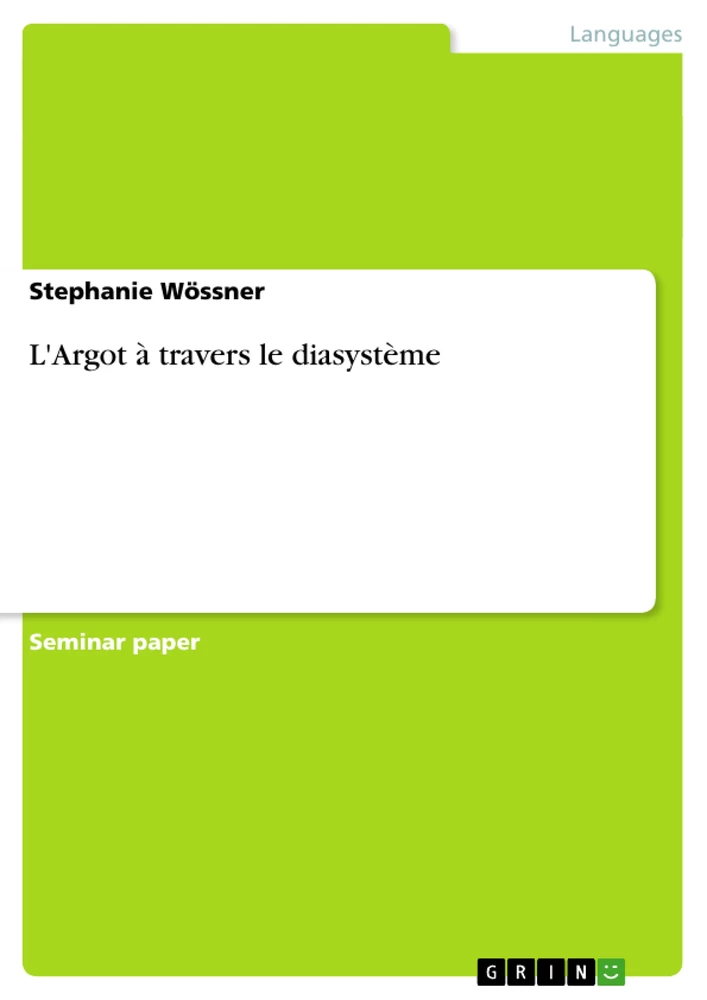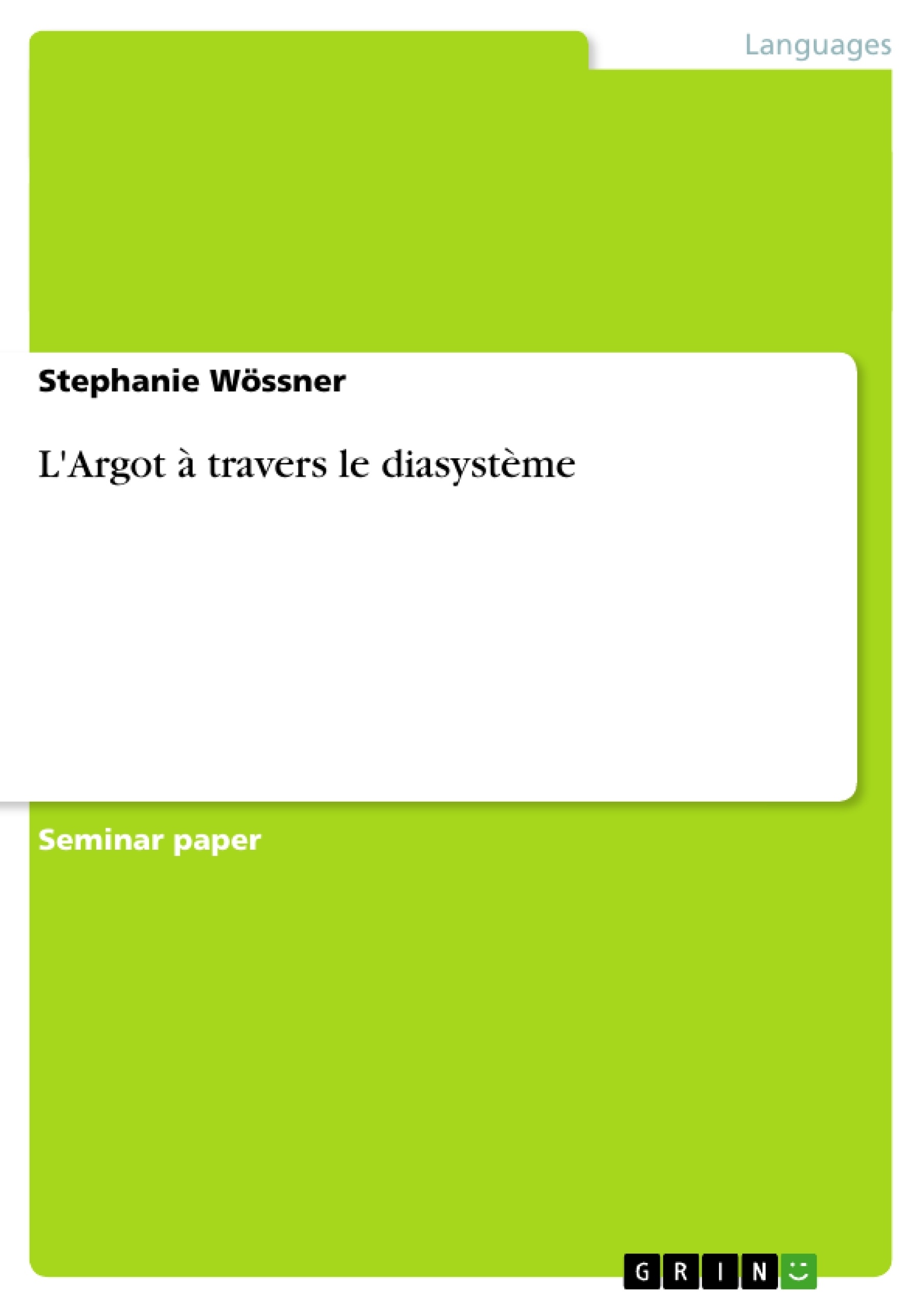I INTRODUCTION
Ce mémoire va essayer de décrire le statut de l’argot à travers les siècles, avec une
accentuation du XVIIe jusqu’au XXe siècles.
Dans la première partie, je vais, tout d’abord, parler du diasystème et de l’argot pour,
ensuite, attribuer à l’argot sa place dans le diasystème. Puis, je vais donner un récit
assez court de la terminologie du mot « argot » pour ensuite indiquer les
caractéristiques stables de l’argot à travers les siècles. Cette partie sera conclue par
l’opposition de l’argot comme un art de vivre et l’argot dans la linguistique.
La deuxième partie donnera un résumé des documents les plus importants quant à
l’argot. C’est ces documents-là qui servent comme base pour les études de l’argot.
Ensuite, la troisième partie va parler des dimensions diastratique et diatopique de
l’argot. Pour les XVIIe et XVIIIe siècles, on va parler de « l’argot », pour le XIXe siècle
plutôt du ‘jargot’. Les deux sous-parties sont toutes les deux partagées en quatre
parties : la définition, la fonction, les caractéristiques particuliers ou prononcés à une
époque donnée, et des exemples.
Puis, la quatrième partie va examiner l’argot sous l’angle de la diaphasie. Cette
considération s’occupera surtout des éléments argotiques dans le français du XXe
siècle jusqu'à nos jours. On va donc appeler cette étape de l’argot « le français
argotique » . Elle aussi sera partagée dans les quatre sous-parties mentionnées pour
l’argot et le ‘jargot’.
Enfin, la conclusion va résumer le mémoire, et avant quelques remarques finales elle
va essayer de contempler la signification de tout ce qu’on a appris dans ce mémoire
pour l’avenir de la langue française.
Cette dernière grande partie va être suivie par un schéma qui résume le mémoire en
gros. Ensuite, j’ai joint les extraits qui m’ont servis comme exemples pour les
troisième et quatrième parties avec une traduction des mots argotiques qui se trouvent dedans. Et tout à la fin, j’ai mis la bibliographie de toutes les oeuvres dont je
me suis servies pour ce mémoire.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. INTRODUCTION
- 1. LE DIASYSTEME
- 2. L'ARGOT
- 3. L'ARGOT DANS LE DIASYSTEME
- 4. TERMINOLOGIE
- 5. CARACTERISTIQUES
- 6. L'ARGOT DANS LA LINGUISTIQUE ET LE 'VRAI' ARGOT COMME ART DE VIVRE
- II. LA DIMENSION DIACHRONIQUE
- III. LES DIMENSIONS DIASTRATIQUE ET DIATOPIQUE
- 1. L'ARGOT (XVIIE AU XVIIIE SIECLE)
- a. Définition
- b. Fonction
- c. Caractéristiques
- d. Exemples
- 2. LE 'JARGOT' (XIXE SIECLE)
- a. Définition
- b. Fonction
- c. Caractéristiques
- d. Exemples
- i. Le javanais
- ii. Le loucherbem
- IV. LA DIMENSION DIAPHASIQUE (XXE SIECLE)
- a. Définition
- b. Fonction
- c. Caractéristiques
- d. Exemples
- i. Chansons
- ii. Littérature
- iii. Bande Dessinée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Mémoire untersucht den Wandel des Argotismus im Laufe der Jahrhunderte, mit besonderem Fokus auf den Zeitraum vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Es analysiert die Entwicklung des Argotismus in seinen verschiedenen Dimensionen und beleuchtet seine Funktionen und Merkmale in unterschiedlichen sozialen und historischen Kontexten.
- Die Entwicklung und Veränderung der Definition von „Argot“ im Laufe der Zeit.
- Die Funktion des Argotismus in verschiedenen sozialen Gruppen und historischen Perioden.
- Die charakteristischen Merkmale des Argotismus (Lexikon, Metaphern, etc.) und seine Entwicklung.
- Die Einordnung des Argotismus in das Diasystème (diachronisch, diastratisch, diatopisch, diaphasisch).
- Der Vergleich von „Argot“ und „Jargon“.
Zusammenfassung der Kapitel
I. INTRODUCTION: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung des Memoires: die Entwicklung des Argotismus vom 17. bis zum 20. Jahrhundert zu untersuchen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich in die Betrachtung des Diasystèmes, die diachrone, diastratische und diatopische Dimension sowie die diaphasische Dimension des Argotismus gliedert. Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über die Terminologie und die konstanten Eigenschaften des Argotismus und stellt ihn in Beziehung zur Linguistik und zu seiner Funktion als Lebensart.
II. LA DIMENSION DIACHRONIQUE: Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die wichtigsten Quellen zur Erforschung des Argotismus und dient als Grundlage für die folgenden Analysen. Es legt den Fokus auf die historischen Entwicklungen und Veränderungen des Argotismus als Sprachphänomen.
III. LES DIMENSIONS DIASTRATIQUE ET DIATOPIQUE: Dieses Kapitel untersucht den Argots des 17. und 18. Jahrhunderts und den Jargon des 19. Jahrhunderts. Für beide Zeiträume werden Definition, Funktion, charakteristische Merkmale und Beispiele analysiert. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen "Argot" und "Jargon" herausgearbeitet und anhand von Beispielen illustriert. Die Analyse umfasst Aspekte wie soziale Schichten (diastratisch) und regionale Unterschiede (diatopisch).
Schlüsselwörter
Argot, Jargon, Diasystème, Diachronie, Diastatik, Diatopik, Diaphasie, Sprachwandel, Soziolinguistik, Französisch, Lexik, Metapher, historische Entwicklung, soziale Gruppen, Kommunikationssituation.
Häufig gestellte Fragen zum Mémoire: Entwicklung des Argotismus
Was ist der Gegenstand dieses Memoires?
Dieses Mémoire untersucht die Entwicklung des Argotismus vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Es analysiert den Wandel des Argotismus in seinen verschiedenen Dimensionen (diachronisch, diastratisch, diatopisch, diaphasisch) und beleuchtet seine Funktionen und Merkmale in unterschiedlichen sozialen und historischen Kontexten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich von "Argot" und "Jargon".
Welche Aspekte des Argotismus werden behandelt?
Das Mémoire behandelt die Entwicklung und Veränderung der Definition von „Argot“ im Laufe der Zeit, die Funktion des Argotismus in verschiedenen sozialen Gruppen und historischen Perioden, die charakteristischen Merkmale des Argotismus (Lexikon, Metaphern etc.) und seine Entwicklung, die Einordnung des Argotismus in das Diasystème und den Vergleich von „Argot“ und „Jargon“.
Welche Zeiträume werden im Mémoire untersucht?
Der Fokus liegt auf dem Zeitraum vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Es werden der Argot des 17. und 18. Jahrhunderts und der Jargon des 19. Jahrhunderts im Detail untersucht.
Welche Dimensionen des Diasystèmes werden betrachtet?
Das Mémoire analysiert den Argotismus entlang der vier Dimensionen des Diasystèmes: diachronisch (zeitlich), diastratisch (sozial), diatopisch (räumlich) und diaphasisch (situativ).
Wie ist das Mémoire strukturiert?
Das Mémoire ist in mehrere Kapitel gegliedert: eine Einleitung, ein Kapitel zur diachronischen Dimension, ein Kapitel zu den diastratischen und diatopischen Dimensionen (mit Fokus auf Argot und Jargon des 17.-19. Jahrhunderts) und ein Kapitel zur diaphasischen Dimension. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau des Memoires. Die Kapitel enthalten jeweils Definitionen, Funktionen, Charakteristika und Beispiele des Argotismus für die jeweiligen Zeiträume und Dimensionen.
Welche Quellen werden verwendet?
Das Mémoire stützt sich auf wichtige Quellen zur Erforschung des Argotismus, die im Kapitel zur diachronischen Dimension genauer beschrieben werden. Die genauen Quellen werden im Haupttext des Memoires aufgeführt.
Welche Beispiele werden genannt?
Das Mémoire enthält Beispiele aus verschiedenen Quellen, darunter Chansons, Literatur und Comics (für die diaphasische Dimension), sowie Beispiele aus dem 17.-19. Jahrhundert für Argot und Jargon (z.B. Javanais und Loucherbem). Die konkreten Beispiele finden sich im Haupttext.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Argot, Jargon, Diasystème, Diachronie, Diastatik, Diatopik, Diaphasie, Sprachwandel, Soziolinguistik, Französisch, Lexik, Metapher, historische Entwicklung, soziale Gruppen und Kommunikationssituation.
- Quote paper
- B.A. Stephanie Wössner (Author), 2004, L'Argot à travers le diasystème, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138110