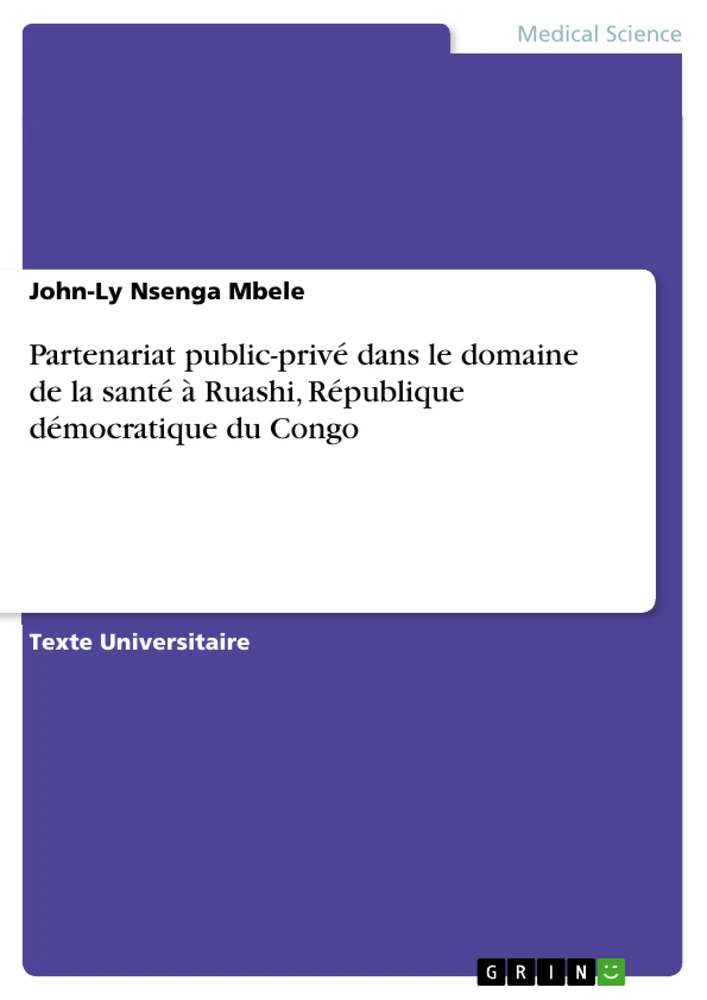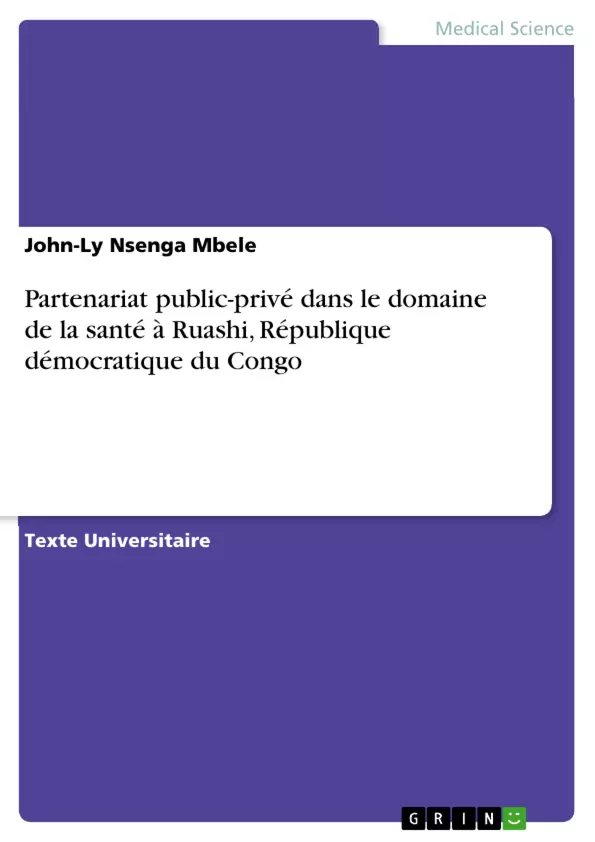Ce travail porte sur les connaissances, les attitudes et les pratiques du partenariat public-privé dans un système de santé local, ceci dans la zone de santé des Ruashi en République démocratique du Congo. L'objectif de ce travail est d'informer les partenaires et les décideurs sur le fonctionnement du partenariat entre les FOSA et le BCZS afin de leur permettre d'adopter une attitude cohérente tout en connaissant les leviers à manipuler en vue de la réussite de ce partenariat. Cette recherche est pour nous motivée par le constat fait sur le terrain d'un impact non significatif, d'aspects non pris en compte, d'un manque de suivi ainsi que d'une absence d'évaluation du partenariat. Il s'agissait d'une méthodologie de recherche mixte dans ce travail, et grâce à une recherche secondaire, via des documents disponibles, de courtes interviews de quelques responsables, nous avions obtenu des données pertinentes.
Nous étudions le partenariat public-privé (PPP), défini comme une collaboration institutionnelle entre l'État et le secteur privé pour définir des objectifs et des méthodes. Nous les appliquons à la gestion de la santé publique en nous concentrant sur la Ruashi Health Zone, où plusieurs secteurs de la santé peuvent être concernés. Notre choix de cette zone repose sur notre expérience de prestataire de soins dans le secteur privé, qui nous permet d'analyser objectivement le système de santé en termes de partenariats, et sur un paradoxe que nous avons observé sur le terrain.
Table des matières :
Résumé
Remerciement
Table de matières
Liste des tableaux
Liste des graphiques
Abréviations
Introduction
Revue de littérature
Généralité sur le partenariat public privé
Pluralisme thérapeutique
Sur le plan national
Sur le plan local
Notion de risque
Méthodologie
Analyse des données
Discussion
Conclusion
Recommandations
Références
Résumé
Nous avons effectué la recherche sur la connaissance, attitude et pratique du partenariat public privé dans un système de santé local, ceci dans la zone de santé de la Ruashi en République Démocratique du Congo. Ce travail avait pour but d’éclairer les partenaires ainsi que les décideurs sur le fonctionnement du partenariat entre les FOSA privées et le BCZS, pour ainsi, leur permettre à adopter des attitudes conséquentes, tout en sachant les leviers à manipuler en vue de la réussite de ce partenariat. Cette recherche nous est motivée par le constat fait sur terrain, suite à l’impact non significatif, aspects non prises en compte, le manque de suivi ainsi que de l’évaluation du partenariat. Il s’est agi d’une méthodologie de recherche mixte dans ce travail, et grâce à une recherche secondaire faite via les documents disponible, des petits entretiens avec certains responsables, nous avions obtenus des données pertinentes. Ces données ont été analysé avec des logiciels Excel principalement et Word, et les résultats obtenus ont été tel que : le ZS de la Ruashi compte environ deux cent vingt-trois FOSA, parmi lesquelles, cent septante-trois seulement soit 77,5% sont reconnus au BCZS, tandis qu’une cinquantaine soit 22,5% travail sans être reconnus. Parmi celles qui sont répertoriées, il y a cent septante-et-une structures, soit plus de 98% qui sont non-étatiques, contre deux étatiques, soit moins de 2%. Cent quarante-sept FOSA soit 84,9% sont affiliées (partenaires), contre 26 centres de santé, soit 15,1% qui évoluent en indépendant. Nous avons aussi constaté qu’aucune structure de la ZS n’a signé intégralement en bonne et due forme, le contrat d’intégration du BCZS, et donc, 100% des FOSA privées collaborent avec la ZS sans contrat. Seul environ 10 FOSA soit 5,7% possèdent un dossier complet d’ouverture d’une structures de soins, les autres qui sont au nombre de 167 soit 94,2% se contente juste l’avis d’implantation du BCZS. Concernant les engagements, le BCZS a supervisé à hauteur de 50,4% les FOSA, dans son plan prévue. Par contre, quant au soutient en médicaments, toutes les structures, soit 100% en bénéficient selon la disponibilité. Cette politique s’élargie même aux structures non reconnues, dans le but de les attirer toutes. Les structures bénéficient aussi des formations des prestataires selon différentes thématiques et la disponibilité des moyens. Quant aux FOSA privées, l’engagement en termes de rapportage se fait à 95% et toutes les structures participent aux réunions organisées via les aires de santé. Par contre, la participation en termes de contribution financière mensuelle nous montre qu’une moyenne de 29% des FOSA seulement contribue, et cela avec irrégularité. De son côté, le système de référence et contre référence souffre également dans son effectivité, car certaines FOSA possèdent des PCA, avec un personnel qualifié. Quant à la continuité des soins, le rapport montre que les malades référés arrivent à 100% à la destination, alors que la contre référence ne se fait qu’à hauteur de 19,8%. Les résultats de ce travail, nous permet d’avoir une lecture globale de la gestion du partenariat en santé sur le plan local, et nous donne des nouvelles connaissances, en vue d’un changement de comportement en terme de gestion, pour une bonne gouvernance du système de santé, pour le bien des malades. Ces résultats plaident aussi pour une amélioration dans les rôles des gouvernants. Ces derniers devraient donner des moyens conséquents, financier que matériels, pour soutenir et renforcer le partenariat public privés sur le plan local.
Mots-clés : Partenariat public privé, système de santé, zone de santé de la Ruashi, RDC.
Remerciements :
Apres avoir effectué le cursus en management de la santé, je suis dans l’obligation saine de présenter et manifester ma gratitude et reconnaissance envers ceux qui m’ont apporté leur secours, de loin ou de près, nous citons :
L’Eternel Dieu, qui nous permis de tenir jusqu’au bout de notre parcours, grâce à son souffle de vie dont nous sommes bénéficière chaque jours
A tous mes tuteurs d’Unicaf qui nous ont apporté leurs secours, depuis le début de cette aventure. D’une manière particulière je cite, BILAL SELMAN, qui nous a guidés pour l’élaboration et la réalisation du présent ce mémoire
A mes parents et géniteurs MUTOMBO et NGOIE pour leurs soutient tant morale que spirituel
A mes frères et sœurs tous et en particulier KITWA KALALA, l’ainé de la famille qui a quitté cette terre des hommes, pendant que nous élaborions ce travail. Puisse son âme reposer en paix.
A ma tendre épouse GUIDICH NSENGA et à mon fils JOSH NSENGA, pour votre soutien indéfectible
A toute l’équipe cadre du BCZS Ruashi en général, et en particulier au médecin chef de zone docteur Delille LUMBALA, pour la collaboration et la facilitation dans l’obtention des données.
A tous les personnels du centre de santé de référence TSHAMILEMBA, en particulier le médecin directeur, docteur Chuy DIDIER, pour son dévouement et son accompagnement
A tous les personnels du centre de santé et maternité LA SOURCE
Que tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce travail, trouvent par ce petit mot, l’expression de notre profonde gratitude et reconnaissance.
Liste des tableaux
Tableau I. Répartition des structures sanitaires par rapport au partenariat public privé, affiliées à la ZS
Tableau II. Répartition des structures selon la signature du contrat d’intégration au système de soins de santé primaires et à la politique nationale de santé, avec signatures
Tableau III. Répartition des structures réunissant les documents nationaux constitutifs du dossier pour ouvrir une structure de soins.
Tableau IV. Accompagnement des aires de Santé et ses structures
Tableau V. Formation des prestataires
Tableau VI. Dépôt des rapports au BCZS
Tableau VII. Participation aux réunions de monitorage
Tableau VIII. Contribution financière des centres privés au BCZS
Tableau XI. Cas référés à l’HGR
Tableau X. Nouveaux cas contre-référés
Tableau XI. Continuité des soins dans la ZS
Liste des graphiques
Graphique I. Répartition des effectifs approximatifs des structures de soins de santé
Graphique II. Statut des FOSA reconnues de la zone de sante jusqu’au premier trimestre 2023
Abréviations:
BCZS : Bureau Central de la Zone de Santé
CS : Centre de Santé
DHIS2: District Health Information System 2
DPS: Division Provinciale de la Santé
EC : Equipe Cadre
ECZ : Equipe Cadre de la Zone
ECZS : Equipe Cadre de la Zone Santé
FOSA: Formation Sanitaire
HGR: Hôpital Général de Référence
HP : Hôpital Provincial
IPS: Inspection Provinciale de la Santé
PCA: Paquet Complet d’activités
PMA: Paquet Minimum d’activités
PPP : partenariat public privé
RDC: République Démocratique du Congo
SNIS: Système National d’Information Sanitaire
SSP : Soins de Santé Primaire
ZS: Zone de Santé
Introduction
Le partenariat public privé dont il est question dans notre recherche, possède plusieurs définitions selon les organisations et les objectifs poursuivis. Nous allons y faire recours tant soit peu, tout au long de ce travail. En ce qui nous concerne, nous commençons par nous joindre à cette définition qui dit que : « partenariat public-privé (PPP) est toute relation institutionnelle entre l’État et le secteur privé, à but lucratif ou non lucratif, dans laquelle les différents acteurs participent conjointement à la définition des objectifs, des méthodes et de la mise en œuvre d’un accord de coopération » (ONUSIDA Juillet 2009).
Concernant notre sujet de recherche, cette définition sera extrapolée dans le domaine de la gestion en santé publique spécifiquement, c’est-à-dire, le partenariat dans le domaine sanitaire au sein de l’entité choisi pour cette enquête qui n’est rien d’autre que la zone de santé de la Ruashi. Plusieurs domaine ou service en santé si pas tous, peuvent être intéressé par le partenariat. Ndour est l’auteur qui nous présente différentes natures de partenariat dont brièvement nous avons : premièrement le partenariat dont l’objectif est le développement de produits ; deuxièmement, le partenariat qui vise le développement de produits afin d’améliorer l’accès, troisièmement le partenariat pour le renforcement des systèmes de santé. Quatrièmes, le partenariat de coordination globale et financière et enfin cinquièmement : Approches partenariales des politiques de développement, d’où émerge les plans nationaux de santé. (Ndour 2006). On se demandera peut-être pourquoi avoir choisi cette zone de santé. Deux motifs sont à la base de ce choix. D’une part, c’est le lieu où nous exerçons la médecine entant que prestataire et promoteur d’une structure de soins privée et donc, par là nous pouvons faire une analyse critique, magnanime et objective de l’organisation du système de santé en termes de partenariat, sans qu’il y ait conflit d’intérêt. D’autre part, la raison concerne un paradoxe que nous constatons sur terrain. Ce paradoxe concerne la population de cette zone de santé qui est à ce jour de 674525 habitants soit un total de 5621 habitants par kilomètre carré, alors que son étendu est pratiquement de 120 kilomètre carré, alors que les normes national stipule que : « Une ZS est un espace géographiquement limité et couvrant une population théorique de 100.000 à 150.000 habitants avec un hôpital général de référence (HGR) offrant un paquet complémentaire d’activités (PCA) »(PNDS 2016-2020). Cette grandeur contrasterait avec le nombre des structures de soins en terme de rapport de force entre les privées et les publiques. En effet, le nombre des structures de soins privées, s’élève à environ 171 centres de santé. Parmi ces centres de santé, on y trouve ceux bien organisés et même dans la majorité de cas, bien médicalisés, comprenant un paquet complémentaires d’activité. On parle même de la « médicalisation de la première ligne de soins » selon le rapport annuel des activités de la Zone de Santé 2019. Alors que, le nombre des structures de soins étatiques dites publiques, sont à compter du bout de doigts, soit pour être précis, il n’existe que deux seulement ; soit un centre de santé qui est presque délaissé par son propriétaire qui est l’Etat congolais car, cette structure se trouve dans un état considérablement délabré, et non digne d’un centre de santé. Un Hôpital Général de Reference qui compte un paquet complémentaire d’activité, avec une capacité d’accueil de 49 lits montés. Cette différence constatée dans la proportion entre les structures, le nombre de la population ainsi que l’étendue de la zone de santé de la Ruashi, obligent que le partenariat entre les structures de soins privées et l’Etat, puissent avoir un format devant leur permettre à ce que le but de subvenir aux besoins des nécessiteux qui sont les malades, soit atteint. Ce partenariat se fait par l’entremise du bureau central de la zone de santé qui est représentant officiel du ministère de la santé publique localement et par ricochet, de l’Etat congolais. Il s’agit là alors, d’un problème complexe qui autrement dit, oblige l’Etat a composé avec les privés dans un partenariat gagnant-gagnant, pour promouvoir la santé. Cette relation de collaboration par ailleurs existe déjà mais en réalité, les limites ne sont pas bien élucidées et clairement définies. Le souci, est aussi celui d’essayer de mettre en évidence la pratique, la connaissance, ainsi que l’attitude des parties prenantes ou mieux les prestataires et décideurs, sur le système d’organisation du partenariat public privé dans la zone de sante de Ruashi, afin de les mettre tous au courant de son fonctionnement, après avoir déniché les aléas organisationnels si ceux-ci existent réellement. C’est pourquoi, ayant énoncé les faits dans les lignes qui précèdent, il se présente sans le dire, les problèmes qui nécessitent des solutions adéquates dans la zone de santé de la Ruashi, voire sur les autres zones de sante de la province, pourquoi pas du pays. Ce qui en soit, nous pousse à nous poser la grande question dans ce contexte, qui est de vouloir mettre en exergue le fonctionnement du système de santé locale en matière de partenariat entre les privés et les publics. Quels sont les tenants et les aboutissants ainsi que le rapport de force entre les deux structures institutionnelles ? En outre, nous voulons apporter une pierre à l’édifice de la construction de la science dans le domaine de la gestion d’un partenariat public privé dans l’organisation du système de santé. Ainsi, d’autres auteurs, pourront tant soit peu s’inspirer de notre recherche que nous voulons bénéfique et contributif.
Le but de ce travail est de vouloir réaliser une mise en lumière des zones d’ombres et des difficultés, des parties prenantes de sorte à les éclairer pour en faire usage d’une manière efficace et objective.
L’objectif poursuivi par cette recherche, est de permettre aux décideurs périphériques et centraux, d’avoir un œil regardant et comprendre quels leviers manipuler dans quelle circonstance, en vue de prendre des décisions dans le sens de soutenir et même pérenniser ce partenariat car, c’est un outil indispensable pour une bonne promotion du système de santé. Egalement, permettre aux prestataires, d’être informer des méandres de cette collaboration, mais aussi, les différents domaines de la santé dans lequel cette relation de collaboration s’exerce, car pour mieux parvenir à prendre en charge d’une manière efficace et efficiente les malades, une bonne coordination de ce partenariat est incontournable, pour n’est pas appauvrir davantage la pauvre population dont le niveau de vie est au départ précaire.
Revue de la littérature
Généralité sur le partenariat public privé
Dans son histoire, le partenariat a commencé sous forme de donation de médicaments ou de recherche, mettant ensemble les firmes pharmaceutiques et organisations internationales dès les années 1970. Tel que le cas du programme spécialisé de recherche sur les maladies tropicales fondé en 1975 sous la couverture de l’OMS, de la Banque mondiale et du PNUD. Ceci est devenu comme le premier format de coopération entre institution. Ainsi, est considéré comme ancêtre de partenariat public privé depuis 1987, le programme Le Programme de donation Mectizan, pour la distribution du médicament pour lutter contre l’onchocercose (Guilbaud, A. 2015). Le partenariat en soit, s’effectue à plusieurs niveau de l’organisation sanitaire, sur tous les piliers de soin de santé primaire, tel que les produits pharmaceutiques, les prestataires, les informations sanitaires, la formation des prestataires, les finances, pour ne citer que ceux-là. C’est ainsi que nous allons relever le fait que cela peut se faire entre différentes structures. Il peut s’agir des ONG internationales à but lucratif ou non lucratif, avec l’Etat, soit entre ce dernier et les ONG nationales, soit encore entre l’Etat et les FOSA privées, confessionnelles ou non confessionnelles. Le partenariat peut aussi se faire entre les structures extra médicales telles que les écoles, églises, avec structures de soin de santé. Il peut également se voir même entre différents ministères tel que de l’enseignement, de sport, avec celui de la santé. Mais dans notre cas, nous nous concentrons sur le partenariat entre la BCZS et les FOSA privées. En soit, depuis quelques décennies, le partenariat public- privé est vu telle un moyen considéré pour la passation des marchés, afin de fournir aux services publics les moyens de réaliser des grands projets pour l’atteinte des objectifs, dans le but de développer et de moderniser les services publics en vue de mieux satisfaire les desideratas du souverain primaire. (LEMQEDDEM, H. A., & EL ALAMI, H. 2020). Tout comme concluent certains auteurs : « La participation du secteur privé peut augmenter la performance des projets, c’est ainsi que la coopération entre secteur public et privé apporte une valeur ajoutée ». (Ghobadian, et al. 2004, Hodge, 2004; Osborne and Murray, 2000). Pour que ce partenariat soit mené à bon port, il doit exister des documents scellant cette coopération, c’est le contrat. Ce contrat de partenariat doit s’imposer à tous, devenant ainsi, un outil qui aide à produire et à gérer efficacement les services publics. (Njanjo Sike Lobe, R. G. 2021). Et, ce contrat doit être signé par les parties prenantes c’est-à-dire les partenaires. Ce contrat, doit se faire après une bonne vulgarisation et compréhension de son contenu, ce qui doit éclairer les signataires sur les normes à observer ainsi que les contours à respecter. A ce propos, Finnemore et Sikkink disent que : « la phase de diffusion d’une norme est souvent précédée de sa clarification » (1998, 900). Le partenariat public privé dont il est question ici, constitue donc un sujet d’actualité et très commenté par plusieurs auteurs, chacun dans une vision selon sa conviction ou son domaine d’étude. C’est le cas de celui qui dis que :
« Le partenariat public privé est une entente contractuelle entre des partenaires public et privé qui stipule des résultats à atteindre pour améliorer la prestation de services publics. Cette entente établit un partage réel des responsabilités, des investissements, des risques et des bénéfices de manière à procurer des avantages mutuels qui favorisent l'atteinte des résultats ». (CEFRIO, 2003, p.11)
Il s’établit par les faits que dans la plupart de cas, l’Etat connais des difficultés pour faire tourner ses différents secteurs. L’accès aux infrastructures de base y compris celui de la santé, a diminué depuis les années 1990, suite aux problèmes de la guerre civile. Même après la période d’apaisement, cela reste très restreint, du fait d’une croissance de la population très remarquée que celle des infrastructures correspondantes (Rapport D'assistance 2023).
Signalons qu’il n’y a pas à s’inquiéter ni à avoir honte quant à faire recours au partenariat car, même des grandes nations dans le monde tel que l’Angleterre, France, Portugal, Royaume Unis, Québec, etc. y ont fait recours et ainsi le partenariat est devenu un outil de bonne gouvernance, pour ces pays. (Ilunga KF 2007). La réussite de ce partenariat, implique aussi le respect des normes et des règles établis par les partenaires, en dépit des autres aspects contractuels. c’est ainsi qu’à ce propos, Runavot, M.C. soutient cela en disant : « Les pouvoirs d’action des partenariat public privé en santé, autres que l’édiction de normes traduisent en effet une co-gestion de la part des partenaires publics et privés, gouvernementaux et non gouvernementaux »(2014, page 625). Le système de santé dans sa globalité est appelé à nouer de relations partenariales avec d’autres domaine de la vie d’un Etat car, la santé est un domaine très complexe, surtout par son pluralisme en matière de prise en charge. Parlons-en.
Pluralisme thérapeutique
En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, tout comme la majorité des pays africains, le système de santé est caractérisé par un pluralisme thérapeutique, constaté sur terrain. Suite à la situation socioéconomique et sanitaire que connait le pays ces dernier temps, le pluralisme thérapeutique qui sévit, évolue sans structure ni procédure, cela inclue : tromperie, charlatanisme avec toutes les conséquences et préjudices qui s’en suivent. C’est ainsi que les estimations évoquent environs 10 à 30% de la population en Afrique qui n’ont pas accès au système de santé à cause des moyens financier. (ALEXIS, N. Ket al. 2021). Dans ce pluralisme on y trouve différentes sources de soins de santé, entre autre les maisons des tradipraticiens qui octroient des soins de santé et traitent différentes maladies parfois à la satisfaction des malades. Certains d’entre ces tradipraticiens, ont un appareillage diagnostics non authentique, dont ils se servent pour valoriser leur job et par conséquent, rentabiliser leurs revenus. Une étude menée en 2021 révèle que la commune de la Ruashi compte à elle seule 11,43% des tradipraticiens de la ville de Lubumbashi. Ces derniers travaillent sur base des évidences et la majorité des malades leur font tellement confiances. (Nama, M. C., et al. 2021). Nous signalons d’emblée qu’Il existe au niveau national un programme de médecine traditionnelle mis en place depuis 2001 pour réglementer l'offre de soins de santé dans ce domaine. (PNDS 2019-2022, page 15). Il y a aussi les pharmacies, dont leurs détenteurs parviennent à poser des actes d’une manière non permises. On assiste à des perfusions et autres actes de nursing non autorisés. Donc, il s’agit d’un frein et obstacle pour les patients et patientèles à consulter une FOSA. Nous avons aussi, des églises, qui participent dans cette aventure en octroyant les soins dans un autre angle, comme le constate ALEXIS, N. K et ses collaborateurs, (2021) en disant : « Ce que l’on appelait la vente, les soins et la prière par correspondance sont devenue des nouveaux procédés à distance de soin par : téléphone, télévision, internet, etc ». Cette situation entrainerait une perte des données épidémiologiques et sanitaires, tout comme celle qui concerne la pharmacie car, ces systèmes de traitement connexes dans leur ensemble, évoluent souvent en vase clos, sans relation partenarial avec le BCZS.
Sur le plan national
Parlant toujours de la République Démocratique du Congo, qui par ailleurs fait partie des pays membre des organisations des nations unis, est également l’un des signataires de la déclaration du Millénaire, contenant 8 Objectifs pour le Développement en sigle OMD. Ce document, possède cinq principes fondamentaux de base constitué de 5 P, parmi lesquels on y retrouve le partenariat. Malheureusement, dans ce pays qui est le nôtre, la mise en application de ces objectifs pose un sérieux problème, jusqu’à être considéré comme pays peu performant car ayant réalisé moins de 85% des objectifs fixés entre 2000-2015. (Izu, A., & Mulolo, B. 2017). Plusieurs raisons son évoquée par les mêmes auteurs en ce terme :
« Les facteurs qui ont influencé négativement la réalisation des OMD sont du type économique manifesté par une croissance non inclusive, une vulnérabilité structurelle de l’économie et une insécurité alimentaire ; d’un caractère politique et sécuritaire manifesté par les conflits armés et la mauvaise gouvernance et, d’un caractère divers manifesté par un faible niveau d’instruction des femmes, un manque d’assainissement du milieu, manque d’équipement hospitalier, une absence de suivi de la santé de l’enfant après l’accouchement ».
Donc, en considérant ce point de vue des auteurs, il est logique de dire qu’une part importante de cet échec, incombe à la responsabilité des décideurs publiques et de la politique générale du pays. Nous pouvons tirer comme conséquence de ce qui précède, que le partenariat fait défaut dans notre pays, pour constituer un outil de bonne gouvernance comme vu dans les autres pays cités ci-haut. A ceci, s’ajoute par moment le non-respect des closes entre les partenaires, qui est à la base d’un manque à gagner en terme des soins pour certains malades, tels que ceux qui sont affilié à un mutuel de santé partenaire a une FOSA. (Bob senker, 2022). Ainsi, le respect des contrats et le suivi, sont des éléments prépondérants pour la réussite d’une aventure de partenariat entre les privées et l’Etat. Il convient également de souligner que, la République Démocratique du Congo prône aussi pour la couverture santé universel. Raison pour laquelle, tous les moyens doivent être mis en marche, y compris le partenariat entre l’état et les privés, tel que stipuler dans la récente ordonnance loi numéro 23/006 du 23 mars 2023 signée par la présidence de la république. Ceci dans la politique de l’OMS qui dans sa stratégie institutionnelle, définit l’établissement de partenariats comme : « une fonction essentielle susceptible de contribuer à l’instauration de la santé pour tous » (Buse K et Waxman A. 2002). Aussi, ce partenariat doit se faire entre les structures de soins et les organisations non gouvernementales, nationales ou internationales en promouvant la santé communautaire en vue d’atteindre ses objectifs. Cette dernière qui est la santé communautaire, vise à étendre les prestations en soins de santé dans tous les coins géographiques et sociaux du pays, organise et redynamise la gouvernance sanitaire locale ainsi que le partenariat entre les communautés et les structures de santé, (Senker B., 2022).
Sur le plan local
Localement, l’impact du partenariat est mitigé par rapport au résultat sur terrain. En effet, nous constatons qu’il existe un cadre normatif soutenant cette collaboration. Tel que conçu dans ses objectifs, le Bureau Central Zone Santé avait compris qu’il fallait un cadre légal. (Rapport annuel d’activités de la Zone de sante Ruashi 2019 page 2). C’est ainsi qu’un protocole de partenariat avec les structures non étatiques, intitulé : contrat d’intégration au système de santé primaire et à la politique national de santé, avait été mis en place, tenant lieu de cadre juridique pour guider ce partenariat, en se référant bien sûr, au vadémécum du partenariat national. Il est toujours important aussi, d’établir un protocole de suivi pour que les parties prenantes puissent faire une évaluation logique et réelle des activités sur terrain. Signalons aussi qu’il existe un document officiel qui est le vadémécum du partenariat, qui règlemente ce domaine. Mais hélas, ces contrats entre les partenaires c’est-à-dire entre l’état et les privés, souffrent d’une insuffisance de son applicabilité et du suivi. (Programme National de Développement Sanitaire 2019-2022 page 48). Aussi, l’échec se voit souvent dans les incoordinations de l’unité partenariale. En ce qui concerne la coordination des actions, Bigsten (2006) dit que le manque de coordination des bienfaiteurs augmente les coûts de fonctionnement de l’aide. Il y a génération des doublons, ainsi que la multiplication des couts fixes, tout en absorbant les ressources humaines ainsi que celles administratives des pays à faible revenus. Ainsi on assiste à une réduction de l’impact d’aide sur terrain. C’est pratiquement à cause de ces genres de désorganisations que certaines organisations de bienfaisance tombent en faillite par manque de coordination efficace. Néanmoins, il existe des partenaires qui soutiennent certaines structures de soins, en passant par le Bureau Central de la Zone de Santé. Ces partenaires interviennent beaucoup plus dans le soutien des formations sanitaires en termes des produits pharmaceutiques (comme pour la prise en charge du VIH SIDA, la Tuberculose...), en intrant et outils de gestions des informations sanitaire. En terme de la qualité de soin, le même rapport nous démontre que : « l’HGR n’offre que les services basiques et la qualité des soins offerts restent à améliorer ». Et d’ajouter : « Toute la population de ZS répartie dans les Aires de Santé peut accéder à l’HGR même si le système de référence et de contre-référence soit peu fonctionnel, situation causée partiellement par la médicalisation des FOSA de 1er échelon » (page 11). Etant donné que l’organisation du système de santé local est presque la même partout en RDC selon le ministère de la santé (2018), Cette réalité sur la gestion du système de santé au niveau opérationnel par les ECZS, peut être transposable sur toute les autres ZS et villes de la RDC. (Chuy KD et al. 2020). L’ayant compris en ce terme, le PNDS a suggéré deux actions à mener en vue du renforcement de la coordination dans les secteurs. Parmi elles nous notons « le Renforcement des mécanismes de suivi-évaluation et de redevabilité ». C’est dans cette dernière action, qu’est relevé clairement le souci de renforcer le partenariat avec les communautés et agir sur l’intégration des privés. (PNDS 2019-2020 page 59). En ce qui concerne le système d’information sanitaire entre les centres de santé privés et le bureau central de la zone de santé, il existe une forme de partenariat non-dit, qui consiste à ce que, chaque centre de santé œuvrant dans la circonscription sanitaire de la Ruashi, est appelé à déposer chaque semaine un rapport hebdomadaire des soins, dans un document officiel appelé canevas SNIS (Système National d’Information Sanitaire). C’est ce rapport qui est compilé à la fin du mois pour ressortir un rapport mensuel de la zone de santé. De son cote, cette dernier octroi selon la disponibilité, certains intrants dans le cadre de la prise en charge de certaines pathologies telles que la malaria, (dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme), la tuberculose (dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose). Il sied de souligner que, tous ces mouvements d’échange d’information entre FOSA privées et le BCZS, n’ont pas un soubassement légal ou un document signé légalement en termes d’engagement entre les parties prenantes ou mieux entre les acteurs, bien que ce document existe.
Notion de risque en partenariat public privé
Il existe toujours un certain degré de risque à encourir lorsqu’un engagement est pris avec un tiers. Le PPP étant une relation très complexe, il n’est pas épargné de cette notion. Cela va sans dire qu’il est donc évident que la notion de risque soit évoquée à ce niveau. Comme l’insinue un auteur que : « les PPP sont exposés à un plus large éventail de risques par rapport aux montages traditionnels en raison de leur nature complexe, de la longueur de leur durée et des relations complexes entre les parties du projet » (Grimsey and Lewis, 2002). A ces propos, plusieurs auteurs ont catégorisé ces risques. C’est notamment Li et al. (2001) qui ont classé en trois niveaux les risques qui sont associés aux PPP: les risques macro, les risques méso et les risques au niveau micro. A tous les niveaux de l’organisation partenariale on peut assister à des risques. Ce qui probablement est à la base de créer une certaine réticence des FOSA quant à la signature finale du contrat, car le risque de ne pas respecter les closes est énorme, et peu même entrainé dans certaines circonstance des poursuites judiciaires. Pire encore lorsque le libellé du contrat n’est pas mise à la disposition des contractants comme c’est le cas dans notre milieu local, tel qu’en témoignent certains responsables des FOSA. Il est donc impérieux de bien vulgariser le contrat et valoriser le documente correspondant, dans le sens de mettre tout le monde au parfum en démontrant les risques y afférent. C’est ainsi que l’on peut obtenir des garanties d’un engagement en terme de partenariat, bien que la sagesse populaire dit « qui ne risque rien, n’a rien ».
Méthodologie de recherche
Il est de notre devoir dans cette partie, de présenter le titre de la présente recherche et ainsi parler de la manière dont nous sommes parvenues à la réaliser. Par ailleurs, nôtre sujet s’intitule comme suit : connaissance, attitude et pratique du partenariat public privé dans un système de santé locale, cas de la zone de santé de la Ruashi, dans la province du Haut Katanga en République Démocratique du Congo. Nous nous sommes fixés comme objectif pour ce travail, d’éclairer et informer les partenaires sur les différents domaines dans lesquels intervient ce partenariat public privé, ainsi que la responsabilité de chaque partie prenante. En fin, permettre par ce travail, aux décideurs et gouvernant d’avoir un regard soutenu sur le comportement de ce partenariat, en vue de mieux maitriser les tenant et les aboutissant pour ensuite perpétuer cette collaboration entre institution, et faire en sorte que les résultats de cette coopération, soient orientés vers la réussite et la réalisation des clauses du contrat, en respectant ce dernier pour le bien de la population. Pour y parvenir, nous avons fait recourt à la méthode de recherche secondaire. Donc, grâce à une fouille dans la documentation existante au sein du bureau central de la zone de santé, nous avons recueilli des données à la source secondaire, qui nous ont permis de faire une analyse critique et ainsi tirer de conclusions conséquentes. Au vue des données obtenues après notre enquête, nous avons analysé à l’aide de la méthode de recherche mixte suite à la nature même des données que nous avons obtenues de nos sources, c’est-à-dire, des données à caractère qualitatifs et quantitatifs. Pour y arriver, nous avons fait usage de certains matériels tels que le téléphone comme moyen de communication, des stylos, crayons et gomme, encre correcteur au besoin, aussi des papiers en vue d’écrire les éléments dont nous avions recueillis car dit-on « les paroles s’envolent, mais les écrits restent ». Nous avons aussi fait usage d’un ordinateur pour analyser les résultats, rédiger le rapport de la recherche et ainsi le présenter sous forme des graphiques et des tableaux ou encore de texte. Egalement, nous avons utilisé le moyen de transport fait d’un véhicule pour nous permettre d’atteindre le bureau central de la zone de santé, pour y rencontrer différentes personnalités détenant les informations nécessaires à notre recherche. En premier nous citons le médecin chez de zone, qui nous a donné son autorisation et permis d’entrer en contact avec d’autres personnels de son bureau, bien que cela n'a pas été facile car, il a fallu respecter les rendez-vous, vu son emploi de temps et sa charge horaire. Deuxièmement nous avons rencontré la data manager, qui est la chargée de saisit de toutes les données et les encodent afin de les caser dans le DHIS2, un logiciel qui a nécessité un mot de passe personnel de la data manager pour y accéder. Nous avons ensuite échangée tour à tour avec l’administratrice gestionnaire de la zone, la cheffe du personnel, le charger de la formation, l’intendant ainsi que la pharmacienne. Nous avons en fin consulté tous ceux que nous avions jugés nécessaire, pour répondre à nos préoccupations ; il s’agit de quelques promoteurs des formations sanitaires, certains infirmiers titulaires des structures privées et quelques relais communautaires, tous choisit par hasard. Ainsi fait, nous avons considéré dans cette recherche d’emblée comme nos sources, les éléments suivants : les documents liants les promoteurs de centre de santé, aux bureau central de la zone de santé, les documents du système national d’information sanitaire SNIS en sigle obtenus auprès des infirmiers titulaires de structures privées et de la zone de santé, et auprès des médecins responsables des structures de soins utiles à notre recherche. Nous avons aussi inclus les documents que nous avons trouvés important et pertinent pour notre travail, auprès des promoteurs des structures privées. Nous avions consultés toutes ces personnes, en vue d’obtenir certaines données primaires et informations bénéfiques à cette étude. Etaient exclus de cette recherche, tous documents ne cadrant pas avec le sujet de notre recherche, et surtout ne se trouvant pas dans la zone de santé de la Ruashi, qui est notre milieu d’étude. Pour l’analyse des données, ainsi que la rédaction du rapport final, nous avons fait recourt au programme suivant : Windows 7, Excel ainsi que le power point, qui nous ont suffisamment aidé pour faire notre analyse objective des résultats. Nous avons d’une manière stratégique, franchis et contourné les obstacles qui se sont érigées entre nous et l’accès aux données utiles et pertinentes, par les moyens financier et oratoire, et nous avions obtenu à chaque fois, gain de cause en accédant aux données et en obtenant ainsi le résultat en quête. Tout ceci, dans le respect de l’éthique de la recherche. L’un de plus grands de ces obstacles était le temps des répondants et leurs occupations professionnelles réglementaires. Un problème très contraignant, vu que notre temps de travail était aussi imparti que serré, en termes de l’hebdomadairisation et la chronologie des étapes à suivre, pour le dépôt du présent mémoire. A cela, nous ajoutons notre devoir en tant que professionnel de santé et chef de famille.
Analyse des données
Nous allons analyser les données recueillies dans différents rapports obtenu auprès des personnes ressources. Nous suivons les différents éléments contenus dans le document du BCZS intitulé : contrat d’intégration au système de soins de santé primaires et à la politique nationale de la santé. Ce document est issu du vadémécum de partenariat de la RDC, qui lui servi de référence pour les concepteurs.
A. Généralité sur la situation des structures de soin
I. Répartition des effectifs approximatifs des structures de soins de santé
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaires : Les structures de soins reconnues au BCZS sont au nombre de 173. Il existe d’autres structures de soins non reconnues dans la zone de santé, qui sont estimées à une cinquantaine selon la réalité sur terrain.
II. Statut des FOSA reconnues de la zone de sante jusqu’au premier trimestre 2023
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaire : Ce graphique nous représente, le nombre des structures privées qui sont dominant à 98,8 %, parmi elles, nous y rencontrons aussi des confessionnelles qui sont dénombrés à environs 5 structures. Comparativement aux structures étatiques qui sont inférieurs à 2%.
Tableau I. Répartition des structures sanitaires par rapport au partenariat public privé, affiliées à la ZS
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaires : il s’agit ici des chiffres approximatifs des structures affiliées à la zone de santé d’une manière théorique (c’est-à-dire sans un soubassement scellé), parmi les reconnues. Les deux structures étatiques sont comprises parmi les affiliées.
Tableau II. Répartition des structures selon la signature du contrat d’intégration au système de soins de santé primaires et à la politique nationale de santé, avec signatures
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaire : En fouillant dans la documentation existante, nous n’avons trouvé aucun contrat signé dûment entre le BCZS et le structure privé représentées par leurs promoteurs. Notons qu’il existe certains contrats signés incomplètement par les partenaires. Soit c’est l(es) sceau(x) institutionnel(s) qui manque(nt), soit c’est juste une partie qui signe. Ainsi, n’avons considéré aucune fiche parmi celles retrouvées.
Tableau III. Répartition des structures réunissant les documents nationaux constitutifs du dossier pour ouvrir une structure de soins.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaires : l’avis d’implantation, venant directement du BCZS, constitue donc le document en vogue, pour ouvrir une FOSA. Nous tenons à signaler que même parmi le 94,2%, ce document n’est pas accessible à tous pour des raisons financières. Et parmi les 10, se trouve aussi les deux FOSA étatiques.
8. Engagement du BCZS
Tableau IV. Accompagnement des aires de Santé et ses structures :
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Source : rapport BCZS 2019.
L’Etat n’a pas observé ses attributions intégralement en ce qui concerne la supervision ainsi que le coaching des aires de santé. Donc, à seulement 50% environ, la supervision n’a pas été assuré et même le coaching. Néanmoins, le suivi s’est fait correctement.
Appui à la mise en œuvre des activités de santé publique :
Vaccination :
Le BCZS octroie le vaccin à tous les aires de santé, aux structures ayant intégrées le programme de vaccination. C’est ainsi que le rapport du premier trimestre 2022, rapporte un taux de couverture vaccinale en VAA et VAR à 95% environs, le taux de couverture en BCG 95% couverture en PENTA 1 et PENTA 3 : 95% et le taux de couverture en PCV 13 : 95%. Ces résultats témoignent de la bonne politique en ce sens que la couverture est satisfaisante.
Médicament :
Le BCZS soutient les structures en médicament de gammes variées, venant de ses partenaires ou des différents programmes nationaux. Selon les données recueillies sur place, toutes les structures reconnues soit 173 perçoivent les médicaments du programme. Et même les autres centres non reconnu, on perçut les produits au premier trimestre 2023, dans le but de les rapprocher du BCZ et les intégrés dans la politique national des prise en charge de différentes pathologies. Il s’agit des antibiotique, les antipaludéens, les antalgique et autres intrants.
Formation des prestataires :
Le BCZS offre des formations de remises à niveau aux différents prestataires des structures privées et publiques. Il s’agit pour la majorité, des formations non planifiées dans le Plan d’Action Opérationnel, mais qui sont motivées au cours de l’année par les partenaires nationaux et internationaux. Pour l’année 2022, une dizaine des formations ont été organisées.
Tableau V. Formation des prestataires
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaires : Certains centres ne sont pas intéressés par certaines formations étant donné que, leurs structures ne sont pas intégrées au différent programme de prise en charge des maladies spécifiques. Et cela dépend aussi des moyens financiers mis en jeux par le partenaire qui soutient l’activité.
C. Engagement de l’établissement de soins
Tableau VI. Dépôt des rapports au BCZS
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Source : revue avril 2020
Commentaire : Plus de 95% de structures déposent à temps leurs rapports de monitorage.
Tableau VII. Participation aux réunions de monitorage
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Source : Revue annuelle 2019
Commentaire : Faisant parti des engagements des structures vis-à-vis du BCZS, les centres de santé à travers les aires de santé, participent activement aux séances de monitorage avec un taux de 100% DHIS2 2022
Tableau VIII. Contribution financière des centres privés au BCZS.
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaire : Nous avons considéré ici, rien que les contributions du premier trimestre 2023, qui rapport une moyenne de 29% des structures qui contribuent.
Collaboration entre les formations sanitaires : évaluer en termes de références et contres référées vers l'HGR.
Tableau IX. Cas référés à l’HGR
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaires : nous avons considéré le rapport allant du mois de décembre 2019 jusqu’au mois de Février 2020.
Tableau X. Nouveaux cas contre-référés
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Commentaire : Presque le même constat est fait avec la référence.
XI. Continuité des soins dans la ZS
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Source rapport BCZS 2019.
Commentaires : Dans ce tableau nous avons une image du système de référence et contre référence entre le ZS représenté par l’HGR et les autres ZS. Il en résulte que, tous les malades référé aux instances supérieur comme l’hôpital provincial (HP), arrive à destination à 100%. Alors que, la contre référence n’est évaluée qu’à 19,8%.
Discussion des résultats et interprétation
Ce travail vise à établir la clarté dans le cadre du partenariat entre le système de santé publique représenté en périphérie par le BCZS, et les FOSA privées. Selon les résultats constatés dans le graphique numéro I, il existe des FOSA dans la ZS Ruashi, chiffrées à environs 20% qui ne sont pas répertoriés au niveau périphérique et ainsi évoluant en vase clos. Ce même constat a été fait par d’autres auteurs, cette fois-là sur l’ensemble de la ville de Lubumbashi, sans pour autant chiffrer le problème en disant : « Les prestataires et les promoteurs qui ont des structures sanitaires viables et conformes aux normes, tout comme ceux qui n’en ont pas, ne sont pas listés. La création des FOSA est imprévisible » (Chuy, K.D et al Juin 2019). Deux raison peuvent être évoquées dans ce cas : soit les promoteurs esquivent les frais à payer, soit encore, les chefs, pour des raisons non élucider, utilisent ces structures comme un gagne-pain.
Les FOSA privées d’une manière confondue c’est-à-dire : ASBL ou non, confessionnelles ou d’entreprise, sont extrêmement élevées bien plus que les publiques dans l’entité en étude, avec une proportion de 98,8 %, parmi celles reconnues par le BCZS, alors que les FOSA étatiques sont en infériorité numérique énorme, soit inférieur à 2%. A Mbujimayi dans la province du KASAI, majorité des structures de la ZS de Kansele sont privées à 92,3 % (CIBANGU, R. 2021). Comparé aux autres ZS du pays, les structures étatiques sont toujours en quantité inférieurs, tel que dans la ville de Goma tel que la Zone de santé Goma avec 9%, la de Zone de santé Karisimbi 7% et la Zone de santé Nyiragongo 8% (Kuamba, et al.2020). Qu’à cela ne tienne, avoir moins de 10% des FOSA étatique, ceci contraint l’Etat dans sa politique sanitaire, à pactiser avec les privées qui sont majoritaires, pour le bien de sa population.
Concernant la relation partenariale entre l’Etat et les privées, dans la ZS de la Ruashi, existe bel et bien un document conçu par les membres de l’Equipe cadre du BCZ, qui est un condensé du vadémécum du partenariat de la RDC, 0% des FOSA ont eu a signé ce contrat et les raisons pourrait être la négligence d’une part, et la peur de prendre les engagements d’autre part. Par contre, le terme « affilié » est celui qui est utilisé pour exprimer sans le dire, les FOSA en partenariat avec lui et, entendons ici par affiliées, les structures bénéficiant l’appui de la ZS. Cela représente environ 85 %. Les autres structures n’ont presque pas de compte à rendre au BCZS par conséquent on assiste à une perte des données épidémiologiques, mais aussi, c’est la population concerné qui est sacrifiée par le coût de soin non règlementé ni coordonné par le ministère sous tutelle. Signalons aussi que, la Ruashi est une des rarissimes ZS à avoir un tel document cadrant le partenariat bien que non mise en œuvre intégralement. Ceci revient à démontrer combien la ZS exerce juste une relation de collaboration avec les privées, sans soubassement scellé.
S’il faut respecter le règlement, seul 5,7% de FOSA privées sont autorisées d’exercer au sein de la ZS Ruashi. La majorité soit 94,2% fonctionne dans l’irrégularité et le plus souvent avec seul le permis d’ouverture délivré par le BCZS. Nous constatons que, la procédure d’obtention des documents y affèrent n’est pas respectée dans la plupart de cas. L’étude faite pour la ville de Goma rapporte 58,8% des FOSA en irrégularité. (Amos K. Kamundu 2021). Ceci nous fait dire que, l’Etat ferme l’œil dans ce sens qu’il n’est pas capable seul avec ses deux structures, de couvrir toute la ZS. Aussi, cette différence peut s’expliquer par le fait que la ZS de la Ruashi est Urbano-rural et donc, très vaste et moins nantie pour répondre aux exigences complète pour ouvrir une FOSA.
Quant à l’accompagnement des aires de Santé et ses structures par le BCZS, le suivis se fait correctement tandis que la supervision et le coaching souffrent, soit respectivement 50.4% et 60%. L’étude de Goma par contre, rapport une supervision à 23% et indique que les FOSA privées sont les moins supervisées. Ceci témoigne d’une souffrance partenariale (Amos K. Kamundu 2021). Il en va de même pour la formation des prestataires qui, selon le même auteur, 55,2% des structures n’ont pas organisées la remise à niveau de leur prestataires. Ce qui revient à dire que, l’Etat devrait s’y engage davantage. Dans notre étude, nous avons constaté un soutient acceptable aux FOSA par le BCZS, dans le but de renforcer les capacités professionnelles et managériales selon le thème, et aussi pour le respect des politiques nationales de soins de santé.
Concernant les engagements des FOSA envers le BCZS, le dépôt des rapports mensuels démontre un partenariat assis dans ce domaine, avec plus de 95% qui déposent promptement et complétement leurs rapports SNIS. Nos résultats corroborent presque avec ceux de Erick au MANIEMA dont La complétude a été de 98% tandis que la promptitude était en basse à 58% (Erick, T. M.2015). Pour la majorité des documents consultés, ces chiffres sont toujours au- delà de 80%. Ce qui donne une nette justification avec la présence remarquée au maximum des responsables des FOSA aux réunions organisées, soit à 100%.
Le tableau sur les contributions mensuelles démontre qu’il y a une certaine faiblesse de la part des structures quant à cet aspect d’engagement. Seulement 29% en moyen contribuent régulièrement au BCZ avec un montant convenu d’environ 10 dollars Américains. Comparé aux résultats de l’année 2019 qui été de 0% (rapport 2019), nous constatons que le FOSA privées ont améliorés dans cet engagement, bien que insignifiant.
Conclusion
Nous avons abordé au cours de ce travail, le sujet sur le partenariat public privé dans un système de santé local. Nous avons pour cela, choisi la zone de santé urbano-rurale de la Ruashi en RDC. Nous avons cherché à analyser les connaissances, attitudes et pratiques des parties prenantes, dans le domaine de la collaboration entre les FOSA privées et l’Etat. Ainsi, au vu de résultats obtenus lors de notre fouille documentaire, nous sommes parvenus à ressortir les conclusions selon lesquelles, le partenariat ou mieux la collaboration est belle et bien effectif dans cette zone de santé, mais très mitigé. Aucune structure sur les 173 reconnues, ne respecte l’observance de l’outil de gestion à leur disposition, moins encore y appose une signature sur le contrat d’intégration élaboré par l’EC. Certaines responsables des structures parlent même de la méconnaissance de ce contrat. Par conséquent, le suivi et l’évaluation posent problème quant à leur objectivité, bien que le rapport indique un suivi efficace à 100%. Voilà pourquoi, nous pensons qu’il s’agit plutôt d’une relation de collaboration basée sur la confiance, entre les FOSA et le BCZS. Cette confiance, contraint d’une manière implicite le BCZ à conjuguer avec les FOSA privées surtout que ces dernières sont majoritaires dans la ZS, avec une proportion de plus de 98 % des structures, parmi celles reconnues. Ce nombre des structures privées joue un rôle prépondérant dans le système de références et contre référence, avec moins de 1% des cas référés, suite à certaines FOSA possèdent des PCA, avec un personnel qualifié. Mais aussi, parce que dans la plupart des cas, un patient représente une source de finance pour une FOSA. Voilà pourquoi, s’en suit souvent un acharnement thérapeutique qui, en cas de d’altération profonde de l’état général du malade, il est évacué les cas échéant en catastrophe, pour éviter d’endosser les responsabilités d’un décès éventuel. Cette relation de confiance se manifeste aussi dans le soutient et l’appui du BCZ aux structures dite « affiliées », en différents intrants et services disponibles. Il s’agit : Des formations dans plusieurs domaines de la santé tels que la politique nationale de prise en charge de différentes pathologies à caractère épidémiques et/ ou chroniques, en gestions des intrants... La collaboration réside aussi dans l’appui du BCZS en médicaments essentiel, en vaccins et autres, selon les dotations du gouvernement ou des ONG partenaires, nationales et/ ou internationales. De l’autre côté, les FOSA déposent régulièrement leurs rapports d’une manière prompte et complète, à une proportion de plus de 80%. Egalement, la participation aux réunions de monitorage par les responsables des FOSA, dans le but de faire une compilation des données à déposer au BCZS, pour lui permettre d’avoir une vue globale de l’état de santé de la population de la ZS Ruashi. Les FOSA ne contribuent pas toutes en termes de finance. A peine une moyenne de 29% seulement qui participent au fonctionnement du BCZS et cela, démotive par moment cette collaboration. Les résultats de cette recherche, mettent en lumière le fonctionnement qui concerne la collaboration entre les structures privées et l’Etat congolais, et ainsi, contribuent à l’amélioration de ce partenariat privilégié s’il en est, pour un système de santé local efficace et efficient. Plusieurs d’autres aspects n’ont pas été traité dans ce travail, qui constituent par la suite ses limités. Il s’agit de :
- Respecter la vie et la dignité humaine, les règles d’éthique et déontologie médicale
- Respecter et appliquer la politique sanitaire et pharmaceutique national
- Appliquer les stratégies nationales pour les activités intégrées et applique les normes de l’assurance qualité
- Adopter la structure organique définie par le ministère de la santé pour les établissements de soins.
- Garantir dans la mesure du possible, la stabilité des personnels ayant bénéficiés des formations sur les activités du SSP
- Respecter les normes de la gestion de déchets biomédicaux.
Ces aspects énumérés ci-haut, constituent d’emblée un grand champ de recherche pour d’autres futurs chercheurs, dans le domaine du partenariat dans un système de santé local, en vue de son développement intégral. A ceci nous ajoutons la redéfinition même réelle de ce qui est « privé ». Est-ce c’est l’acte médical qui est privé, ou le malade, ou les matériels utilisés, soit enfin le bâtiment abritant la FOSA ? Étant donné que le sol et le sous-sol appartiennent à l’Etat, comment peut-on se prévaloir être détenteur d’une structure privée sur un sol qui appartient à l’Etat ?
Recommandations :
A la suite des résultats obtenus dans ce travail, nous formulons quelques recommandations que voici :
Au niveau de la politique centrale :
- Penser à construire suffisamment les FOSA publiques, pour un équilibre proportionnel
- Penser au redimensionnement de la ZS, pour une gestion efficace et maitrise des effectifs des FOSA privées
- Soutenir efficacement les BCZS pour lui permettre d’exécuter complétement la politique nationale en matière de santé publique.
Au niveau intermédiaire :
- Adapter un modèle de contrat suivant la réalité du milieu, pour le compte du partenariat avec les privées localement,
Au niveau périphérique
- Vulgarisation de l’outil constituant le contrat d’engagement entre les partenaires, à toutes les structures.
- Faire respecter ce contrat de partenariat
- Effectuer un control de toutes les structures œuvrant dans la ZS, en vue de les identifier toutes, et les intégrer dans la ZS. Ce qui par conséquent permettra à obtenir les données épidémiologiques globales et valides, à chaque rapportage.
- Que les autres BCZS de la ville voire du pays, n’ayant pas un soubassement scellé avec les FOSA privées, puissent se mettre en ordre utile, pour le besoin de la cause.
Références
ALEXIS, N. K., ANTOINE, B. M., HUGUETTE, K. L., & CORNELIE, M. K. (2021). Pluralisme Thérapeutique au Haut Katanga: le malade est un être vulnérable.International Journal of Social Sciencesand Scientific Studies,1(3), 6373.
Base de revues mensuelles Zone de santé Ruashi. (2020 à 2023). Inédit
BELGHITI, Z., & DRISSI, S. (2023). L’évaluation Des Risques Dans Les Projets De Partenariat Public-Privé Au Maroc: Cas Du Secteur De L’énergie. Repéré d’url : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol4issu1/art_v4_issue1_7.pdf
Bob, S. N., Jeanne, M. S., Paul, P. M. J., Michel, K. S., Joseph, K. M., Marc, N. K., ... & Maurice, G. M. (2023). Mesures D’application Pour La réussite De La Mise En Œuvre Des Activités De La Couverture Sante Universelle En Rd Congo.International Journal of Social Sciencesand Scientific Studies,3(1), 2158-2178
Buse K, Waxman A. (2002). Partenariats public-privé pour la santé: une stratégie pour l’OMS; Bulletin of the World Health Organization, 2001, 79 (8):748-754.repéré d’url: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/71429/RA_2002_6_1- 7_fre.pdf?sequence=1
Chuy. KD.., Criel, B., Accoe, K., & Faustin, C. M. une priorité conditionnelle pour le renforcement du système de santé. Repéré d’url https://www.ccsc- rdc.net/doc/ccsc_note_de_politique_08_web.pdf
CIBANGU, R. (2021). Evaluation du respect des procédures d’ouverture des formations sanitaires dans la zone de sante de Kansele, Province du Kasaï Oriental, République
Démocratique du Congo.Environmental and WaterSciences, public Health and Territorial Intelligence Journal,5(4), 732-737.
DHIS 2: tire d’url: https://snisrdc.com/dhis-web-commons/security/login.action
Ghobadian, Abby; O'Regan, Nicholas; Gallear, David and Viney, Howard eds. (2004) Revue du Contrôle de la Comptabilité ET de l’Audit ISSN: 2550-469X Volume 4: numéro 2 Revue CCA www.revuecca.com Page 316 Private-public partnerships: Policy and expérience UK: Palgrave Macmillan, p.15-23.
Gonguet F, Gores L, Hengy N, et al. (2023). Rapport D'assistance, Rapport du FMI n° 23/58 DU CONGO, D. É. M. O. C. R. A. T. I. Q. U. E. Tiré d’url : https://www.imf.org/- /media/Files/Publications/CR/2023/French/1CODFA2023001.ashx
Guilbaud, A. (2015). Les partenariats public-privé sanitaires internationaux: diffusion et incarnation d’une norme de coopération.Monde en développement, (2), 91-104
Hodge, G. A. (2004). Risks in Public-Private Partnerships: Shifting, Sharing or Shirking? Asia Pacific Journal of Public Administration, 26(2), p. 155-179.
Ilunga KF (2007). Pratiques du partenariat public/organisation sans but lucratif dans l'offre d'un service public: Proposition d'un modèle pour la réhabilitation de l'hôpital de Doruma en République Démocratique du Congo, (mémoire de maitrise, Université Senghor). Repéré d’url : https://www.memoireonline.com/07/08/1322/m_pratiques- partenariat-public-organisation-rehabilitation-hopital-doruma0.html
Izu, A., & Mulolo, B. (2017). Evaluation des Objectifs du Millénaire pour le Développement en RDC: quelles leçons pour les Objectifs du Développement Durable?
Kamundu, A. K., Mishika, P., Banyene, F. B., Abdala, A. K., Mukuku, O., Kibendelwa, Z. T., ... & Wembonyama, S. O. (2021). L'Etat des lieux de formations sanitaires privées dans la ville de Goma.Journal of Medicine, Public Health andPolicy Research,1(1), 1-5.
Kuamba, E., Molima, C., Karemere, J., Balegamire, S. J., & Karemere, H. (2020). Déterminants prioritaires de l'accès aux services des soins de la Zone de santé de Bagira pour les enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme: Un protocole d'étude.International Journal of Innovation and Applied Studios,30(4), 808-820.
LEMQEDDEM, H. A., & EL ALAMI, H. (2020) Les facteurs critiques de succès des partenariats public-privé: une revue critique de la littérature.Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit,4(2).
Mukalayi, M. W., & Mukalenge, F. C. Chuy Kalombola Didier, Bart Criel, Zakaria Belrhiti, et coll. (2019) : La politique publique du système de santé de district et sa mise en œuvre : une étude mixte d’évaluation dans la ville de Lubumbashi, République Démocratique du Congo. Repéré dans url : https://www.researchgate.net/profile/Zakaria-Belrhiti/publication/334051292. page 15.
Nama, M. C., Malonga, K. F., Kahumba, B. J., & Kakoma, S. (2021). Cartographie et caractéristiques des tradi-praticiens et phytothérapie en médecine traditionnelle dans la ville de Lubumbashi en RDC.International Journal of Social Sciences and Scientific Studies,1(4), 72-88.
Ndour, M. I. (2006). Les partenariats public-privé mondiaux pour la santé.Idées pour le débat,7.
Njanjo Sike Lobe, R. G. (2021).Le contrat de partenariat public-privé au regard de la théorie générale des contrats: étude de droit camerounais à la lumière du droit français(Doctoral dissertation, Toulouse 1).
Objectifs Durable Développement (sd) : repéré d’url: https://www.cci.fr/actualites/les- objectifs-de-developpement-durable
Ordonnance loi numéro 23/006 du 23 mars 2023 modifiant et complétant la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes relatifs à l'organisation de la santé publique
Osborne, S.P and Murray, V. (2000)Inderstanding the process of public-private partnerships. In In S.P Osborne (Ed) Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective Routledge, London P. 70-83
Partenariat public-privé dans le secteur de la santé : tiré d’URL https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2009/july/20090727ppp #:~:text=*%20On%20appelle%20partenariat%20public%2Dpriv%C3%A9,'un%20acc ord%20de%20coop%C3%A9ration%20%C2%BB
Plan National de Développement Sanitaire (2016-2020). Repéré d’url : https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/RDC-Plan-National-de- Developpement-Sanitaire-2016-2020.pdf
Plan National de Développement Sanitaire (2019-2020) repéré d’url: https://santenews.info/wp-content/uploads/2020/04/PNDS-2019-2022_GOUVERNANCE.pdf
Rapport Annuel D’activités De La Zone De Sante Ruashi (2019), repéré d’url : https://www.sanru.cd/index.php/component/k2/item/download/555_9114a2a94303eb5 6b04385187d22fa1d
Runavot, M. C. (2014). Les partenariats public-privé dans le domaine de la santé: réflexions sur un nouveau mode d’exercice de l’autorité publique internationale.Annuaire Français de Droit International,60(1), 655-684
Tshikamba, M.E (2015) Analyse de la qualité des données du Système d’Information Sanitaire de routine: Défis et Perspectives pour un Système performant dans la Province du Maniema en République Démocratique du CONGO. Page 4. Repéré d’url : https://memoires.usenghor- francophonie.org/memoires/san/1315/ErickTshikamba.pdf
Foire aux questions
What is the subject of this document?
This document is a language preview, presumably for academic use, analyzing themes in a structured and professional manner. It focuses on the knowledge, attitude, and practice of public-private partnerships (PPP) in a local health system, specifically the Ruashi health zone in the Democratic Republic of Congo (DRC).
What are the main topics covered in the document?
The document covers the following main topics: review of literature on public-private partnerships, therapeutic pluralism, national and local perspectives, risk management, methodology, data analysis, discussion, conclusion, and recommendations.
What is the summary of the research?
The research focuses on the knowledge, attitude, and practice of public-private partnerships in the Ruashi health zone in the DRC. It aims to inform partners and decision-makers about the functioning of the partnership between private health facilities and the central health zone bureau. It also highlights the lack of formal contracts and follow-up in many partnerships.
What are the acknowledgements?
The author expresses gratitude to God, tutors, parents, family members, spouse, child, the health team of the Ruashi health zone, and staff at various health centers for their support.
What tables and graphs are included in the document?
The document includes several tables and graphs illustrating the distribution of health structures, their affiliation status, contract signing status, document availability, monitoring support, training of providers, report submission, financial contribution, referral cases, counter-referral cases, and continuity of care.
What abbreviations are used in the document?
The abbreviations used include: BCZS (Bureau Central de la Zone de Santé), CS (Centre de Santé), DHIS2 (District Health Information System 2), DPS (Division Provinciale de la Santé), EC (Equipe Cadre), ECZ (Equipe Cadre de la Zone), ECZS (Equipe Cadre de la Zone Santé), FOSA (Formation Sanitaire), HGR (Hôpital Général de Référence), HP (Hôpital Provincial), IPS (Inspection Provinciale de la Santé), PCA (Paquet Complet d’activités), PMA (Paquet Minimum d’activités), PPP (partenariat public privé), RDC (République Démocratique du Congo), SNIS (Système National d’Information Sanitaire), SSP (Soins de Santé Primaire), ZS (Zone de Santé).
What is the objective of the research?
The objective is to understand how the partnership works between private and public entities in order to improve the delivery of healthcare services and identify ways to support and sustain these partnerships.
What does the literature review say about PPPs?
The literature review describes the nature of PPPs, their origin, evolution and the importance of a documented contract for the success of the cooperation between private and public entities.
What are the study limitations?
The limitations include non-respect of human life and dignity, the unaddressed role of ethics and medical deontology, national health policies, integrated activity strategies, adoption of ministerial structure, staff stability after training, waste management, and the definition of what constitutes a private entity in the context of public lands.
What are the recommendations from the research?
The recommendations are focused on all levels including the central level, intermediate level, and peripheral level to focus on building facilities, downsizing the health zone, effective support, adapting a partnership model following the reality of the region, respecting the contracts, and finally control all the structures that are operating in the zone.
- Citar trabajo
- John-Ly Nsenga Mbele (Autor), 2024, Partenariat public-privé dans le domaine de la santé à Ruashi, République démocratique du Congo, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1466042