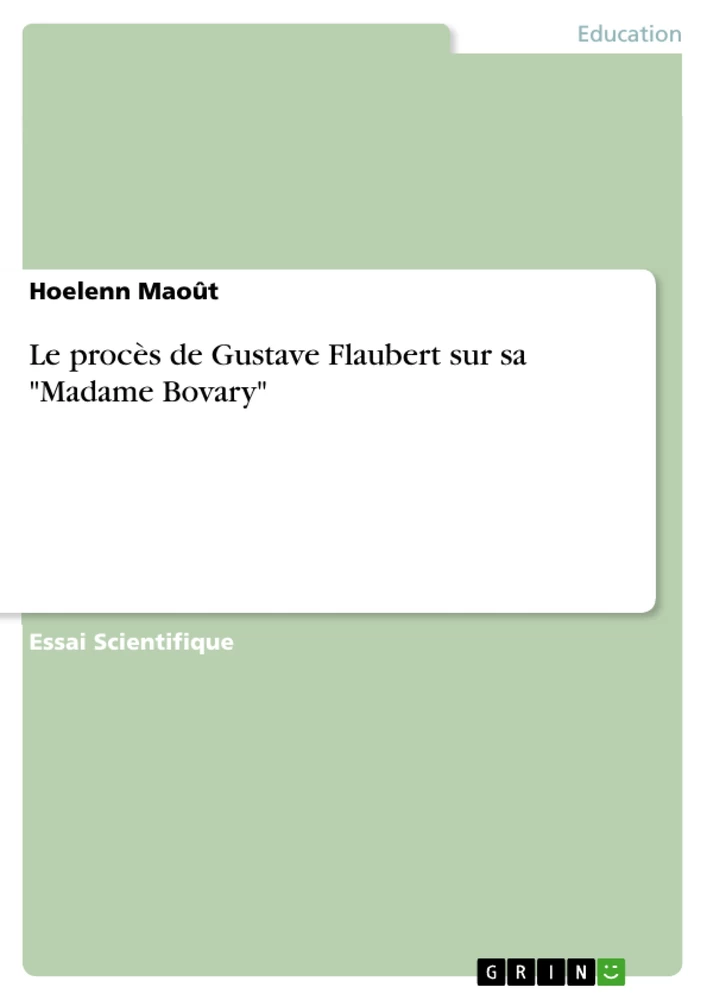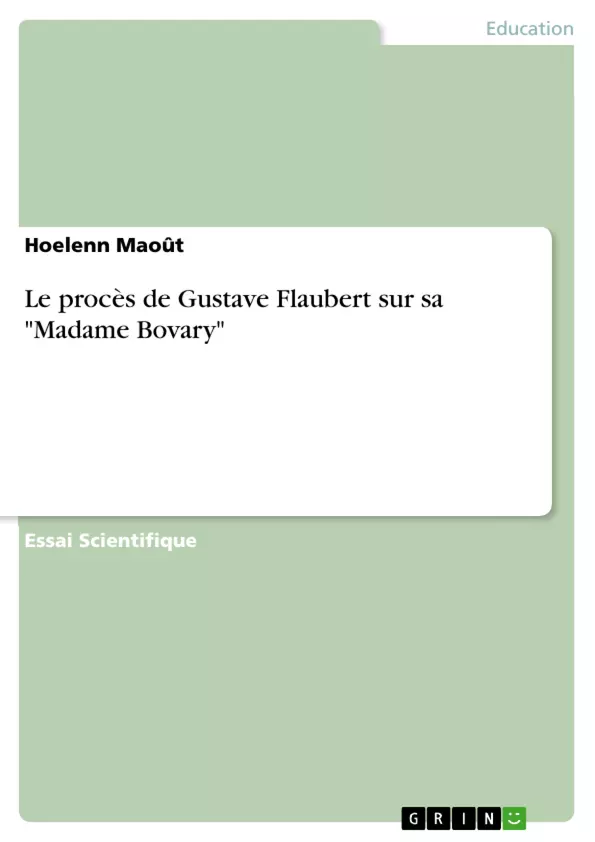Dans la tâche présente, il est question d’une réflexion de la théorie littéraire. Alors, il ne s’agit pas d’une analyse de l’œuvre de Flaubert, qui est d’une manière ou d’une autre faite par l’accusation et la plaidoirie. En effet, on se confronte ici avec les conceptions littéraires et les conséquences pour l’analyse résultant du discours des contemporains de l’écrivain. Donc, nous ne pouvons que souligner notre point de vue différent de ceux qui ont lu et analysé Madame Bovary en présence de l’Auteur. Après sa mort, la biographie d’un écrivain est aussi seulement un texte, et laquelle ne peut guère fonctionner comme source d’interprétation, vu qu’il existe, par exemple dans le cas de Baudelaire, une énième quantité de textes qui se contredit. Laquelle veut-on croire? Cela conduit au cœur de la discussion sur la propriété et ainsi la responsabilité d’un texte, fruit d’un changement judiciaire qui invente dans le Code de la propriété intellectuelle le droit d’Auteur (1777/1793). Tout d’abord, il est frappant que les deux analyses produites arrivent à juger le même texte d’une façon complètement opposée. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Der Prozess gegen Gustave Flaubert und seine Madame Bovary (1857)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit reflektiert literaturtheoretische Konzepte im Kontext des Prozesses gegen Gustave Flaubert wegen seines Romans "Madame Bovary". Sie analysiert die gegensätzlichen Interpretationen des Romans durch Anklage und Verteidigung und untersucht die Folgen unterschiedlicher literarischer Auffassungen für die Textanalyse. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Autors und die Frage nach der Autorität und Verantwortung des Textes im 19. Jahrhundert.
- Die gegensätzlichen Interpretationen von "Madame Bovary" im Prozess
- Die Rolle des Autors und die Frage nach der Urheberschaft
- Der Kontext und die Bedeutung von Textauszügen
- Der Einfluss literaturtheoretischer Konzepte (Saussure, Derrida, Foucault)
- Der Realismus als literarische Ideologie
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prozess gegen Gustave Flaubert und seine Madame Bovary (1857): Diese Arbeit analysiert den Prozess gegen Gustave Flaubert wegen seines Romans "Madame Bovary". Sie vergleicht die gegensätzlichen Interpretationen des Romans durch Anklage und Verteidigung, wobei die Anklage den Roman als moralisch anstößig und religionsfeindlich, die Verteidigung hingegen als Darstellung gesellschaftlicher Realitäten sieht. Beide Seiten beziehen sich auf Textauszüge, die jedoch je nach Kontext unterschiedlich interpretiert werden. Der Text beleuchtet die Problematik des Kontextes und die Rolle des Autors als Interpretationsinstanz. Derrida's Konzepte von "Spuren" und "Differenz" werden in Bezug auf die unterschiedlichen Lesarten herangezogen, wobei der Fokus auf die Polysemie der Zeichen und die Rolle des Lesers als Produzent von Bedeutung liegt. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Autorkonzepts vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert und die Frage nach Originalität und Autonomie literarischer Werke. Die Beziehung zwischen Form und Inhalt, der Einfluss von Philosophie (Heidegger) und die Rolle des "realistischen" Stils werden kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Gustave Flaubert, Madame Bovary, Literaturprozess, Autorkonzept, Textinterpretation, Kontext, Polysemie, Hermeneutik, Realismus, Saussure, Derrida, Foucault, Urheberrecht, Moral, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Prozess gegen Gustave Flaubert und seine Madame Bovary (1857)"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Prozess gegen Gustave Flaubert wegen seines Romans "Madame Bovary" (1857). Im Mittelpunkt steht der Vergleich gegensätzlicher Interpretationen des Romans durch Anklage und Verteidigung, die Untersuchung der Rolle des Autors und die Frage nach der Autorität und Verantwortung des Textes im 19. Jahrhundert. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss literaturtheoretischer Konzepte auf die Textanalyse.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die gegensätzlichen Interpretationen von "Madame Bovary" im Prozess, die Rolle des Autors und die Frage nach der Urheberschaft, den Kontext und die Bedeutung von Textauszügen, den Einfluss literaturtheoretischer Konzepte (Saussure, Derrida, Foucault) und den Realismus als literarische Ideologie.
Wie werden die gegensätzlichen Interpretationen von "Madame Bovary" dargestellt?
Die Arbeit vergleicht die Sichtweisen der Anklage (moralisch anstößig, religionsfeindlich) und der Verteidigung (Darstellung gesellschaftlicher Realitäten). Die unterschiedliche Interpretation von Textauszügen je nach Kontext wird detailliert analysiert. Derridas Konzepte von "Spuren" und "Differenz" werden herangezogen, um die Polysemie der Zeichen und die Rolle des Lesers als Bedeutungsproduzent zu beleuchten.
Welche Rolle spielt der Autor und das Autorkonzept?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Autorkonzepts vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert und die Frage nach Originalität und Autonomie literarischer Werke. Die Rolle des Autors als Interpretationsinstanz und die Beziehung zwischen Form und Inhalt werden kritisch hinterfragt.
Welche literaturtheoretischen Konzepte werden angewendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Konzepte von Saussure, Derrida und Foucault, um die Textinterpretation und die Herausforderungen des Kontextes zu beleuchten. Die Beziehung zwischen Philosophie (Heidegger) und dem "realistischen" Stil wird ebenfalls kritisch hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Gustave Flaubert, Madame Bovary, Literaturprozess, Autorkonzept, Textinterpretation, Kontext, Polysemie, Hermeneutik, Realismus, Saussure, Derrida, Foucault, Urheberrecht, Moral, Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf eine detaillierte Analyse des Prozesses gegen Gustave Flaubert und "Madame Bovary", unter Einbezug der genannten literaturtheoretischen und philosophischen Konzepte zur Interpretation des Romans und des Prozesses selbst.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Literaturwissenschaft, den französischen Realismus, den Prozess gegen Flaubert und die literaturtheoretischen Debatten des 19. und 20. Jahrhunderts interessieren.
- Citation du texte
- M.A. Hoelenn Maoût (Auteur), 2006, Le procès de Gustave Flaubert sur sa "Madame Bovary", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167235