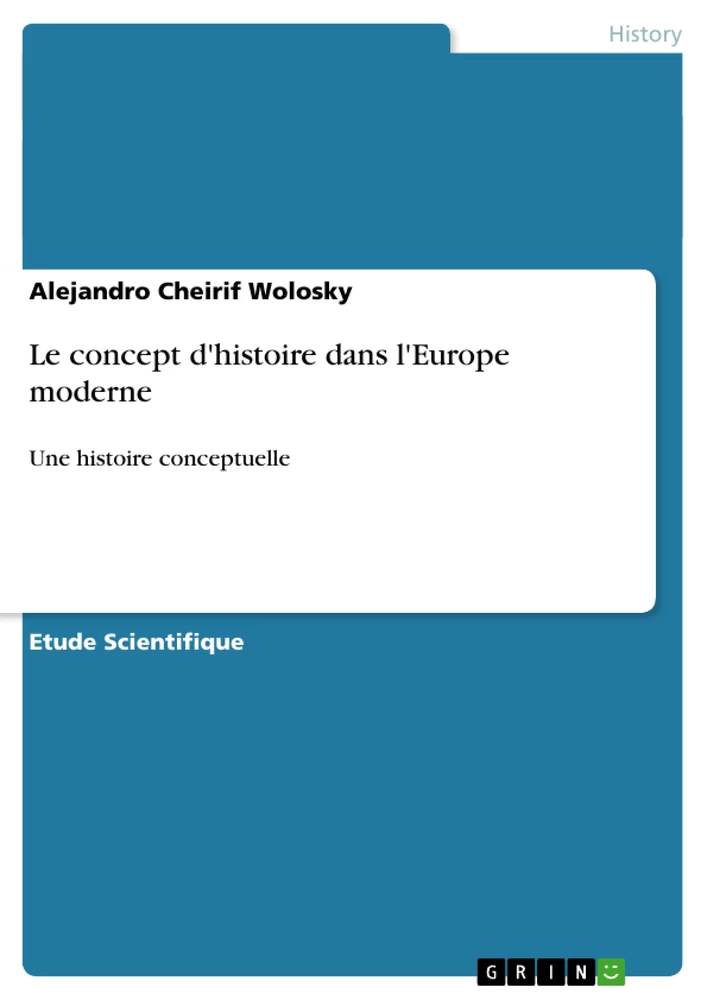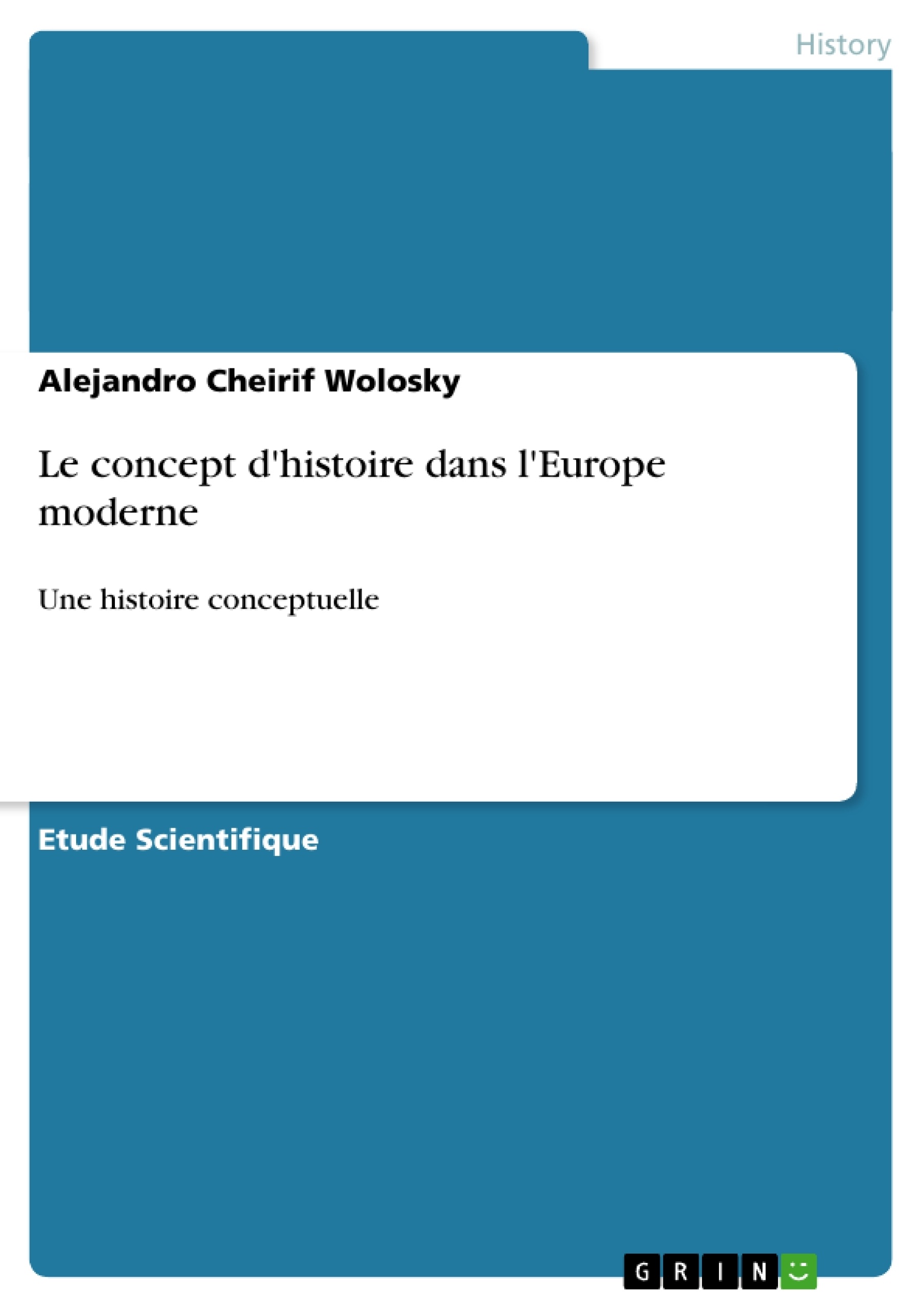This book is a conceptual history of the concept of "history" during early modern Europe. It is based on Reinhart Koselleck's conceptual history theory.
Inhaltsverzeichnis
- Erste Polysémie: l'historia magistra vitae
- Zweite Polysémie: die Fabel
- Dritte Polysémie: Die Geschichte als literarisches Genre
- Vierte Polysémie: Die Philosophie der Geschichte
- Fünfte Polysémie: Die Wissenschaft der Geschichte
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte des Begriffs "Geschichte" im Kontext der europäischen Moderne und analysiert dessen Entwicklung und Vielschichtigkeit. Der Fokus liegt auf der Erforschung der unterschiedlichen Bedeutungsfacetten, die der Begriff "Geschichte" im Laufe der Zeit angenommen hat.
- Entwicklung des Begriffs "Geschichte" in der europäischen Moderne
- Analyse der unterschiedlichen Bedeutungsfacetten des Begriffs "Geschichte"
- Untersuchung der historischen Diskurse, die den Begriff "Geschichte" geprägt haben
- Rekonstruktion der Entstehung verschiedener "Geschichtsbegriffe" und ihrer Entwicklung
- Einordnung des Begriffs "Geschichte" in den Kontext der historiographischen Traditionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel, die jeweils eine bestimmte Facette des Begriffs "Geschichte" untersuchen.
- Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung von "Historia Magistra Vitae", die im Kontext der europäischen Antike und des Mittelalters besonders relevant war.
- Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung des Begriffs "Geschichte" als Fabel oder Erzählung im Kontext der literarischen Traditionen betrachtet.
- Das dritte Kapitel analysiert die Geschichte des Begriffs "Geschichte" als eigenständiges literarisches Genre.
- Das vierte Kapitel untersucht die Entstehung und Entwicklung der Philosophie der Geschichte, die sich mit der Frage nach dem Sinn der Geschichte beschäftigt.
- Das fünfte Kapitel analysiert den Aufstieg der Wissenschaft der Geschichte und die Entwicklung historiographischer Methoden im 19. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Geschichte, Begriffsgeschichte, Europa, Moderne, Historia Magistra Vitae, Fabel, Literatur, Philosophie, Wissenschaft, Historiographie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Buches „Le concept d'histoire“?
Es handelt sich um eine Begriffsgeschichte des Wortes „Geschichte“ im Europa der frühen Neuzeit, basierend auf den Theorien von Reinhart Koselleck.
Was bedeutet „Historia Magistra Vitae“?
Dieser Begriff aus der Antike beschreibt die Geschichte als „Lehrmeisterin des Lebens“, aus deren Beispielen man für die Gegenwart lernen kann.
Wie entwickelte sich Geschichte als literarisches Genre?
Der Begriff wandelte sich von der einfachen Fabel oder Erzählung hin zu einer eigenständigen literarischen Gattung mit spezifischen Regeln.
Was untersucht die Philosophie der Geschichte?
Sie befasst sich mit der Frage nach dem übergeordneten Sinn und der Zielrichtung des historischen Verlaufs.
Wann entstand die moderne Geschichtswissenschaft?
Der Aufstieg der Geschichte als exakte Wissenschaft mit methodischer Quellenkritik wird primär im 19. Jahrhundert verortet.
- Quote paper
- Alejandro Cheirif Wolosky (Author), 2013, Le concept d'histoire dans l'Europe moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230898