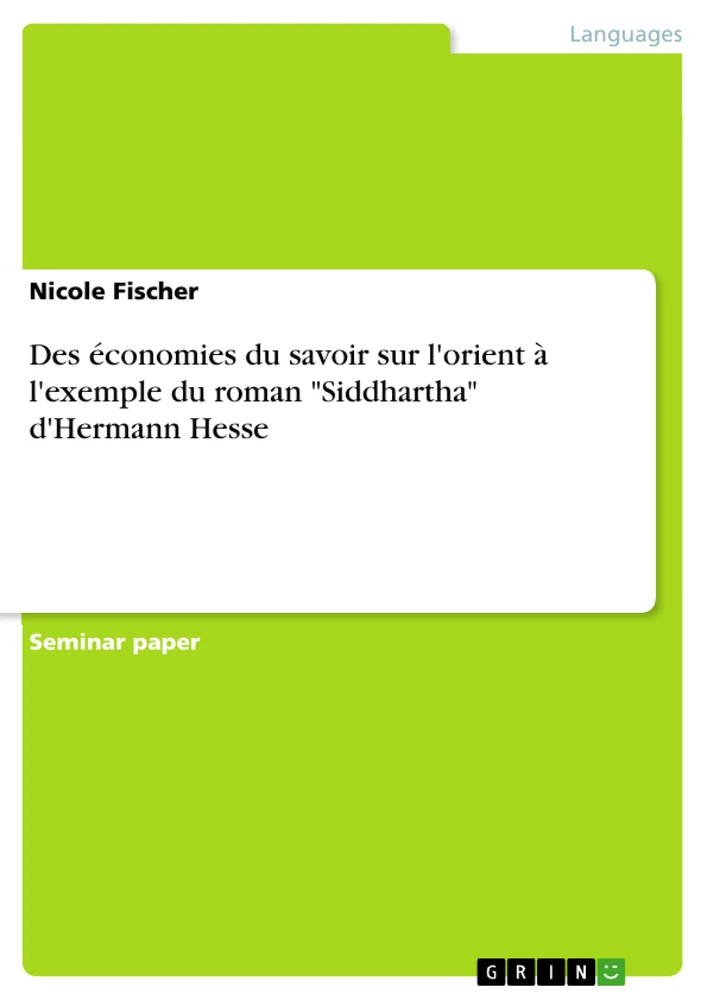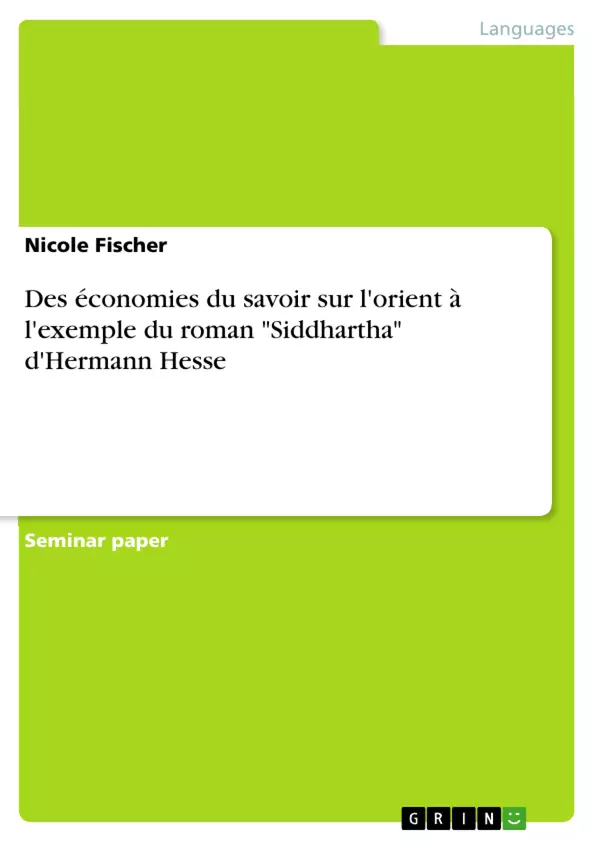Hermann Hesse est fils des parents missionnaires qui travaillaient en Inde et qui l'ont encouragé à lire des oeuvres indiennes anciennes. Les lettres croient lui capable d'un traitement critique du bouddhisme, une conviction qui est pour la plupart liée à son roman « Siddhartha ». Dans ceci, il se présente autant comme transformateurs des idées de l'est que critique. Hesse a une manière sélective de traiter ses connaissances sur Inde ; il évite, on dira, de se mettre au service de la religion bouddhiste mais il développe une philosophie soi-même qui a des congruences conceptuelles ainsi que ponctuelles avec le bouddhisme. À départ de cette observation, on va examiner la philosophie présentée dans « Siddhartha » sur le fond de son inspiration orientale. On en vient à soupçonner que l'intégration de l'élément indien et du bouddhisme ne sert qu'à transmettre sa propre philosophie, donc qu'Hesse l'instrumentalise pour sa démarche.
Pour aller au fond de cette observation, on traitera et classifiera les autres traits indiens à part du bouddhisme comme le lieu poétique et la construction des personnages. Il sera important de bien distinguer l'élément indien soi servant comme aspect de la forme soi comme aspect du contenu. On va voir qu'il y a des chevauchements entre les idées d'Hesse et celles du bouddhisme. Donc, on consacrera un chapitre de ce travail pour expliquer pourquoi à certaines parties on observe des congruences idéelles en remarquant la détermination avec laquelle Hesse a choisi le lieu de « Siddhartha ».
Pour vérifier l'impression sur le traitement d'un sujet oriental on va comparer et discuter la méthode et le poursuit d'Hesse d'intégrer des connaissances sur Inde avec la littérature secondaire dans le cadre d'orientalisme en se souvenant de la position culturelle de l'auteur. Pour achever un résultat synthétique, je vais aussi me concentrer sur le protagoniste qui, en appartenant au monde de l'est et en trouvant de la balance dans une philosophie artificielle, fonctionne comme l'arche entre le lecteur et le monde poétique.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- Der Diskurs über den Orient nach E. Said
- Die wichtigsten Annahmen seiner Theorie
- Die Klassifizierung der Behandlung des Wissens über den Orient nach Said
- Das Nahe und das Fremde – Ein Blick auf die Elemente des Westens und Ostens in „Siddhartha”
- Die Konstellationen des Seins und ihre Funktionen
- Die Konzepte des Seins – Der Protagonist als Repräsentant
- Der Buddhistische Hesse – Der Versuch einer Synthese zwischen den Kulturen
- „Siddhartha“ als orientalist. Werk
- Diskussion: Das Ich und das Projekt in Beziehung
- Deutschland und der „neue Orientalismus”
- Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse im Verlauf der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hermann Hesses Roman „Siddhartha“ und seine Verwendung von östlichen, insbesondere buddhistischen, Elementen. Das Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit Hesses Philosophie durch östliche Einflüsse geprägt ist und ob er diese für seine eigene Denkweise instrumentalsiert. Dabei werden die verschiedenen Aspekte des „Indischen” in „Siddhartha“ – vom buddhistischen Hintergrund bis hin zur poesievollen Gestaltung des Romans – betrachtet.
- Die Verwendung von östlichen Elementen in Hesses „Siddhartha“
- Die Rolle des Buddhismus in Hesses Philosophie
- Die Beziehung zwischen Hesses eigener Philosophie und dem Buddhismus
- Die Darstellung des Protagonisten als Repräsentant des „Indischen”
- Die Synthese von östlichen und westlichen Elementen in Hesses Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Hermann Hesses Leben und Werk und stellt die Relevanz seines Romans „Siddhartha“ im Kontext des Orientalismus heraus. Anschließend wird die Theorie des Orientalismus von Edward Said vorgestellt, wobei seine wichtigsten Annahmen und die von Said entwickelte Klassifizierung der orientalischen Behandlung des Ostens in westlichen Werken im Mittelpunkt stehen. Es wird gezeigt, dass der Orientalismus nach Said eine systematische Verzerrung des Ostens im Sinne des Westens darstellt, die zur Konstruktion von Machtverhältnissen führt.
Das nächste Kapitel befasst sich mit der Darstellung des „Indischen“ in „Siddhartha“. Dabei werden wichtige Figuren wie Govinda und Kamala analysiert, die als Repräsentanten des ostasiatischen Geistes fungieren und den Protagonisten Siddhartha auf seiner spirituellen Suche beeinflussen. Der Protagonist Siddhartha selbst wird als Vertreter der westlichen Welt betrachtet, der durch die Begegnung mit dem Osten eine neue Sichtweise auf die Welt gewinnt. Die philosophischen Aspekte des Romans, insbesondere die darin dargestellte Synthese von östlicher und westlicher Denkweise, werden im weiteren Verlauf untersucht.
Schließlich werden die Erkenntnisse der Arbeit im Kontext der Theorie des Orientalismus nach Edward Said zusammengefasst. Dabei wird untersucht, inwieweit Hesses Behandlung des Ostens in „Siddhartha“ in das von Said definierte Schema des Orientalismus passt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Orientalismus in Hermann Hesses „Siddhartha“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen östliche Einflüsse, Buddhismus, Philosophie, Darstellung des „Indischen“, Synthese von Ost und West und die Analyse des Protagonisten Siddhartha. Die Arbeit greift auf Edward Saids Theorie des Orientalismus zurück und untersucht die Beziehung zwischen Hesses Roman und den von Said identifizierten Mustern des Orientalismus. Weitere wichtige Begriffe sind „Ego“, „Projekt“, „Kultur“ und „Identität”.
Häufig gestellte Fragen
Wie verarbeitet Hermann Hesse den Buddhismus in seinem Roman "Siddhartha"?
Hesse nutzt den Buddhismus selektiv, um eine eigene Philosophie zu entwickeln. Er integriert orientalische Ideen, bleibt aber kritisch und instrumentalisiert sie teilweise für seine westlich geprägten Denkmuster.
Welche Rolle spielt Edward Saids Theorie des Orientalismus in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt Saids Theorie, um zu untersuchen, ob Hesse den Orient in "Siddhartha" systematisch verzerrt darstellt, um westliche Machtverhältnisse oder Identitätskonzepte zu stützen.
Ist der Protagonist Siddhartha ein echter Repräsentant des Ostens?
Die Analyse legt nahe, dass Siddhartha als eine Art "Brücke" fungiert, der zwar in der östlichen Welt angesiedelt ist, aber primär westliche Individualitätskonzepte verkörpert.
Welche indischen Elemente außer dem Buddhismus werden im Roman untersucht?
Die Arbeit klassifiziert auch den poetischen Ort (Setting) und die Konstruktion von Charakteren wie Govinda und Kamala als spezifisch indische Trait-Elemente.
Was ist das Ergebnis der Synthese zwischen Orient und Okzident bei Hesse?
Hesse schafft eine künstliche Philosophie, die zwar Anleihen beim Buddhismus macht, aber letztlich dem westlichen Leser als Identifikationsraum für die eigene spirituelle Suche dient.
- Arbeit zitieren
- Nicole Fischer (Autor:in), 2015, Des économies du savoir sur l'orient à l'exemple du roman "Siddhartha" d'Hermann Hesse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322795