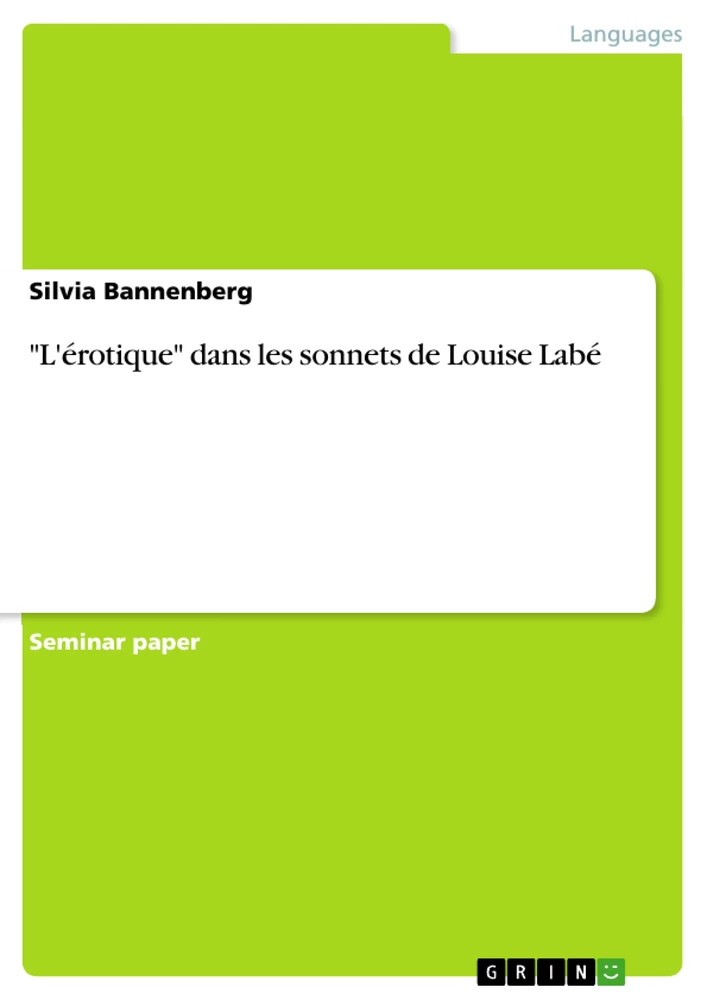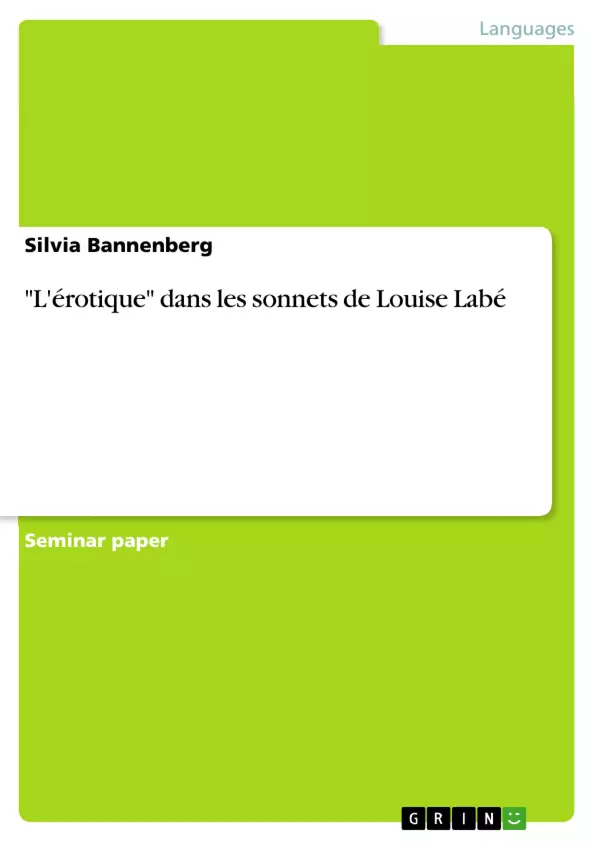«Louise Labé était de mœurs et de vers trop faciles. Ses sonnets sont tels qu’on n’ose guère y toucher» – une opinion du XIXe siècle qui, surtout pendant cette époque-là, ne semble pas être rare. Elle s’est très probablement formée parce que «Louise Labé bousculait (…) le schéma des rôles établis». Caché par des initiales, déjà l’« Épître dédicatoire » des Œuvres s’adresse à «Mademoiselle Clémence de Bourges, Lyonnaise» au lieu d’y nommer un protecteur masculin. Toute l’épître témoigne d’un certain féminisme: Louise Labé y affirme le désir de voir «notre sexe (…) non en beauté seulement, mais en science et vertu passer ou egaler les hommes» et refuse ainsi «les attributs traditionnels de la femme-objet». Mais qu’est-ce qui justifie un avis tel de L. Veyrières concernant Louise Labé et ses sonnets ? S’agit-il, comme l’affirme Karine Berriot, du fait que
(…) les hommes de la Renaissance n’ont pas réussi à surmonter le tabou, hérité de l’Antiquité, qui faisait de l’amour et du sexe deux domaines bien distincts ; la poétesse courtisane célébrant une passion sincère constituait une tentative d’unification indéniable, mais comme telle dangereuse en tant qu’elle mettait en cause la vieille structure – toujours implicitement admise – qui chez les Grecs distinguait l’épouse procréatrice de la concubine et de la prostituée?
Quoi qu’il en soit, il existent également des voix louant Louise Labé et son écriture ; laissons ici la parole à Rainer Maria Rilke:
Beauté, culture, douceur, bonté, aucune qualité ne fit défaut à la Belle Cordière (…). On s’étonne qu’elle ait pu passer, aux yeux de certains, pour une indigne courtisane. On ne saurait trouver dans toute notre littérature des poèmes d’amour plus pudiques.
Ce travail aura pour but d’étudier et définir «l’objet de scandale»: l’érotique dans les sonnets amoureux de Louise Labé.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- 1. Eine Poétesse der Renaissance
- 1.1 La vie de Louise Labé
- 1.2 Les sonnets de Louise Labé dans le contexte intellectuel de l'histoire contemporaine
- 2. L'arrière-plan de « l'érotique »
- 2.1 Une définition
- 2.2 L'apparence et le rôle de l'érotique dans la littérature de la Renaissance
- 3. Une étude de l'érotique dans les sonnets de Louise Labé
- 3.1 Les sensations et le corps
- 3.2 L'âme éprouvante
- 3.3 L'écriture amoureuse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kontroverse Figur der Louise Labé und den als "skandalös" empfundenen erotischen Aspekt in ihren Sonetten. Ziel ist es, "l'érotique" in Labés Werk zu definieren und im Kontext der Renaissance zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Widerspruch zwischen negativen und positiven Beurteilungen ihres Schaffens.
- Die Lebensgeschichte und der soziale Kontext von Louise Labé
- Die Definition und Darstellung von "l'érotique" in der Renaissance Literatur
- Die Analyse der erotischen Elemente in den Sonetten von Louise Labé
- Die Rezeption und Kritik an Louise Labés Werk im Laufe der Zeit
- Die Stellung von Louise Labé innerhalb der feministischen Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung präsentiert die gegensätzlichen Meinungen über Louise Labé und ihre Sonette, von der Verurteilung als "courtisane" bis zur Anerkennung als bedeutende Dichterin. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Natur und Bedeutung des "érotique" in Labés Werk.
1. Eine Poétesse der Renaissance: Dieses Kapitel beleuchtet das Leben von Louise Labé, von ihrer Herkunft als Tochter eines Kordwanmachers bis hin zu ihrer literarischen Tätigkeit und ihrem Umfeld. Es geht auf ihre umfassende Bildung, ihre Liebesbeziehungen und ihre gesellschaftliche Stellung ein, um den Kontext ihrer literarischen Arbeit zu verdeutlichen. Die verschiedenen biographischen Angaben werden verglichen und diskutiert, und ihr gesellschaftliches Umfeld wird in Bezug auf ihre literarische Produktion dargestellt.
2. L'arrière-plan de « l'érotique »: Dieses Kapitel definiert den Begriff "l'érotique" und untersucht seine Erscheinungsformen und seine Rolle in der Renaissance-Literatur. Es analysiert die gesellschaftlichen Normen und Tabus der damaligen Zeit in Bezug auf Liebe und Sexualität und beleuchtet den kontextuellen Hintergrund der von Louise Labé in ihren Sonetten dargestellten erotischen Elemente. Die Bedeutung der geschlechtsspezifischen Rollenmuster und des Verhältnisses von Liebe und Sexualität wird in Bezug auf den Text von Louise Labé erörtert.
3. Une étude de l'érotique dans les sonnets de Louise Labé: Der zentrale Teil der Arbeit, der sich auf die Analyse des "érotique" in den Sonetten von Louise Labé konzentriert. Die Analyse der sensorischen Beschreibungen, der Darstellung der leidenschaftlichen Liebe und der poetischen Sprache dient als Grundlage. Es werden die verschiedenen Ausdrucksformen der erotischen Thematik untersucht, um das Verständnis von Louise Labés poetischem Ausdruck und ihrer künstlerischen Intention zu vertiefen. Die verschiedenen Aspekte des erotischen Ausdrucks in ihren Sonetten werden detailliert und zusammenfassend untersucht.
Schlüsselwörter
Louise Labé, Renaissance, Sonette, Erotik, Feminismus, Lyrik, Liebeslyrik, Literaturgeschichte, Frauenliteratur, gesellschaftlicher Kontext, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Eine Studie der erotischen Elemente in den Sonetten von Louise Labé
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die erotischen Aspekte in den Sonetten der Renaissance-Dichterin Louise Labé und setzt diese in den Kontext ihrer Biografie und der literarischen Normen der Zeit. Sie untersucht den Widerspruch zwischen positiven und negativen Beurteilungen ihres Werkes und beleuchtet ihre Stellung in der feministischen Literaturgeschichte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Biographie Louise Labés, die Definition und Darstellung von "l'érotique" in der Renaissance-Literatur, eine detaillierte Analyse der erotischen Elemente in ihren Sonetten, die Rezeption und Kritik an ihrem Werk und ihre Bedeutung für die feministische Literaturgeschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und einen Schlussteil (Schlüsselwörter). Kapitel 1 beleuchtet das Leben und den sozialen Kontext von Louise Labé. Kapitel 2 definiert "l'érotique" in der Renaissance. Kapitel 3 analysiert die erotischen Aspekte in Labés Sonetten anhand von Sinnesbeschreibungen, leidenschaftlicher Liebe und poetischer Sprache.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, "l'érotique" in Labés Werk zu definieren und im Kontext der Renaissance zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Widerspruch zwischen negativen und positiven Beurteilungen ihres Schaffens und trägt zum Verständnis ihrer Bedeutung für die Literaturgeschichte bei.
Welche Aspekte der Sonette werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die sensorischen Beschreibungen, die Darstellung der leidenschaftlichen Liebe und die poetische Sprache in den Sonetten. Es werden verschiedene Ausdrucksformen der erotischen Thematik untersucht, um Louise Labés poetischen Ausdruck und ihre künstlerische Intention zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Louise Labé, Renaissance, Sonette, Erotik, Feminismus, Lyrik, Liebeslyrik, Literaturgeschichte, Frauenliteratur, gesellschaftlicher Kontext, Rezeption.
Welche Quellen werden verwendet?
Die FAQ gibt keine explizite Auskunft über die benutzten Quellen. Die Information müsste aus dem Haupttext selbst entnommen werden.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser*innen, die sich für die Literatur der Renaissance, für feministische Literaturgeschichte und für die Analyse von literarischen Texten interessieren. Sie ist besonders geeignet für Studierende der Literaturwissenschaft und verwandter Fächer.
- Arbeit zitieren
- Silvia Bannenberg (Autor:in), 2003, "L'érotique" dans les sonnets de Louise Labé, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50310