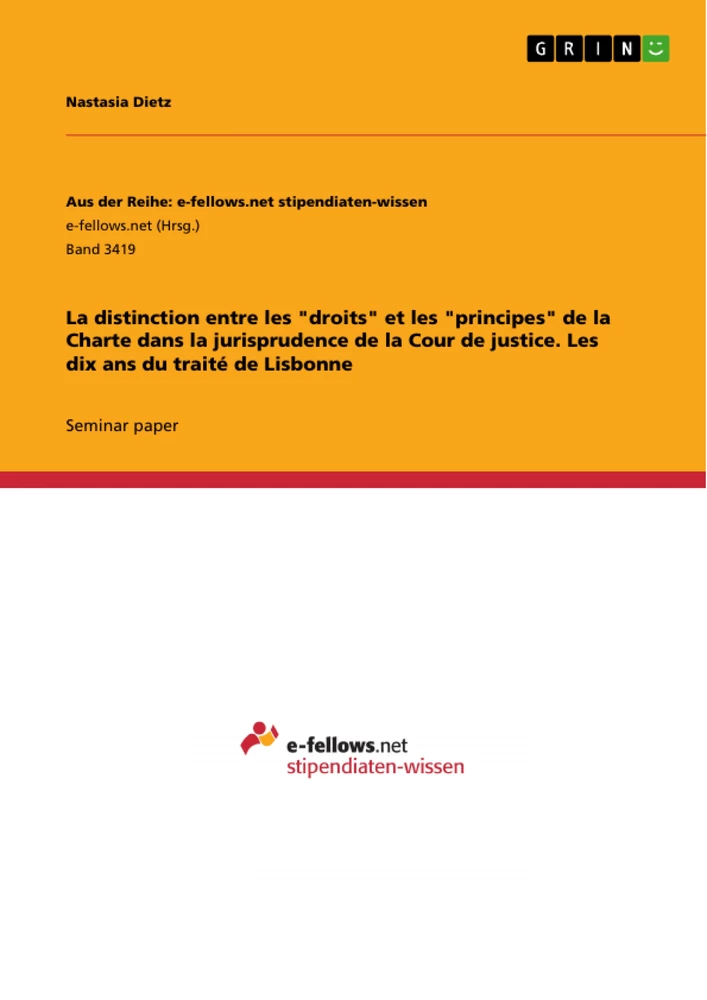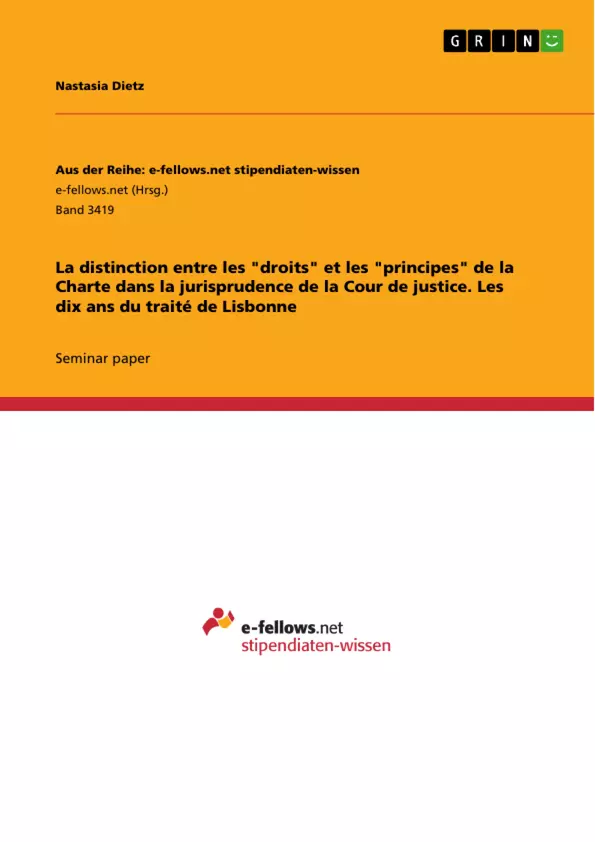Dans l’analyse qui va suivre les droits de la Charte vont englober à la fois le terme de droit, des droits fondamentaux et de liberté pour les opposer aux principes au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux.
Le droit de l’Union européenne parle souvent des principes dans des contextes assez différents qui peuvent tantôt se rapprocher du terme de droit ou des droits fondamentaux, tantôt s’en éloigner.
La distinction entre les droits et les principes au sens de la Charte des droits fondamentaux existait déjà lors des Conseils européens de 1999 et se voit concretiser depuis le traité de Lisbonne notamment à l’article 52, paragraphe 5 de la Charte. Les principes semblent d’abord se distinguer des droits par leur nécessité de mise en œuvre pour pouvoir faire l’objet d’un contrôle ou d’une interprétation. Il s’agit d’une sorte de justiciabilité normative qui n’est pas exigée pour les droits qui ont un caractère plus subjectif que les principes. Ainsi l’article 51, paragraphe 1 de la Charte dispose que les droits doivent être respectés pendant que les principes doivent être observés.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- I. L'essai d'une distinction claire des droits et des principes
- A. Les droits de la Charte comme normes préexistantes
- B. Les principes dans la Charte comme normes programmatiques
- 1. Le contexte de l'élaboration du terme de « principe »
- a. Un essai d'inspiration par les droits nationaux.
- b. Une opposition à l'initiative de la distinction entre droits et principes
- 2. L'impossibilité de distinguer les principes des droits par l'article 52, paragraphe 5
- a. La «< mise en œuvre » des principes
- b. L'interprétation de « tels actes »
- c. L'invocabilité des principes de la Charte.
- II. La prépondérance des ambiguïtés dans la distinction des droits et des principes
- A. Les faiblesses multiples de la distinction entre droits et principes
- 1. La faiblesse des textes
- 2. Inconsistance de la Jurisprudence de la Cour de Justice.
- B. Les alternatives possibles à la distinction entre droits et principes.
- 1. La recherche d'autres critères de différenciation entre droits et principes
- 2. L'abandon de la distinction entre droits et principes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wie sie in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs interpretiert wird. Er untersucht die Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die mit dieser Unterscheidung verbunden sind, und erörtert alternative Ansätze zur Lösung dieser Probleme.
- Analyse der Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
- Bewertung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf diese Unterscheidung
- Identifizierung der Herausforderungen und Mehrdeutigkeiten, die mit der Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" verbunden sind
- Exploration alternativer Ansätze zur Interpretation der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
- Diskussion der Auswirkungen der Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" auf die Anwendung der Charta in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Textes stellt die Problematik der Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vor. Das erste Kapitel untersucht den Versuch, eine klare Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" zu treffen. Es analysiert die Argumentation, dass "Rechte" als präexistente Normen gelten, während "Prinzipien" eher programmatische Normen darstellen. Der zweite Teil des ersten Kapitels beleuchtet die Schwierigkeiten, die mit der Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" im Kontext von Artikel 52 Absatz 5 der Charta verbunden sind. Das zweite Kapitel analysiert die zahlreichen Mehrdeutigkeiten, die die Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien" in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kennzeichnen. Es werden die Schwächen der Unterscheidung sowie alternative Ansätze zur Lösung dieser Problematik diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes sind die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, Unterscheidung zwischen "Rechten" und "Prinzipien", Normativität, Interpretation, Mehrdeutigkeit, alternative Ansätze, Anwendung in der Praxis.
- Citar trabajo
- Nastasia Dietz (Autor), 2020, La distinction entre les "droits" et les "principes" de la Charte dans la jurisprudence de la Cour de justice. Les dix ans du traité de Lisbonne, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899356