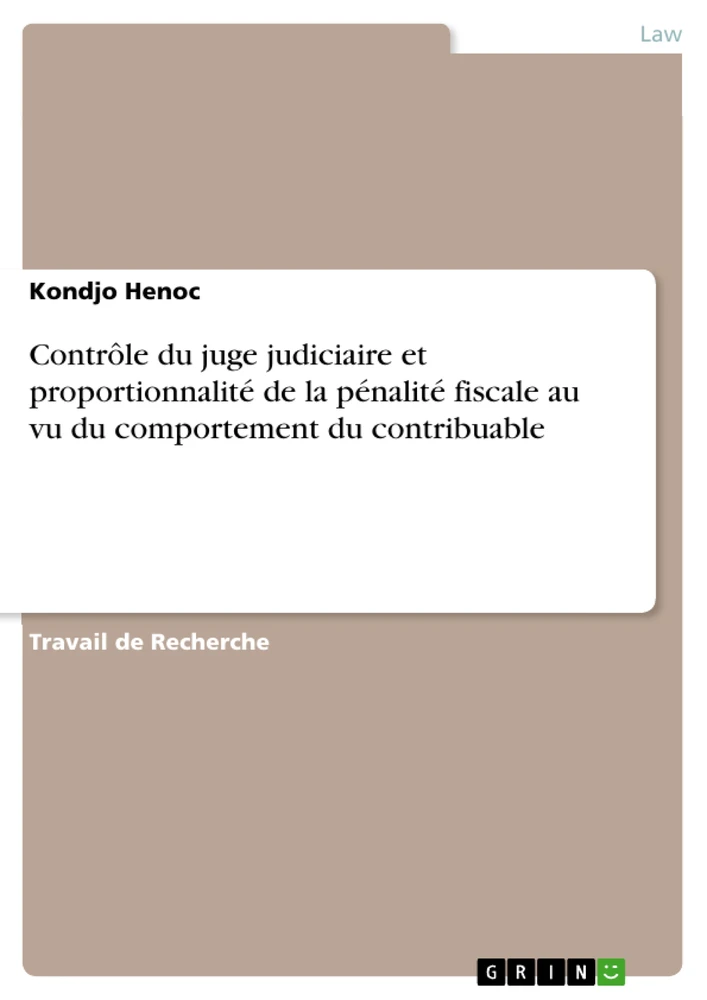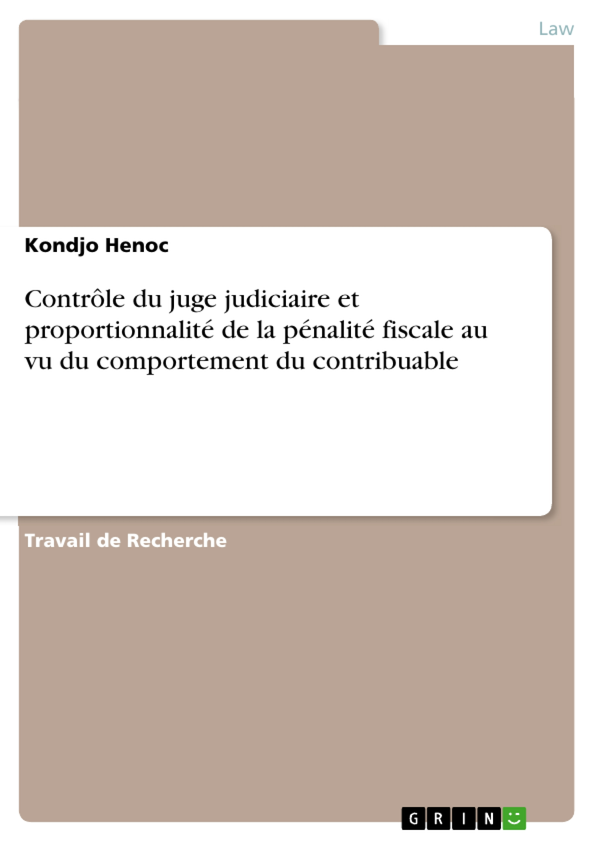En droit fiscal français, le principe de proportionnalité des sanctions implique que les sanctions fiscales doivent être adaptées à la gravité de l'infraction commise. Ce principe est garanti par la Constitution française et les traités et accords internationaux ratifiés par la france, la jurisprudence de la cour de cassation, et dans une certaine mesure, celle du conseil constitutionnel, qui exige que les sanctions ne soient pas excessives par rapport à la faute commise. Le juge français dispose d'un pouvoir de modulation des peines fiscales, ce qui lui permet d'ajuster la sanction en fonction des circonstances de chaque affaire, comme la gravité de l’infraction, la bonne foi du contribuable ou sa situation financière. Cette modulation vise à garantir l’équité et la justice dans l'application des sanctions fiscales. Tel est l'intérêt de cet article qui propose une réflexion sur ce pouvoir dont dispose le juge.
CONTROLE DU JUGE JUDICIAIRE ET PROPORTIONNALITE DE LA PENALITE FISCALE AU VU DU COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE
Par henoc kondjo wembolenga
La nécessité de l'intervention du juge dans tous litiges apportés par-devant lui, réside dans la protection du Droit du contribuable lorsque nous sommes dans une activité fiscale. C’est ce que l'on qualifie de sécurité juridique fiscale ou sécurité fiscale.
BOUVIER écrit que d’un point de vue général, la sécurité juridique est essentielle pour chacun d’entre nous, elle est un facteur indispensable pour la garantie des droits individuels comme pour la démocratie.1
Cependant, le contentieux fiscal Défini comme étant un ensemble de litiges nés à la suite des impositions mises à charge du redevable par l'Administration des impôts ou à l'occasion de leur recouvrement, donne la possibilité à toutes personnes lésées de la pratique de l'administration fiscale dans une activité fiscale, à contester l'imposition.
Parmi les sortes des contestations en contentieux fiscal, le contentieux de répression en est une. Il couvre les poursuites pour des infractions fiscales (répression pénale), et les pénalités assorties des obligations autres que les infractions que n'aurait pas respecter le contribuable (répression administrative).
En effet, pour ce qui nous intéresse, s’agissant de la répression administrative, le système fiscal repose sur un équilibre délicat entre nécessité de garantir les recettes publiques (principe de rendement fiscal) et celle de la protection des droits fondamentaux des contribuables-redevables. Suivant cet aspect, le Droit fiscal organise un arsenal des pénalités.
Si leurs finalités dissuasive est un élément qu'on ne peut refuser d'admettre et d'en taxer mauvaise foi, leur mise en œuvre uniforme soulève des interrogations croissantes quant à leur comptabilité avec le principe de proportionnalité des sanctions.
Dans ce contexte, le rôle traditionnel du juge judiciaire, gardien des libertés fondamentales tend à s'affirmer en matière des penalties fiscales.
Le comportement du contribuable qu'il soit manifestement frauduleux, négligent ou animé de bonne foi constitue la trame essentielle dans l'appréciation de la légitimité et sévérité des sanctions fiscales. Pourtant, l'automatisme de certaines pénalités peut apparaître comme un frein un à une réelle individualisation des sanctions. Toutefois, l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen doit s’appliqué à toutes les sanctions ayant un caractère punitif ou d’une punition2.
À cet effet, il convient de se demander, dans quelle mesure le juge peut-il assurer un contrôle effectif sur la proportionnalité des sanctions-pénalités administratives, et quelles en sont les conséquences ? Il ressort de ce questionnement, le juge peut-il moduler les sanctions prévues en vue de respecter le principe de la proportionnalité des sanctions (le caractère proportionnel).
1. La proportionnalité de la pénalité fiscale selon le conseil constitutionnel français.
La question de modulation des sanctions fiscales a fait couler beaucoup d'encres et a attiré l'attention à des nombreuses décisions de justice. Le conseil constitutionnel français n'en est épargné.
Le conseil d'Etat et la cour de cassation s'opposent sur la question du pouvoir de modulation des pénalités fiscales dont doit disposer le juge de l'impôt3. La cour de cassation reconnaît au juge judiciaire un pouvoir effectif de modulation. Elle a précisé que lorsqu'un système de sanctions ne respectait pas le principe de la proportionnalité, il appartenait au juge de l'impôt de moduler lui-même les sanctions au cas par cas4. Par ailleurs, la jurisprudence administrative, plus favorable à l'automaticité de la sanction fiscale, refuse de contrôler la personnalisation de la sanction. Dans l’avis FATELL, le conseil d'Etat a ainsi estimé que le juge de l'impôt ne pouvait se voir reconnaître un pouvoir de modulation des sanctions fiscales5.
Cet avis a été rendu quant à l'application de l'article 1729-1 du CGI qui prévoit des pénalités à des taux différents suivant que le contribuable s'est rendu coupable des manœuvres frauduleuses, a agi de bonne ou de mauvaise foi6. Le conseil D'Etat estime que le dispositif législatif de sanctions fiscales met en place une certaine modulation puisqu'il établit une échelle des peines7. Le conseil d'Etat valide également les hypothèses selon lesquelles la pénalité n'est pas modulée expressément par le législateur mais où elle est rattachée à une autre pénalité comportant une échelle de taux8.
Pour la Cour européenne des Droits de l’homme, le principe de proportionnalité était respecté lorsque le législateur avait prévu une échelle des peines assurant une modulation de la gravité de la sanction en fonction du comportement fautif selon le cas9. Et que le taux unique n’apparait disproportionné aux agissements de l’agent10.
En effet, le conseil constitutionnel a par ailleurs déjà considéré comme inconstitutionnelles des pénalités fiscales instituées par le législateur lorsqu'elles pourraient, «dans nombre de cas, donner lieu à l'application des sanctions manifestement hors de proportion avec la gravité de l'omission (...) constaté d'ailleurs avec l'avantage qui en a été retiré.11
Pourtant, saisie des QPC, le conseil constitutionnel a rendu deux arrêts le 17 mars 2011, concernant la conformité des dispositions 1729 du CGI ( code général d'impôts)qui prévoit une majoration de 40% en cas de constatation de la mauvaise foi du contribuable et la majoration à 80% lorsqu'un document n'a pas fait objet d'un dépôt par le contribuable auprès de l'administration fiscale dans le trente jours suivants la réception d'un seconde mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première12. Dans lesquels, le conseil constitutionnel a affirmé : « que la loi a elle-même assurée la modulation des peines en fonctions de la gravité des comportements réprimés ; que le juge décide , dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration fiscale, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi , soit de laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit que ce dernier se serait rendu coupable de manœuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40% n'est pas manifestement disproportionnée 13 ».
Le conseil constitutionnel adopte dans ses décisions (QPC) une approche selon laquelle, l'existence d'une graduation voire modulation des pénalités permet de caractériser le respect au principe de la proportionnalité et individualisation de la peine lorsqu’elle est manifestement insérée par le législateur.
Les décisions du conseil constitutionnel laissent persister une ambiguïté sans que celui ne se prononce clairement sur le caractère d'une sanction dite mécanique ou graduable. Laissant ainsi penser que le conseil constitutionnel serait près à reconnaître qu'en présence d'une sanction mécanique des pénalités à taux unique, celle-ci serait inconstitutionnelle, ou qu'en face d'une sanction non graduelle à l'application d'un agissement répréhensible serait contraire à la constitution et à l'Art.8 ….
Toutefois, le conseil constitutionnel nous laissera à queue de poisson, lorsqu'il sera saisi le 24 mai 2012 dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la constitution d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit du 1 du I de l'article 1736 du CGI. La cour va affirmer qu'en considérant qu'en réprimant le manquement aux obligations , prévues à l'article 240, au 1de l'article 242 ter et à l'article 242 ter b du code susvisé, de transmettre à l'administration fiscales des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables, la disposition contestée sanctionne le non-respect d'obligations déclaratives permettant à l'administration fiscale de procéder aux recoupements nécessaires du contrôle du respect, par les bénéficiaires des versements qui y sont mentionnés , de leurs obligations fiscales; considérant qu'en fixant l'amende encourue par l'auteur des versements en proportion des sommes versées , le législateur a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle; qu'il a proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimées apprécié à raison de l'importance des sommes non déclarées le taux de 50% n’est pas manifestement disproportionné; que , par suite, le grief tiré de la reconnaissance de l'article 8 de la déclaration de 1789 doit être écarté ; et considérant que le 1 du I de l'article 1736 du CGI n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit; qu'il doit être déclaré conforme à la constitution14.
Le conseil constitutionnel lèvera donc son équivoque sur sa considération concernant la proportionnalité des sanctions, que le conseil constitutionnel considère que le pourcentage de taux unique des sanctions fiscales est proportionné à la gravité des manquements réprimés apprécié en raison des conséquences qui échapperont grâce à l’inobservance des règles et obligations. Le conseil constitutionnel rejoindra ainsi la position du conseil d’Etat à travers cette approche.
2. La réaffirmation du contrôle de proportionnalité par la cour de cassation française.
Par son arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation rappelle avec force que le juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur la majoration fiscale appliquée pour abus de droit15, ne peut se dispenser d’un contrôle concret de proportionnalité ; qu’il a l’obligation de contrôler la proportionnalité de façon concrète des sanctions par rapport aux circonstances en l’espèce.16
L’article1729 du Code général des impôts(CGI) prévoit une majoration de 80% en cas d’abus de droit, si le contribuable en est l’instigateur principal ou le principal bénéficiaire. Cette pénalité est ramenée à 40% en l’absence de preuve d’une telle implication.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 mars 2018(n°399862), rappelle que lorsque l’administration ne justifie pas le taux de 80%, le juge doit substituer d’office le taux de 40%, même si le contribuable ne le demande pas explicitement17.
L'administration fiscale supporte la charge de la preuve de la qualification d’abus et du taux applicable de la majoration. Ce principe protège le contribuable contre des sanctions automatiques et disproportionnées18.
La jurisprudence récente est venue préciser voire réaffirmer la position longtemps soutenue par la cour de cassation, que les juges doivent exercer un contrôle concret de proportionnalité des sanctions fiscales.
Il s’agit d’une affaire dans laquelle La cour d’appel de Chambéry avait jugé que la sanction était proportionnée sans motiver concrètement sa décision, en indiquant simplement que la sanction était proportionnelle aux agissements en l’espèce19.
Il s’agit d’une affaire selon laquelle, l’administration fiscale avait notifié à une société civile immobilière(SCI) une première proposition de rectification en aout 2010, avant de l’abandonner20. Une seconde proposition de rectification fut émise en janvier 2012, constatant l’application du régime de faveur prévu à l’article 1115 du code général d’impôts et requalifiant une opération immobilière sur le fondement de l’abus de droit21.
Les droits réservés, assortis des pénalités et d’intérêts de retard, on fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en mai 201322. La société, contestant cet avis, a introduit une action en décharge devant la juridiction compétente. Apres un rejet de ses demandes en appel en Janvier 2023, elle a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement et le caractère disproportionné de la majoration fiscale23.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt, rappelant qu’il incombe au juge de vérifier, au regard des faits de l’espèce, que la pénalité est bien proportionnée au comportement du contribuable24.
La cour de cassation dans son arrêt , dans la partie motivation, apportera la précision qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la convention de la sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, qu’un recours de pleine juridiction doit être ouvert au contribuable pour permettre au juge de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité fiscale et que le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit vérifier que la pénalité fiscale est proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l’espèce25.
Il faut dire, que l’apport fondamental de cet arrêt réside dans la reconnaissance explicite d’un Droit au contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions fiscales. Il ne suffit plus pour le juge d’avaliser les taux appliqués par l’administration: il doit motiver sa décision à l’aune des circonstances propres à chaque cas26.
On retient donc, à travers cette décision, que si le contrôle n’est pas effectué d’office par le juge, la cour de cassation reconnait la possibilité pour le contribuable de développer ultérieurement une contestation27.
Cet arrêt illustre donc l’exigence de précision dans l’établissement des sanctions, non seulement au juge judiciaire mais aussi à l’administration fiscale qui peut voir ses décisions être attaquées à tout moment par le contribuable lorsqu’il jugera non proportionnelle la peine. Elle rappelle la nécessité pour le juge judiciaire de contrôler la proportionnalité des pénalités qui seront retenues contre le contribuable pour ne pas porter atteinte à l’art 8 de la DUDH et l’article 6 par.1 de la CEDH
Cette exigence qui incombe au juge judicaire de modérer s’il y a lieu les pénalités fiscales en fonction du comportement du contribuable, garantira au mieux la sécurité juridique du contribuable.
[...]
1 Bouvier M., La sécurité fiscale: les grands enjeux d'aujourd'hui, rabat le 12 mai 2016, p.1
2 Cons.cons., déc.1997 , n°97-395 DC, const. 37 , AJDA 1998 ;173
3 PERROTIN Frédérique, pénalités fiscales et principes d’invidualisations des peines, fiscal et finance, publié le 23/11/2018
4 Cass.com., 29avr.1997, n°95-20001, Ferreira, cité par PERROTIN Frédérique, id.
5 CE, avis, 8juil.1998, n°195664. PERROTIN, ibd.
6 PERROTIN, ibi d.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 On peut citer l’arret CEDH, le 23 sept. 1998, n°68/1997/852/1059, malige c/ France.
10 CEDH, le 7 juin2012, n°4837/06, segame.
11 Cons. const., déc.30déc.1997,n°97-395DC,préc.,cons.39., cité par GUTMANN Daniel, nouveaux cahiers du conseil constitutionnel n°33( dossier : le conseil constitutionnel et l'impôt , octobre 2011.
12 Cons.const.,17 mars 2011, n°2010103 QPC, AJDA 2011.813; Constitutions 2011.377, obs. A.Barilariet n°2010105/106 QPC,Constitutions 2011.377, obs. A.Barilari. GUTMANN Daniel, id.
13 Const.6 ; GUTMANN Daniel, ibid.
14 Cons.cons., décision 2012-267, QPC, du 20 juillet 2012
15 L’abus de droit en matière fiscale c’est lorsqu’un contribuable crée une fausse apparence juridique pour dissimuler la réalité, dans le but d’échapper à l’impôt. Ses caractéristiques sont : l’acte qui est fictif ou mensonger et l’existence d’une discordance entre la forme apparente et la réalité des faits. Il n’est pas à confondre d’avec la fraude fiscale qui est une infraction en droit fiscal. La fraude fiscale consiste en la dissimulation volontaire interdite de tout ou partie des revenues ou de son patrimoine pour échapper à l’imposition ; contrairement à l’optimisation fiscale ou abus de droit qui jouent sur les failles de la loi (autrement appelé évitement fiscal)
16 Cass.com., n°23-14.047
17 MARANT Estelle, le juge peut-il réduire une pénalité pour abus de droit. In défends tes droits.
18 Id.
19 Ibid.
20 La proportionnalité des sanctions fiscales au regard du principe de droit, les echos formalités, publié le è mars 2025,
21 Id.
22 Ibid
23 Ibid
24 MARANT Estelle, op.cit.
25 Cour de cassation, pourvoi n°23-14.047
26 MARANT Estelle, op.cit
27 SOTON Arnaud, sanctions pour abus de droit: le juge de l’impôt doit contrôler la proportionnalité de la majoration, in village de la justice.
- Quote paper
- Kondjo Henoc (Author), Contrôle du juge judiciaire et proportionnalité de la pénalité fiscale au vu du comportement du contribuable, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1585183